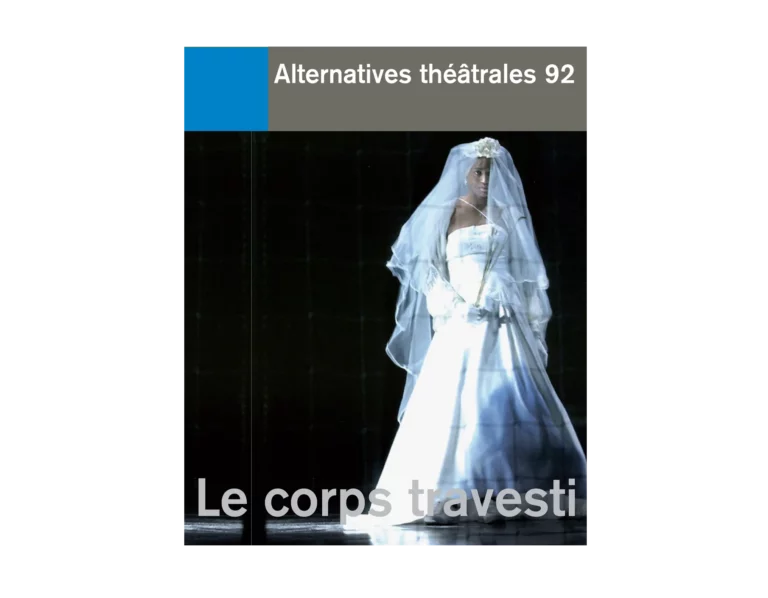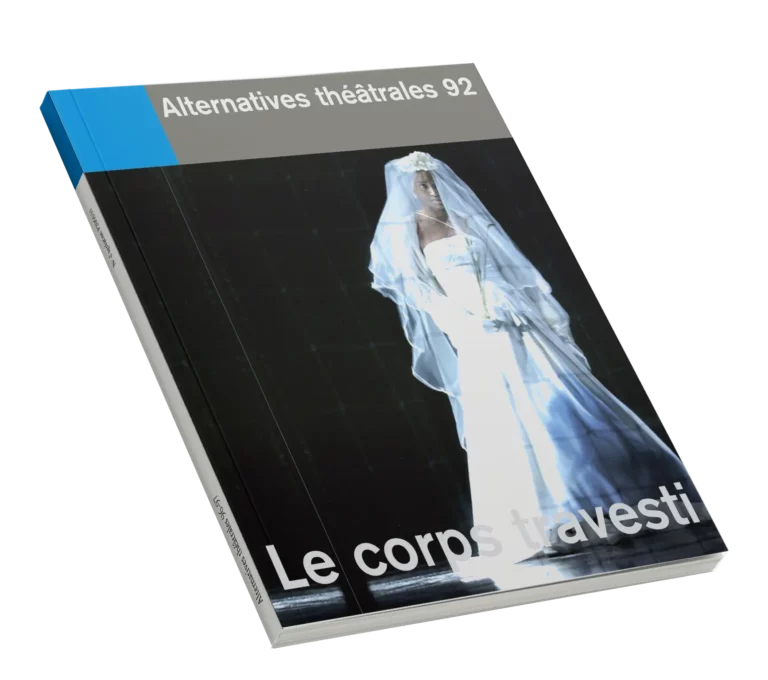EN 1970, paraissait un ouvrage de Roland Barthes qui allait marquer d’une pierre précieuse la critique littéraire. S/Z 1 est le résultat d’un séminaire qui s’est tenu pendant deux années, de 1968 à 1969, à l’École pratique des Hautes Études ; il présente l’analyse et/ou le commentaire d’une nouvelle de Balzac intitulée SARRASINE. Profondément imprégnée des travaux de Lacan sur la psychanalyse et la linguistique, la méthode de Roland Barthes va à l’encontre de celle en usage à l’université. La première entorse aux canons du savoir vivre dans le monde de la littérature réside dans la mise en page même de l’ouvrage. La nouvelle de Balzac, qui sert de support à l’analyse, est reléguée à la fin du volume, en annexe, cependant que les deux cents premières pages sont occupées par l’analyse et le commentaire. Deux décennies plus tard, George Steiner pense-t-il à Roland Barthes lorsque dans REELLES PRESENCES 2, il fustige l’envahissement et le primat du commentaire sur l’œuvre originelle. La valeur anecdotique, pourrait-on dire, du texte originel, est encore accentuée par la façon dont il a été choisi. Là où l’on attendait une recherche minutieuse, il y a le pur hasard d’une rencontre, qui s’est faite par le biais d’une étude de Jean Reboul, qui lui-même avait découvert la nouvelle par une note en bas de page, dans LE BLEU DU CIEL de Georges Bataille. Le statut sacré du texte et de l’auteur sont ébranlés et, au-delà, c’est la littérature dans toute sa chaîne, depuis la source jusqu’au lecteur, dans son état de production et de produit, qui est questionnée.
Le postulat de départ semble être une réponse à l’œuvre de José Luis Borgès, à FICTIONS 3 en particulier, variation sur le thème du livre unique et infini qui contiendrait tous les autres livres. Du reste, le jeu de report qui conduit la nouvelle SARRASINE jusqu’à Roland Barthes est poétiquement borgésienne. Cette étrange noosphère qui nimbe les littérateurs éloignés dans le temps, dans l’espace et dans les livres, n’est pas le moindre attrait de S/Z.
Au risque de réduire la beauté de la nouvelle de Balzac et de trahir Roland Barthes, il nous faut bien résumer SARRASINE. C’est un récit gigogne (la formulation serait récusée par Roland Barthes) écrit à la première personne. Le narrateur observe l’agitation brillante d’un bal, dans un riche hôtel particulier de Paris, où il accompagne une jolie femme qu’il compte bien séduire. Suit une longue description hyperbolique où tout est faste, luxe et promesse de volupté. En contraste inquiétant avec tant de vie et de beauté, un mystérieux vieillard, indéfinissable et innommable, hante les lieux. Il trouble la jeune femme ; le narrateur s’engage à lui raconter l’histoire de ce vieillard contre un rendez vous galant. S’ouvre alors le second récit. Le vieillard est un castrat qui, dans sa jeunesse, sous le nom de Zambinella, triomphait dans les théâtres de Rome. Un jeune sculpteur, Sarrasine, de passage à Rome pour soigner son vide à l’âme, s’en éprend, l’enlève et meurt assassiné par les sbires du protecteur du « musico », au moment où lui est révélé le vrai sexe de Zambinella. Le récit de Balzac est une longue procession où la vérité est toujours différée, dans un jeu d’antithèses, d’équivoques, de métonymies jusqu’à la catastrophe finale. La formule S/Z du titre synthétise l’énigme par une autre énigme qui est le cœur du récit et qui s’affiche sans se dévoiler, dans une faute d’orthographe faite par Balzac : la substitution du Z attendu (Sarrazine, féminin de Sarrazin) par un S. La Lettre Z, lettre de la mutilation, de la déchirure, se trouve au milieu du nom de Balzac, à l’initiale de Zambinella, le corps châtré et, en négatif, par le trou qu’il laisse au milieu du nom féminisé de Sarrasine. La castration plane sur la nouvelle avec son ombre maléfique qui finit par contaminer tous les autres corps, celui du lecteur y compris, par le charme que le récit exerce. Ce charme tient bien sûr au sujet ; ils sont toujours troublants les récits d’amour, de sexe, de vie et de mort, mais dans SARRASINE, le génie de Balzac tisse magistralement, jusqu’à la confusion, le champ du réel, l’acte de châtrer et le champ symbolique, la castration. La lettre et le symbole perdent le pouvoir de se représenter l’un l’autre, la castration peut déborder et contaminer tous les autres corps. La barre qui sépare le Signifiant et le signifié ne peut être franchie, dit Lacan, au risque de produire un dérèglement dans le système d’équivalence et d’exclusion qui conduit à l’opposition ultime homme femme. Un homme ne peut être une femme, une femme ne peut être un homme et la « création » d’un troisième sexe provoque la mort. Ou l’anéantissement. « Tu n’es rien ! » C’est par ces mots que Sarrasine maudit le castrat dévoilé.
S/Z apporte ainsi un éclairage à la thématique du corps travesti. Sur la scène de théâtre, qu’est-ce donc que « le corps travesti » ? Est-il masculin ou féminin, ou bien est-il masculin et féminin ? La vraie performance de l’acteur n’est pas de copier la réalité et de tromper le spectateur mais au contraire de maintenir son intelligence dans une oscillation entre ce ou et ce et, sans jamais l’autoriser à arrêter une opinion définitive, du moins franche. Et c’est bien cette impossibilité à arrêter un sens qui justement fait sens ; la pluralité des sens (du signifiant) se convertit en affolement des sens (du spectateur). Le manque se traduit par l’excès (corps travesti donne toujours cette impression de « trop »), et il nous donne deux messages contradictoires et pas nécessairement opposables : il délimite le cercle où la castration pourrait être contagieuse ; en même temps, il joue de l’Autorité de l’Art pour se donner le « droit de déterminer la différence des sexes ». Le talent de l’acteur performateur et/ou le code du théâtre font que jamais la conscience de l’origine, du fondement à quoi renvoyer la réalité du monde habitable, ne sont inhibés. Le corps travesti dit en même temps la Loi et son contournement provisoire. Dans une conférence donnée à Florence le 15 juillet 1985, intitulée Tu es le fils de quelqu’un, Jerzy Grotowski apporte un éclairage sur ce « talent » de l’art dramatique : « Qu’est ce que c’est le personnage ? Toi ? Celui qui le premier a chanté la chanson ? Mais si tu es le fils de celui qui a chanté pour la première fois cette chanson, oui c’est ça la vraie trace du personnage… Alors dans tout ce travail apparaît l’aspect vertical, toujours plus vers le commencement, toujours plus être debout dans le commencement… Derrière toi il y a la crédibilité artistique et devant toi il y a quelque chose qui ne demande pas une compétence technique mais une compétence de toi-même » « Qu’est ce qui nous fait « homme » ? Telle est la question dernière de l’acteur, conclut Jerzy Grotowski. Le corps travesti nous dit qu’il sait quelque chose de la nature humaine. S’il reste une re-présentation empêchée, il est bien pure présentation qui ne se rend pas tout entier au réel. C’est un langage poétique, un lieu dans le monde ouvert à tous les possibles contre « la certitude que tout est écrit (qui) fait de nous des fantômes. » 4