CHRISTOPHE TRIAU : Cela fait une dizaine d’années que tu fais de la mise en scène, et comme tu as pris, en compagnie de Robert Cantarella, la direction du 104 à Paris, tu te trouves à la veille d’un temps où tu n’en feras pratiquement plus. Avec le recul, comment analyses-tu ton parcours ?
Frédéric Fisbach : Il m’est difficile de partir du moment où j’ai débuté la mise en scène, parce que mon parcours de théâtre a commencé plus tôt, il y a une quinzaine d’années. J’ai été acteur dans une aventure bien spécifique, celle de la compagnie Nordey, travaillant sur un répertoire contemporain. Puis il y a eu un moment de bascule : j’ai eu envie de continuer autrement, et cet autrement est devenu la mise en scène. J’en avais déjà fait, mais « dans les coins » : de toutes petites formes, des spectacles pour enfants, des spectacles à installer partout, des travaux qu’on ne revendique habituellement pas beaucoup mais qui, moi, m’intéressaient. Passer à la mise en scène, même si cela peut sembler être une rupture, était donc une continuité. Cela ne voulait plus dire grand chose pour moi de continuer à jouer, j’étais allé au bout de mon aventure au sein de la compagnie Nordey, j’avais vécu ce que j’avais à y vivre, et j’avais envie de repartir sur quelque chose de neuf, que je connaissais sans connaître : la mise en scène, et donc, surtout, la mise en place de projets. Car c’est quand même cela qui, pour moi, est essentiel, c’est ce qui donne une cohérence à mon parcours de metteur en scène, si le répertoire n’en donne peut-être pas. Il s’agit toujours de mettre en place des projets ; pas seulement des projets de mise
en scène, mais se demander ce qu’on se donne à vivre pendant plusieurs mois (généralement autour d’un texte, puisque je pars toujours de cela), et réunir un certain nombre de personnes autour de cette question. Ce qui m’intéressait, c’était l’idée d’aventure, d’un temps singulier qui ne serait pas un temps de reproduction d’une chose déjà connue, déjà traversée, mais un temps de découverte, de curiosité… « Pour la première fois ».
C. T. : Ce « qu’est-ce qu’on se donne à vivre, à partager », passait-il par la question : « avec qui ? »
F. F. : Bien sûr, car derrière tout cela il y a évidemment d’un côté la question du spectateur (puisque tout cela n’a qu’un but, c’est d’aller alimenter le spectateur, l’amateur de théâtre, d’art), et de l’autre celle des interprètes avec lesquels je travaille. Souvent, même, j’ai co-réalisé les projets : BÉRÉNICE, mais on peut dire aussi que LES PARAVENTS est une co-réalisation avec la compagnie Youkiza. La position du metteur en scène – qui est souvent une position d’isolement –, je l’ai fréquemment partagée avec d’autres, avec bonheur.
C. T. : Il y a souvent un élément externe à ton identité artistique qui détermine la nature du projet. L’ANNONCE FAITE À MARIE convoquait des amateurs (même s’ils n’étaient pas au centre du spectacle, leur présence en décalait la nature); TOKYO NOTES, même si dans le résultat final il n’y avait pas tant de Japonais que ça, est un projet qui s’est fait avec le Japon ; BÉRÉNICE a été conçu avec Bernardo Montet, et donc la danse…
F. F. : La mise en scène, c’est de la mise en rapport. Et il y a aussi un parcours intime qui se fait à travers cela ; il y a un désir, qui se travaille, puisque le désir, y compris celui de faire de la mise en scène, n’est pas quelque chose de donné une fois pour toutes. S’il n’est pas réactivé au contact de l’autre, il tombe, forcément. Et en ce qui me concerne, ce désir est vraiment celui de se mettre au travail. Or souvent, l’étranger, l’inconnu, m’excite plus – ou différemment – que le connu, le familier. Il y a donc toujours au moins un autre. Ce peut être des interprètes, mais souvent il y a encore une chose en plus : aborder LES PARAVENTS avec l’art japonais de la marionnette (et la séparation œil/oreille qu’il implique), aborder BÉRÉNICE par le corps (et pas n’importe quel corps, mais un corps travaillé, écrit, par Bernardo Montet et ses interprètes), etc. C’est un peu différent pour l’opéra, où il s’agit plus de commandes, mais cela peut y ressembler : pour FOREVER VALLEY, en retravaillant entièrement le livret avec Marie Redonnet, cela a été, le désir de rencontrer l’auteur et de faire une adaptation à notre main, à Gérard Pesson et à moi, en incluant cet autre que je ne connaissais pas, pour éclairer une œuvre qui n’existait donc pas encore. À l’exception d’AGRIPPINA, j’ai d’ailleurs toujours mis en scène des opéras qui n’existaient pas, puisqu’ils n’étaient pas encore composés au moment où j’ai accepté. Et quand j’ai accepté de faire SHADOWTIME, c’était aussi parce que j’avais envie d’aborder Benjamin, auquel je ne comprenais rien, à travers le regard de Bernstein (le librettiste) et de Ferneyrough. C’était aller vers quelque chose que je ne comprenais pas, via des compères que je ne connaissais pas plus mais qui me donnaient un point de vue pour y entrer.
C. T. : Tu dis qu’il y a eu des ruptures, que ton parcours est fait de périodes qui se succèdent et, en même temps, qu’il y a toujours eu une continuité…


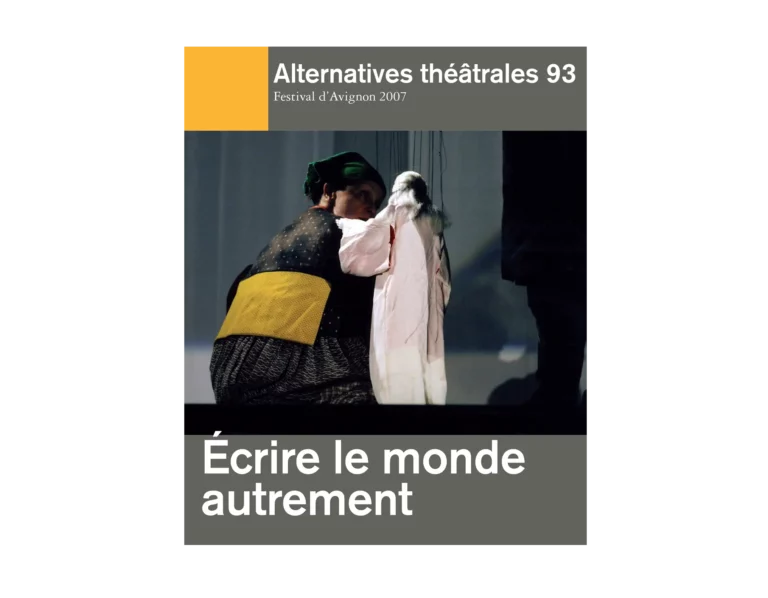
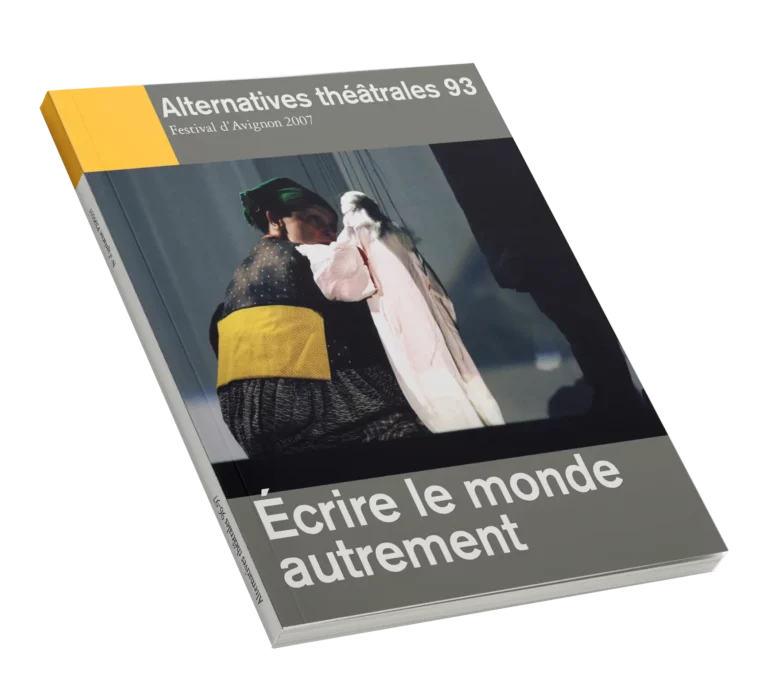



![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)
