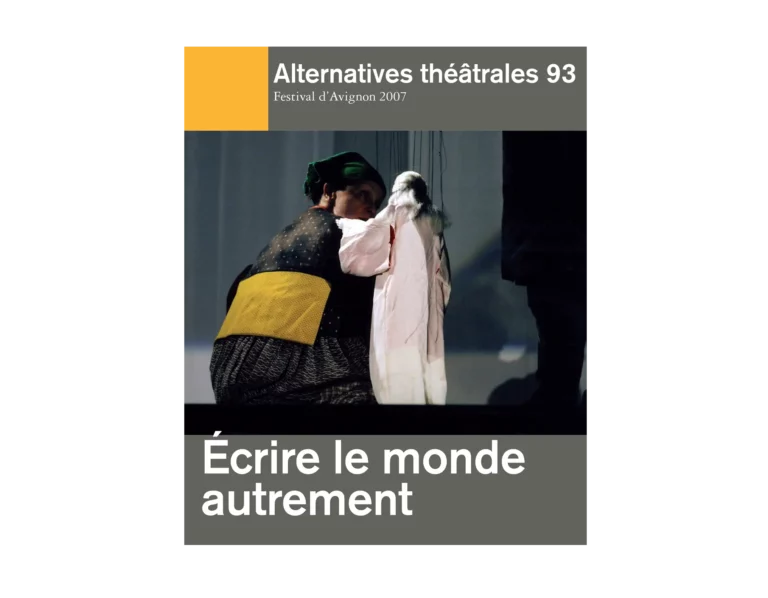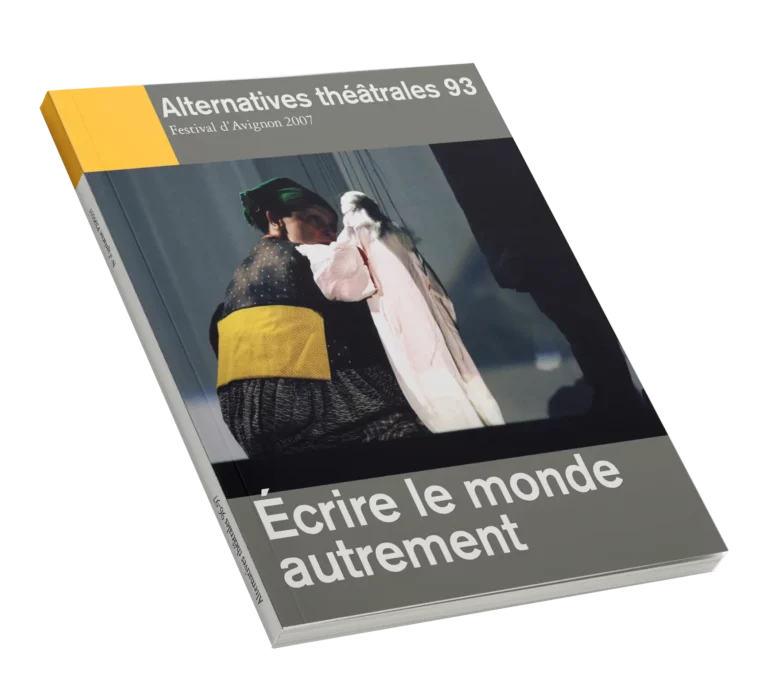EN SEPTEMBRE 2001, Jacques Derrida reçoit à Francfort le prix Theodor W. Adorno. Le sujet de son allocution, publiée dans Le Monde Diplomatique de janvier 2002, est la langue, devenue d’autant plus importante à questionner que, écrit-il, « dans ce qu’on appelle de façon de plus en plus douteuse la « mondialisation », nous nous trouvons en effet au bord de guerres qui sont moins que jamais, depuis le 11 septembre, sûres de leur langue, de leur sens et de leur nom ! ». S’interrogeant sur la langue, il fait une longue digression sur le rêve ; le rêve est le contraire du moi souverain et vigilant pour les philosophes, mais pour les artistes et les psychanalystes rien n’est moins sûr ; le rêve, dit Derrida, donne à penser « la possibilité de l’impossible » et invite à « penser autrement la pensée ».
Le temps est venu de requalifier la langue dans son pouvoir à investir le réel, le politique, l’Histoire. La nation devient monde, la parole déferle à travers médias et technologies performantes, la communication conduit les affaires humaines ; après la mythologie grecque, la chrétienne, voici que notre pensée occidentale va devoir faire le deuil de la mythologie marxiste et la Constitution européenne est en panne, entre autres, faute d’avoir trouvé le juste équilibre entre le culturel et l’économique. Dans ce contexte, quelle épopée, quel récit inventer, écrire, dire pour raconter notre humanité ici et maintenant ? Quelle langue, quel langage, quel art sont en train de se forger pour penser autrement ?
« Je m’adresse donc à vous dans la nuit, comme si au commencement était le rêve », dit Derrida dans l’allocution citée. Cette phrase pourrait être mise dans la bouche de Richard III, en ouverture de la pièce du même nom écrite par Peter Verhelst, traduite par Christophe Marcipont et mise en scène par Ludovic Lagarde. Au commencement est le rêve ou son opposé, mais qui pourrait bien être la même chose, l’impossibilité de dormir. La pièce s’ouvre, en effet, par un monologue de la Duchesse, mère de Richard, et se termine par une suite du même monologue ; la trajectoire de Richard se développe dans cet entre-deux, dans ce vide laissé par cette parole interrompue puis reprise avec des éléments communs mais légèrement modifiés, comme si la geste de Richard était de l’ordre d’un rêve, mis entre parenthèses entre la description d’une naissance avec césarienne qui a eu lieu et une délivrance qui est à venir. Par ailleurs, le mot « rêve » est récurrent tout au long du texte et, en exergue, l’auteur a placé quelques phrases parmi les plus célèbres, prononcées par des prophètes aux idéologies opposées, sur la variation « j’ai un rêve » de Martin Luther King. Dans l’héritage shakespearien, la problématique baroque – « la vie est un songe » – est ici amplifiée, comme décantée, devenue force dramatique. La proposition de Verhelst diffère essentiellement sur deux points de la tragédie originale : la pièce décrit l’ascension de Richard vers le trône par l’élimination de tous les prétendants légitimes ; en revanche, les étapes fulgurantes de sa déchéance et de sa chute sont gommées. Une fois couronné, Richard s’abîme dans un délire onirique et apocalyptique avant de retourner au giron maternel, pendant que les armées de Richmond envahissent le territoire, comme si elles étaient appelées par les incantations de Richard. Sur le plan du style, la structure typique des pièces de Shakespeare, avec son alternance intime/épique, se trouve aussi amputée du deuxième élément au profit d’une hypertrophie de l’intime et du lyrisme individuel.
C’est le développement de l’intime ou plutôt l’intrusion de l’intime dans le politique qui est l’angle de lecture choisi par Ludovic Lagarde pour ces premiers jours de répétitions. Au milieu du plateau, autour d’un trône, se joue un ballet au gré des alliances, défiances, coups de théâtre, intrusions, révélations qui amènent Richard à rectifier son tir chaque fois qu’un personnage se déplace ou avance une information. La scène se met en place, lisible pour ce qui est de l’expression des moteurs intimes, moins évidente pour le sens politique. Mais justement, y a‑t-il un sens politique dans les actes de Richard ? Ludovic Lagarde dirige la répétition entre ces deux strates. Pourquoi, s’interroge Ludovic Lagarde, le hors-champ du politique fait-il intrusion avec une telle force dans le champ ? Richard semble avancer à l’aveugle, sans stratégie prédéterminée et sans projet. Ce qui intéresse Richard, c’est la succession des actes qui le mènent jusqu’au trône royal. Une fois au sommet il se retire, en quelque sorte, dans un fantasme fœtal. Richard est dans les actes, pas dans l’Action. Il est pur présent, il n’est pas dans l’Histoire. Et cependant, il n’est pas un serial killer de faits divers puisqu’il est Roi d’Angleterre, donc dans l’ordre du politique.