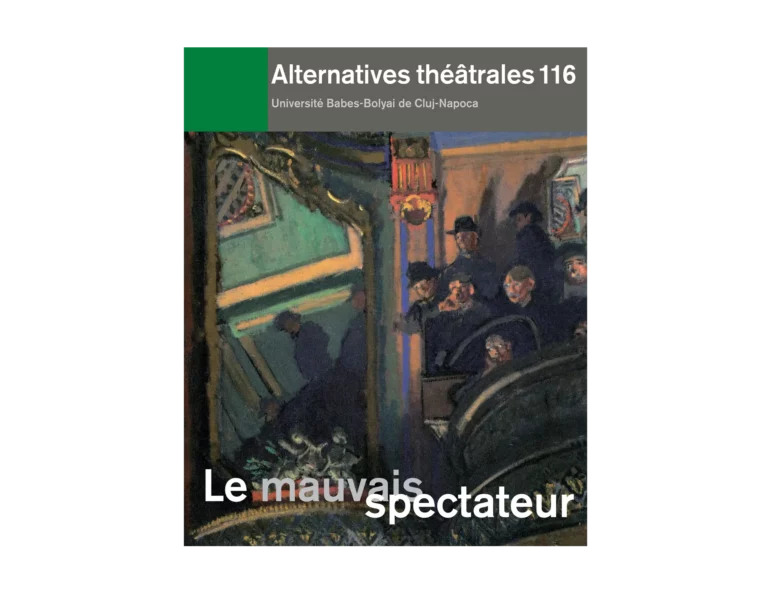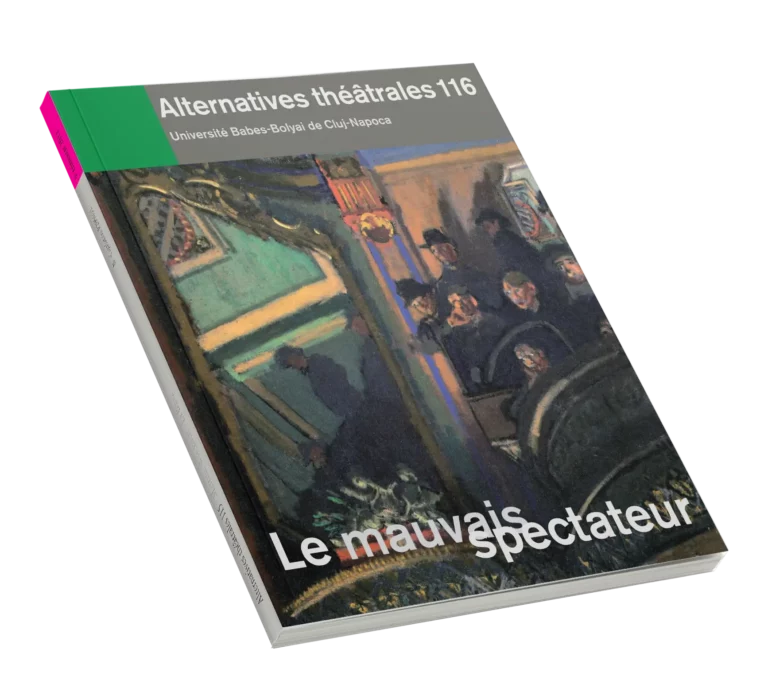« La culture c’est la règle, l’art c’est l’exception. »
Jean-Luc Godard
QU’IL Y A‑T-IL de plus souhaitable, de plus désirable que l’accession à la culture ? La culture dans toutes ses dimensions ? Elle est par excellence ce qui nous permet de nous hisser au-delà de nos limites, de développer et d’enrichir notre esprit en nous confrontant à des territoires étrangers, en approfondissant ce qui nous constitue, en nous frottant aux œuvres emblématiques et incontournables de notre civilisation et en faisant de nous des spectateurs « éclairés ». Bref, la culture semble ne pouvoir être critiquée tant elle incarne les aspirations de tous à l’épanouissement individuel et à la santé d’une société pacifiée. Pour preuve, ces files interminables qui se dressent à l’entrée des « temples » de la culture moderne, ces musées qui, depuis le début des années 80 ne cessent de se multiplier un peu partout dans le monde, ces voyages organisés, ces livres, ces audio- guides… Que peut-on reprocher à une telle croissance du désir de connaissance dans nos sociétés actuelles ? Ne participe-t-elle pas à former chacun de nous, à en faire un spectateur et un citoyen attentif, subtil, « civilisé » ? Ne pas aspirer à un tel idéal, critiquer ou refuser ouvertement cette aspiration c’est nécessairement faire preuve d’obscurité, voire d’obscurantisme. C’est être un « mauvais » spectateur… Alors, comment, dans ces conditions, prétendre que l’« inculture » puisse être souhaitable ? Comment en faire l’éloge ? En m’appuyant sur des œuvres concrètes et sur les trajectoires singulières d’artistes ayant vécu à différents moments du XXe siècle (Marcel Duchamp et Francis Alÿs), je souhaite rendre visible une attitude qui traverse toute l’histoire de l’art moderne : la défiance vis-à-vis du musée comme unique horizon de la création plastique et vis-à-vis d’une certaine conception de la « culture ». On verra que l’œuvre, dès lors qu’elle est placée loin du giron de l’institution, est productrice d’un nouveau rapport à l’objet d’art, d’un nouveau regard, d’un nouveau spectateur.
À la fin de 1911, Marcel Duchamp réalise une petite huile sur carton qui constituera la première version d’une de ses toiles les plus célèbres : le NU DESCENDANT UN ESCALIER. Contrairement aux toiles précédentes de Duchamp qui se situent dans le prolongement des théories cubistes en vigueur à l’époque, cette esquisse fait apparaître des préoccupations nouvelles chez Marcel Duchamp et notamment le cinéma et la décomposition du mouvement. Tout comme les Futuristes qui, depuis déjà quelques années, explorent en Italie la possibilité de suggérer le mouvement dans une toile par une décomposition des différentes étapes qui le composent, il donne à voir une figure anonyme descendant les marches d’un escalier.
Cette toile déplaît fortement aux cubistes qui refusent tout naturalisme (et donc le « nu » en question) et d’autre part elle ne peut plaire aux futuristes qui avaient, de leur côté, appelé ouvertement à la disparition de la tradition, ridicule selon eux, du nu en peinture. Duchamp soumet sa toile au salon des indépendants de 1912. Ce salon, comme d’autres à l’époque, fut créé dans le prolongement des révolutions artistiques qui secouèrent le XIXe siècle et visait à n’appliquer strictement aucun critère de sélection à l’entrée, mettant au cœur de sa dynamique la promulgation d’une liberté artistique totale et un refus d’exercer un quelconque pouvoir institutionnel. Alors que la toile est reçue par le comité organisateur, un malaise parcourt le « jury » et l’œuvre va se voir refusée… Les cubistes « officiels » (Gleizes, Metzinger, Delaunay, Fauconnier…) estimèrent que l’œuvre n’était « pas tout à fait dans la ligne ». Duchamp prit un taxi et décrocha sa toile. Cet épisode, bien que trivial, va constituer pour Duchamp une prise de conscience fondamentale et marquera définitivement sa manière de considérer le monde de l’art et les artistes eux-mêmes. Il n’aura de cesse après cet épisode de vitupérer les artistes et la « pureté » de leurs engagements, jusqu’à cette profession de foi radicale :
Plus je vis parmi les artistes, plus je suis convaincu qu’ils sont des imposteurs du moment qu’ils ont le moindre succès. Ceci veut dire aussi que tous les chiens autour de l’artiste sont des escrocs. Si vous voyez l’association qu’il y a entre imposteurs et escrocs, comment êtes-vous en mesure de conserver quelque espèce de foi (et en quoi) ? Ne me donnez pas quelques exceptions qui justifieraient une opinion plus clémente au sujet du « petit jeu de l’art » tout entier. À la fin, on dit qu’une peinture est bonne seulement si elle vaut « tant ». Elle peut même être acceptée par les « saints » musées. Et autant pour la postérité.