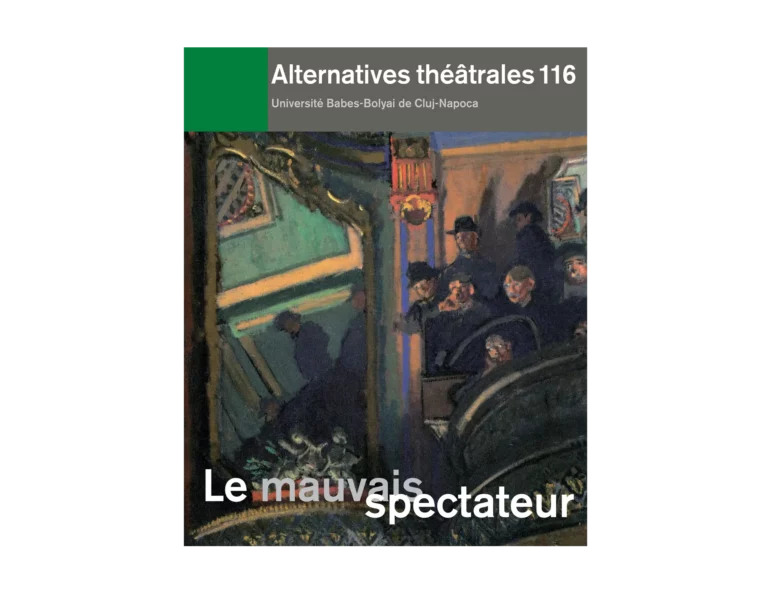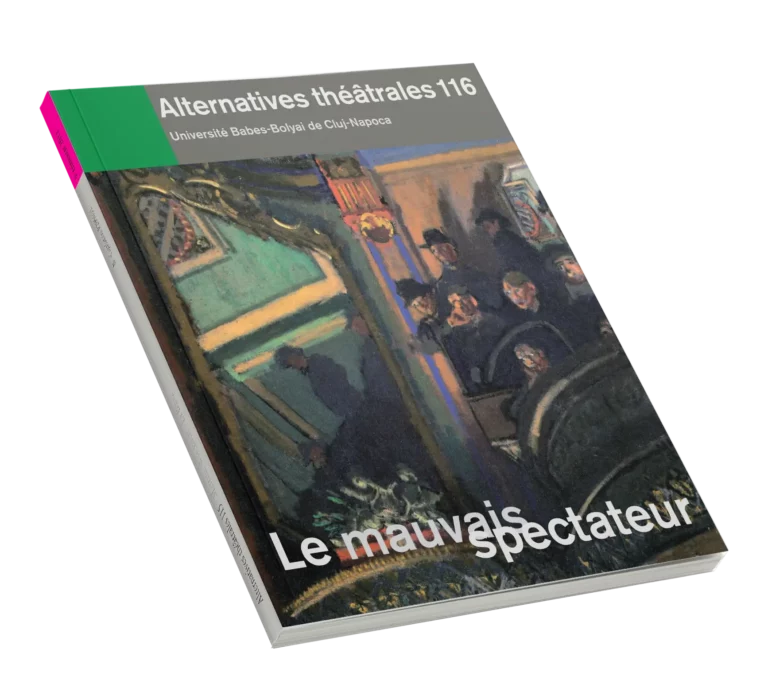En mémoire de Masao Yamaguchi, ami et penseur, au carrefour du Japon et de l’Occident
DE L’ORIENT j’ai épuisé la séduction, me disais-je ces temps derniers. Impossible d’aller plus loin, le savoir je l’avais consulté et désormais je craignais de m’y perdre à force d’avancer et de ne plus retrouver le chemin du retour. Je me repliais sur l‘acteur européen… Par ailleurs, les performances hybrides proposées par des acteurs asiatiques s’attaquant aux grands rôles ne cessaient pas de décevoir, réductions abusives à un arsenal de moyens stéréotypés : en particulier LE ROI LEAR suscita de pareils exercices qui semblaient, malgré eux, attester la difficulté du mixage envisagé. Ratages nombreux à l’exception d’un extraordinaire TITUS ANDRONICUS mis en scène par Masahiro Yasuda, artiste japonais, découvert à Sibiu.
Il procédait à un déplacement poétique d’une culture à l’autre et écartait la grossièreté des greffes rapides, sommaires, déplorables. Ici la violence shakespearienne – l’extrême violence – se trouvait tempérée par l’usage d’un répertoire de signes codifiés, nullement explicites, qui préservaient les distances entre les personnages et imposaient l’absence de tout contact physique. Cruauté cérémonielle… cruauté accomplie par des protagonistes tous de blanc vêtus, cruauté lente et troublante, cruauté fantomale. Chorégraphie au ralenti, sans sang ni cri, ce TITUS surgissait entouré de l’aura étrange d’une blancheur immaculée, signe de deuil au Japon, TITUS qui restituait moins un récit qu’il ne dressait le paysage mental du crime. Violence lente, presque dansée, la violence d’un monde ancien ressuscité en notre présence, monde immobilisé dans la lumière laiteuse de l’aube, l’heure des meurtres et des arrestations. Ce kabuki transfiguré sauvegardait son origine et en même temps se montrait comme étant « reconstruit » pour ce texte hors-normes dont il excluait les manifestations extérieures de carnage et de vengeance barbare. Par ce travail contraire à l’attente, réfractaire à la redondance scénique, ce TITUS reste unique. Le Kabuki, d’ordinaire expert en violence, venait apaiser ici grâce à Masahiro Yasuda les excès de cette œuvre « première » dont Peter Brook, dans les années 50, révéla, avec génie, l’obscurité criminelle. D’autres le suivirent, en surenchérissant cette approche « sanguinaire », sans saisir que le théâtre s’arrête à « la limite du sang », sang suspect sur un plateau, sang frappé de soupçon, et, pour l’écarter enfin, il a fallu que cet artiste japonais fournisse la version de TITUS en noir et blanc. Et GUERNICA n’est-elle pas l’expression la plus intense des horreurs de la guerre parce que restée en noir et blanc sur les conseils de Malraux ?
À Craiova – décidément la Roumanie s’ouvre au Japon ! – un HAMLET du groupe Ryutopia ayant pour metteur en scène Yoshihiro Kurita confirma, lui aussi, la communication possible de ces cultures théâtrales, orientale et occidentale, radicalement différentes, étrangères l’un l’autre, mais seulement lorsqu’un grand artiste s’empare. Le Nô, on le sait, ne s’accomplit jamais au présent, il est la remémoration du waki, l’homme du coin, qui ranime des personnages et s’immerge dans la mémoire des faits anciens. Histoire d’un retour… d’un passé « perdu et retrouvé ». Le waki convoque ses souvenirs qui s’incarnent et s’animent, en empruntant le fameux pont hashigakaripour s’exposer sur le miroir du plateau bordé par des cèdres et des piliers en bois noble. Dans le spectacle de Craiova, le prince Hamlet se voit attribué le statut d’un waki, témoin qui réactive les faire et gestes de jadis, qui se consacre à la remémoration de son drame. Si son ancêtre japonais reste immobile dans « le coin », le prince tantôt s’isole, tantôt participe aux événements, il est également récitant et participant. Et ainsi le spectacle tout entier allie l’exercice de résurrection des faits anciens et les agissements actuels du prince. Confusion des durées… inoubliable Nô shakespearien !
Une ultime révélation récente. À Cluj, en Roumanie, de nouveau, lors du festival Interférences, nous sommes nombreux à avoir éprouvé le sentiment réconfortant et rare d’une révélation. Nous étions conviés à une représentation de MUTTER COURAGE de Brecht dans une version coréenne. Soupçonneux, en raison de tant d’échecs déjà évoqués, je me suis rendu au théâtre sur la pointe des pieds. L’étonnement fut d’autant plus grand. La proposition, ici, consiste non pas de « jouer » MUTTER COURAGE, mais de la « raconter » en réalisant ainsi la version unique du théâtre épique tant désiré par Brecht. Pour cela, Lee Jaram, une belle, très belle chanteuse/ danseuse de pansori, l’opéra traditionnel coréen, prend à bras le corps l’œuvre toute entière, accompagnée par un orchestre de rock, choc des extrêmes. La chanteuse esquisse des manifestations rapides, économes d’identification, comme d’ailleurs Brecht le souhaitait, pour passer avec célérité d’un personnage à l’autre ou s’attarder afin de décrire des paysages et des accessoires, des champs de bataille dévastés ou l’égarement des soldats affamés. Elle se convertit en Shéhérazade qui prend son temps, ne se presse jamais, se livre à des détours, ralentit ou accélère selon une logique de conteuse soucieuse de restituer un milieu, de crayonner des caractères, de raconter des événements. La musique intervient pour prendre parfois le relais, mais d’une manière plus souple que Brecht l’avait envisagé, car ici Lee Jaram chante, danse, fait revivre des êtres, déplore leur sort grâce à des lamentations excessives sans pour autant dissocier mécaniquement al parole de la musique. Elle reste épique tout y injectant un lyrisme excessif et maîtrisé ! « Monologue choral » – oxymore de ce spectacle unique.