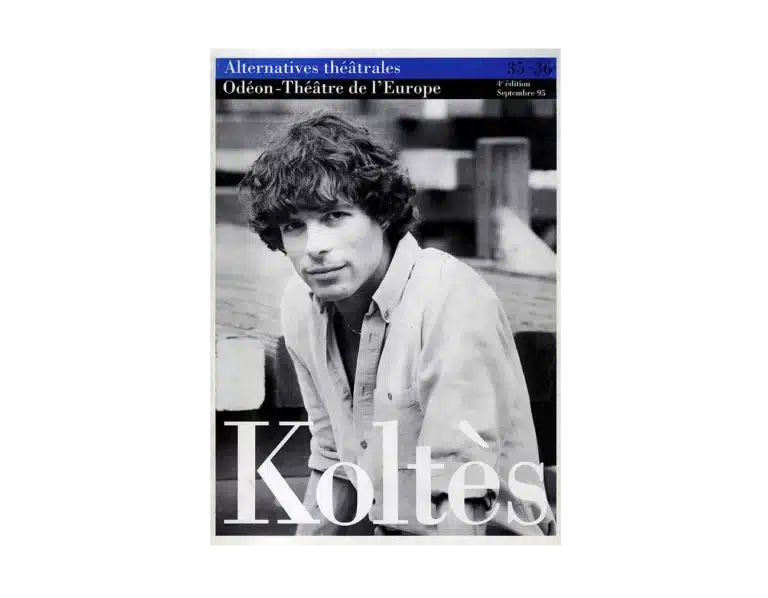Personnages :
Maïmouna,
Sœur aînée
Petit Abou,
Cadet
Iarley Davidson,
Moto
La cour intérieure d’une maison.
Onze heures du soir.
Quarante degrés.
MAÏMOUNA
Pourquoi tu ne sors pas, la nuit, quand tous les garçons de ton âge sont déjà dans la rue en chemise, avec le pli du pantalon bien repassé, et qu’ils tournent autour des filles ? Tout Tabataba est dehors, tout Tabataba est bien habillé, les garçons draguent les filles et les filles ont passé le jour à se coiffer et moi, mon frère a de la graisse plein les pattes et il bricole sa machine. Honte sur moi, on va croire que je ne sais pas repasser les chemises.
Si, le matin, au lieu de démonter le moteur de ta machine pour le remonter le soir, si tu me donnais ta chemise à laver, ta veste à repasser, le bouton de ton pantalon à recoudre, je ne serais pas humiliée le soir quand les autres garçons viennent et demandent : où il est, petit Abou, où est-il, ton frère, où est notre copain, que l’on sorte avec lui ? Quelle honte, pour moi. Il est là, dans la cour, avec les chiens et les vieilles et les poules, avec un vieux chiffon dégueulasse à la main. Lave ta tignasse ou je te gifle ; fais-toi des locks, des tresses, rase-toi le crâne ; donne ta chemise ; cesse d’être ma honte, le soir, quand les voi- sines viennent, avec leur air de pimbêches, Fatoumata surtout, et qu’elles demandent : et ton frère ? où donc est-il, notre chéri ? où il est, petit Abou ? Qu’est-ce que je peux répondre, moi?: il est dans l’huile de moteur, il sent la vieille machine, il manque des boutons à son pantalon ? Honte sur moi.
Lâche ce chiffon, sors la tête du cul de cette machine. Crois-tu qu’une fille accepterait de in on ter là-dessus, alors qu’elles passent tout l’après-midi à se coiffer ? Cela ne te sert même pas à sortir, cela te sert à rester. De quoi j’ai l’air, moi, avec mon frère crasseux au milieu des vieilles femmes, penché sur sa machine à l’heure où tout le monde est dehors ? De quoi ai-je l’air, à cette heure du soir et par cette chaleur, où tu de- vrais être en train de boire de la bière dans les maquis, où tu devrais être en train de tourner autour de ces pimbêches de voisines ? Tu es le déshonneur de cette cour.
Une sœur aînée est responsable de son frère. Je t’ai appris à te laver, je t’ai assez lavé moi-même, négrillon, torché, baigné, plongé dans la bassine et maintenant, tu as les mains blanches de crasse et tu sens la bête ; tu me salis la robe rien qu’à te regarder, j’en ai marre d’être ta sœur et je vais te gifler. Il est l’heure, il fait chaud, dis-moi où est ta chemise, lais- se-moi te coiffer et je t’aspergerai de Soir de Paris. Lève la tête, petit Abou. Une sœur dont le frère ne sort pas est la risée de ses voisines ; une sœur dont le frère n’est pas un homme n’est pas une femme. Dehors, ma honte et mon humiliation, cours les rues de Tabataba, honore-moi : bois de la bière et baise les filles.
PETIT ABOU
Je ne veux pas marcher dans les rues de Tabataba, elles sont pleines de merdes de chiens ; je ne veux pas boire de la bière dans les maquis, elle n’est même pas froide et elle est trafiquée.
Je n’aime pas les voisines, elles sentent la poule, je n’aime pas comme elles se coiffent et s’habillent, je les préfère le matin quand elles préparent le repas. Et dès qu’il commence à faire nuit, je n’aime plus mes copains. J’aime ma moto et mes pattes pleines de graisse, et le chiffon sale ; je préfère mon pantalon sans bouton et ma chemise froissée ; j’aime la vieille cour et les vieux et les chèvres ; une chèvre sent la chèvre, je ne veux pas sentir la poule, je veux sentir mon odeur à moi, je veux choisir ma saleté et rester dans la cour. Laisse mes copains tranquilles et oublie les voisines. Ne reste pas là, je n’ai pas besoin de toi. Ne me regarde pas comme cela, comme si tu allais me donner un bain ou une gifle ; je ne suis plus un négrillon, je suis trop grand, je ne vais pas monter sur ton dos. Va-t-en, Maïmouna ; quand il fait si chaud, cela me donne envie de tuer.
MAÏMOUNA
Pour qui te prends-tu, petit merdeux, pour croire que tu peux braver la nature ? Je ne te demande pas ce que tu aimes, je ne te demande pas ce dont tu as envie. Même les pierres s’ ac- couplent entre elles, tu n’y échapperas pas. Même si tu n’en as pas envie, sors quand même ou je te donne des gifles.
Tu restes là, à fumer comme une putain à l’interrogatoire. Qui t’a appris à fumer tout seul ? Un homme peut fumer dans les maquis, en buvant de la bière et en tripotant les filles, mais quelqu’un qui fume tout seul est un vicieux ; honte sur moi, on va croire que c’est moi qui t’ai rendu vicieux, on va croire que je n’ai rien su t’apprendre de la vie, on va croire que je n’ai pas rempli mes devoirs de sœur aînée.
Et pourtant, quand tu étais petit, j’en ai passé, des soirs, à te donner des gifles et à tout t’enseigner, à bien te préparer, à t’expliquer les femmes, tu m’avais l’air de comprendre. A sept ans, je t’ai fait le dessin sur ton cahier d’école, je t’ai même laissé me toucher pour que tu ne sois pas trop surpris la pre- mière fois ; je t’ai bien expliqué : c’est ici, c’est comme ça, de- dans, dehors, c’est tout, c’est simple, l’homme, la femme, la vie, tout le bordel, il n’y a rien d’autre à apprendre, il n’y a rien d’autre à savoir. Tu avais l’air d’avoir compris ; honte sur moi, tu n’as rien compris du tout. Et à l’heure où tu devrais être dehors à te frotter avec les voisines, tu es dans la cour avec les vieux et tu frottes cette machine. J’aurais dû te donner davantage de coups. J’aurais dû me méfier. J’aurais dû me douter que tu étais vicieux. A l’âge où les garçons vont reluquer les filles quand elles se baignent, toi, je m’en souviens très bien, tu préférais monter à l’arrière des camions pour respirer les gaz d’échappement, et tu rentrais à la maison en toussant, avec le mal de tête, drogué comme un Américain. Et maintenant je peux pleurer : il est trop tard. Tu restes dans ton coin avec le vice, tu me laisses dans le mien avec le déshonneur.