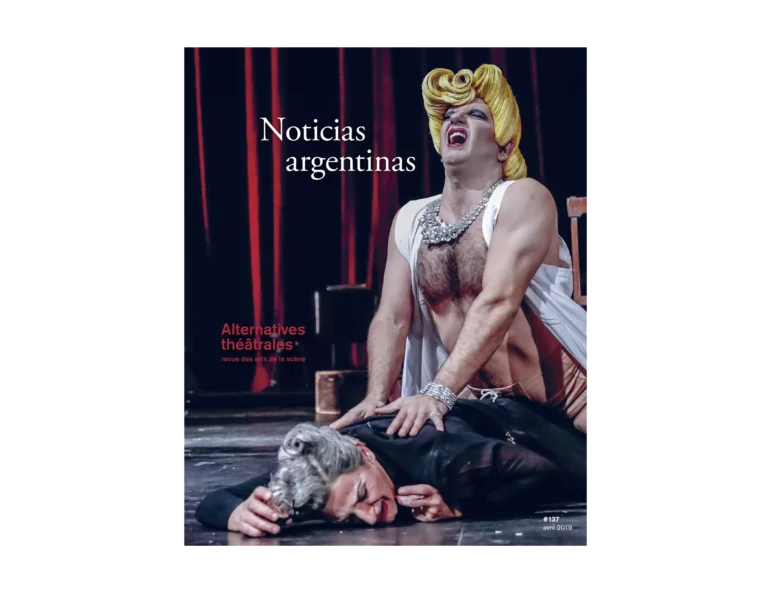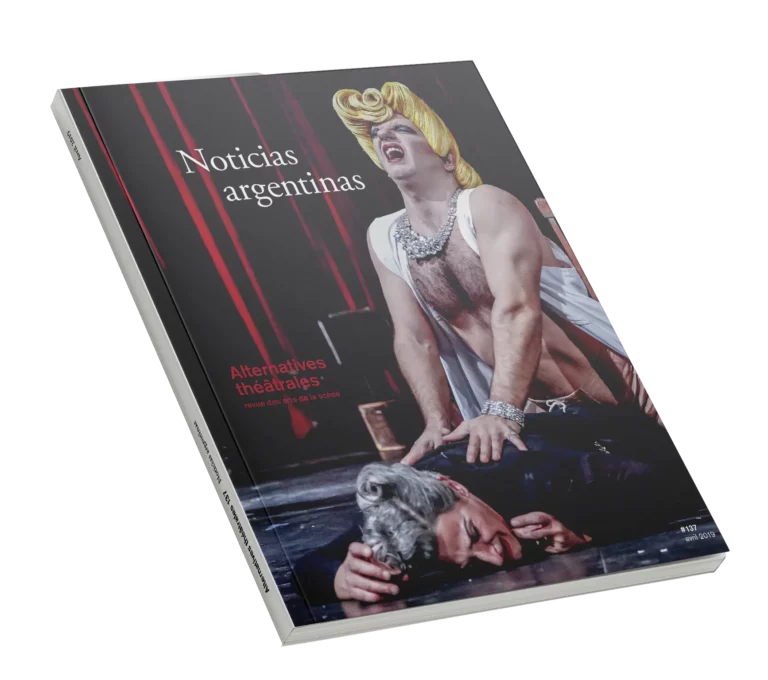Le théâtre s’avère un des événements sociaux, politiques et culturels les plus pertinents d’Argentine. C’est un des patrimoines tangibles et intangibles, mobilier et immobilier, les plus évidents du pays. Buenos Aires est considérée comme une des grandes capitales théâtrales du monde hispanique. On y crée chaque année en moyenne 2000 spectacles théâtraux de divers types ; on y compte plus de 250 salles en fonction dans les circuits officiel, indépendant et commercial, auxquelles il faut ajouter environ 400 espaces moins conventionnels où se donnent des représentations (centres culturels, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, prisons, commerces, rues et places publiques, bars, maisons particulières, etc.).
Buenos Aires possède une philosophie unique du théâtre, qui s’exprime le mieux à travers la production du « théâtre indépendant » (apparu en 1930), dont l’éthique le situe délibérément à la marge de la production nationale (c’est-à-dire réalisée grâce à des subventions d’État) ou de la production commerciale (soutenue par les fonds privés des producteurs). Buenos Aires révèle par ailleurs une activité fournie sur le plan théâtral élargi : enseignement, organisations syndicales, législation et soutien officiel, festivals et tournées, publications, critique, recherche et théorie, universités, centres de documentation, archives et musées, sans compter l’échange vers l’international ou l’accueil de grandes compagnies étrangères… Buenos Aires est un gigantesque « laboratoire théâtral ». S’il s’agit donc du principal centre théâtral du pays, ce n’est pas pour autant le seul. Il n’existe pas « un » théâtre argentin mais bien des théâtres argentins, aux racines différentes. Il suffit pour cela de se figurer la diversité des régions du pays du nord au sud et de l’est à l’ouest et des connexions transfrontalières avec autant de pays limitrophes. Une cartographie multipolaire, une polyphonie théâtrale.
Comment dès lors synthétiser quelques tendances dominantes dans un contexte aussi complexe et multiple ? Nous en détaillerons ici quelques-unes propres au Buenos Aires contemporain.
Restauration néolibérale et appauvrissement
La première décennie du XXIe siècle fut caractérisée par la crise du néolibéralisme. La période 2001 – 2015 fut ainsi qualifiée de post-néolibérale. Cependant, l’arrivée au pouvoir du président Mauricio Macri (décembre 2015) permet de parler d’une restauration néolibérale aux composantes idéologiques conservatrices. Depuis 2016, les politiques nationales se caractérisent par la réduction des interventions de l’État, la militarisation croissante, la concentration accrue de la richesse et des moyens de communication, l’inégalité de classes, l’augmentation de l’économie strictement financière ayant comme conséquence la fuite des capitaux, l’augmentation de la dette extérieure et la soumission au FMI, la chute du marché intérieur et de l’industrie nationale, l’augmentation des importations et des privatisations, le démembrement des structures nationales d’éducation, de santé et de culture, qui s’ajoute à l’inflation croissante, la récession et l’augmentation astronomique des impôts.
Ces politiques affaiblissent sans aucun doute la production théâtrale, réduite en quantité et plus pauvre encore en moyens. Sebastián Blutrach, l’actuel président de l’Association argentine des producteurs de théâtre (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales – AADET), avançait le bilan suivant de l’année 2018 lors d’un récent entretien :
« La forte chute se fait sentir à partir d’avril. En septembre 2018, le volume global de specta- teurs avait baissé de 25 % par rapport au mois de septembre 2017, et octobre 2018 enregistre un recul de 7 % par rapport à octobre 2017. Ce qui nous préoccupe le plus est la chute des recettes de billetterie, qui fut en septembre 2018 de 32 % par rapport à septembre 2017, soit près de 70 % de perte réelle si on y fait porter la forte inflation annuelle. En octobre, nous sommes à 17 %, soit 30 % en réel [avec l’inflation].
Cette baisse de public a comme conséquence une programmation plus conservatrice [du théâtre commercial], où dominent les comédies et les distributions connues. Il nous est aujourd’ hui impensable d’avoir trois Arthur Miller et un Tennessee Williams comme c’était le cas en 2011 à l’affiche du théâtre commercial. Cette baisse de fréquentation entraîne également la coexistence de différentes productions dans la même salle, avec moins de représentations par semaine pour chacune, et donc avec moins d’exigence en termes de volume de public. Les spectacles [du circuit commercial] ont en ce moment une moyenne de survie qui approche les 800 spectateurs par semaine, tandis que la moyenne normale tournait plutôt autour de 1500 afin d’assurer la reprise. Les salles y parviennent en ouvrant deux propositions plutôt qu’une. »
- Terme employé en Argentine et dans quelques autres pays d’Amérique latine pour désigner un type de manifestation publique dont l’objectif est de dénoncer une personne ou une institution en lien avec des actions non traitées par la justice. ↩︎
- Action politico-théâtrale de rue qui a lieu devant les voitures à l’arrêt à un feu rouge (Ndt : qui se dit semáforo), de durée brève (correspondant à la durée du feu commandant l’arrêt). ↩︎
- Beckett, Samuel, 2014, Lettres, 1929 – 1940, Paris, Gallimard. ↩︎
- Cabanchik, Samuel, 2000, Introducciones a la Filosofía, Barcelona, Gedisa y Universidad de Buenos Aires. (notre traduction) ↩︎
- Ndt : Site web de référence en Argentine et à Buenos Aires concernant l’actualité de la scène, reposant en partie sur une dimension collaborative en termes de publication de calendrier, historique des spectacles et recensions critiques. L’homonymie avec cette même revue étant un hasard heureux. ↩︎