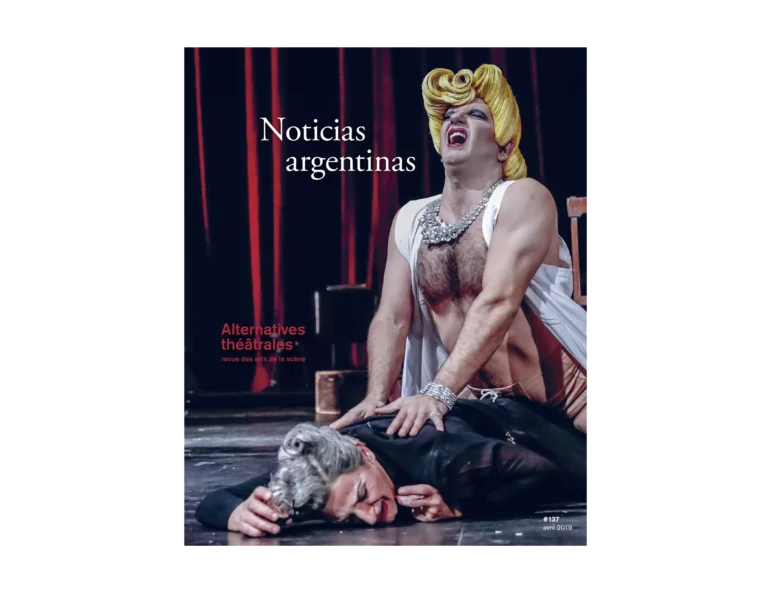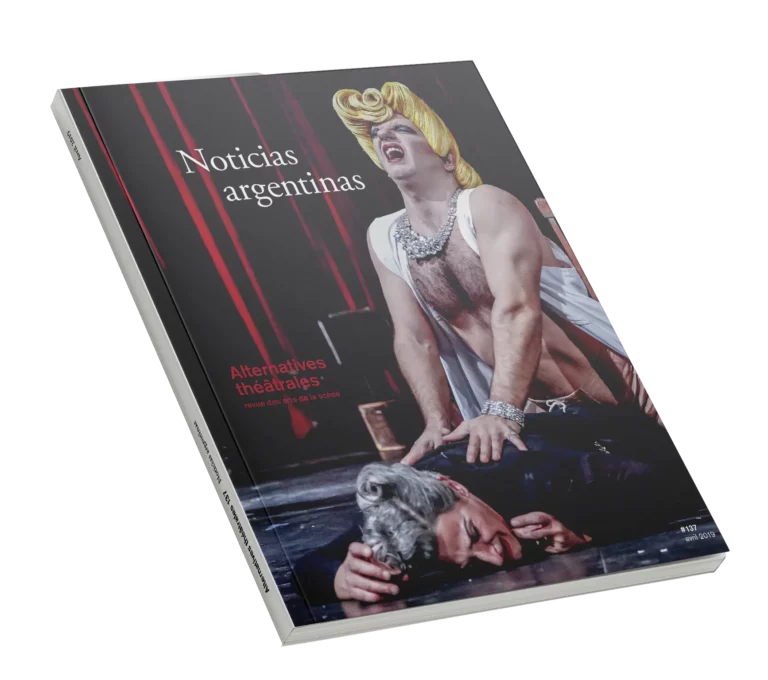Fabián Díaz, Los hombres vuelven al monte et Pato verde
Camila Fabbri, Condición de buenos nadadores
Ariel Farace, Constanza muere
Andrés Gallina, Los días
de la fragilidad
Giuliana Kiersz, B et El fin
Lucas Lagré, Nadar Mariposa
Eugenia Pérez Tomas,
Las casas íntimas
Des paroles argentines alternatives
À la lecture de certains textes sélectionnés pour ce cahier de textes inédits, une des tendances dramatiques qui se dégage consiste à faire de la parole le cœur de l’action. Parler, dire, raconter devient l’évènement fondamental à l’origine de plusieurs de ces pièces. Ici, les discours des personnages semblent plus importants que ce qu’ils font et les faits laissent place à leur propre narration. La parole devient la principale responsable du déploiement de la fiction et l’intermédiaire privilégié, si ce n’est exclusif, de son auditoire.
Autant d’univers qui explorent les pouvoirs de la parole selon des modalités qui leur sont propres. Du récit à la poésie, de la pièce monologuée au vers libre, des figures de narrateurs aux personnages polyphoniques, les stratégies se multiplient pour raconter autrement au théâtre. D’une pièce à l’autre, les codes peuvent être très différents : le réalisme d’une conversation, la dimension merveilleuse d’un conte ou encore des éléments propres à une fiction spéculative. Le déploiement des paroles peut varier de quelques paragraphes à plusieurs dizaines de pages. Ainsi, l’identification d’un geste commun dans ces textes immédiatement contemporains ne remet pas en question la diversité à l’œuvre dans le théâtre argentin. Cette diversité semble en effet la caractéristique des théâtres post-dictature depuis 1983, comme Jorge Dubatti l’a largement théorisé sous le nom de « canon de la multiplicité ».
Sans proposer ici une généalogie de ce geste commun, qui resterait à faire plus précisément au regard du théâtre argentin plus ou moins récent, il est néanmoins possible de voir un lien avec des pratiques qui sont omniprésentes en Argentine depuis les années 1980. Nous pensons au genre de l’unipersonal, ou soliloque en français, qui se retrouve sur les scènes du théâtre indépendant tout autant que celles du circuit commercial. Il aborde principalement les sujets de l’intime et joue avec les codes de l’autobiographique en laissant une grande part au récit de soi. Nous pensons également à la narración oral qui peut relever à la fois du conte, du mythe voire de l’humour dans une même parole et qui traverse aujourd’ hui toute la scène latino-américaine en reprenant des traditions orales plus anciennes. Qu’elles soient liées à la paupérisation des moyens de production du spectacle en Argentine, qui oblige à des formes plus minimalistes, ou à un véritable besoin dramaturgique de raconter, ces pratiques vont crescendo et ne sont pas sans influencer les écritures contemporaines.
Il est intéressant par ailleurs d’évoquer les recherches développées en Belgique, en France et au Québec sur la parole au théâtre depuis les années 1980 qui entrent en résonance avec les textes abordés ici. Ils contribuent en effet aux expérimentations menées, depuis quelques décennies déjà, par nombre de dramaturges en Argentine comme ailleurs et qui consistent à renouveler les fonctions de la parole au théâtre par rapport à des pièces de facture plus classique. Les paroles alternatives argentines en question dialoguent particulièrement bien avec des notions comme celle de « théâtre des paroles » de Valère Novarina, de « pièce-paysage » de Michel Vinaver, de « théâtre de conversation » de Jean-Pierre Ryngaert ou encore de « théâtre des voix » de Sandrine Le Pors. Les effets de cette parole démiurgique sur les éléments du drame canonique sont de fait comparables dans les différentes aires géographiques : la démultiplication de l’adresse à mesure qu’elle devient incertaine, le dérèglement de l’appareil didascalique entre absence, surabondance et contamination de la parole, l’indétermination de l’espace-temps tributaire de ce qu’il va en être dit ou encore l’hybridation exponentielle du lyrique et de l’épique avec le dramatique.

Cependant, parmi les textes argentins, certains éléments résistent à la comparaison. D’une part, quand Sandrine Le Pors identifie pour des textes français un « retrait du personnage dans sa parole1 » au point de disparaitre en tant que sujet, cela ne semble pas complètement le cas dans les textes argentins. La construction de subjectivités, aussi chaotiques et fragiles qu’elles soient, reste en effet une des perspectives principales des écritures abordées dans cet article. Depuis les expériences fondamentales que font les personnages de l’enfance, la famille, l’amour ou encore l’histoire et la mort, ceux-ci nous partagent avant tout leur condition d’humanité. D’autre part, le rapport entre action et parole ne relève pas de la même radicalité dans les textes argentins que ceux étudiés par Jean-Pierre Ryngaert qu’il qualifie de « textes dénués d’intrigues et d’actions, où c’est la parole et elle seule qui est l’action2 » . Quand les auteurs argentins nous font le récit d’un amour impossible, des conséquences de la guerre sur les hommes ou encore de la fin du monde à venir, ils montrent leur attachement à cette capacité du théâtre à raconter des histoires et à représenter le monde tout en renouvelant ses formes. Dans ce sens, les dramaturgies politiques latino-américaines actuelles, l’expérience de la postmodernité et son corollaire postdramatique sur les scènes dans cette région n’ont pas fait table rase du désir d’un théâtre en prise avec son présent.
Il s’agit donc d’aborder plus précisément neuf pièces qui donnent à voir autant de désirs de parole dans la dramaturgie argentine actuelle. Nous pourrons constater comment les moyens et les formes de ces explorations des pouvoirs de la parole varient d’une pièce à l’autre tout en identifiant les principaux enjeux qui s’en dégagent. Ces enjeux correspondent à trois axes principaux de réflexion que nous avons résumés ainsi :
– se raconter
– raconter le monde
– raconter l’ailleurs.
Se raconter
- Le Pors, Sandrine, Le théâtre des voix : à l’écoute du personnage et des écritures contemporaines, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 4 – 56. ↩︎
- Ryngaert, Jean-Pierre, « Représentations de la parole », in Nathalie Sarraute et la représentation, sous la direction d’A. Rykner et M. Gosselin, Roman 20 – 50, 2005, p. 81 – 88. ↩︎
- Expression empruntée à Sandrine Le Pors dans Lethéâtre des voix : à l’écoute du personnage et des écritures contemporaines, op.cit. ↩︎