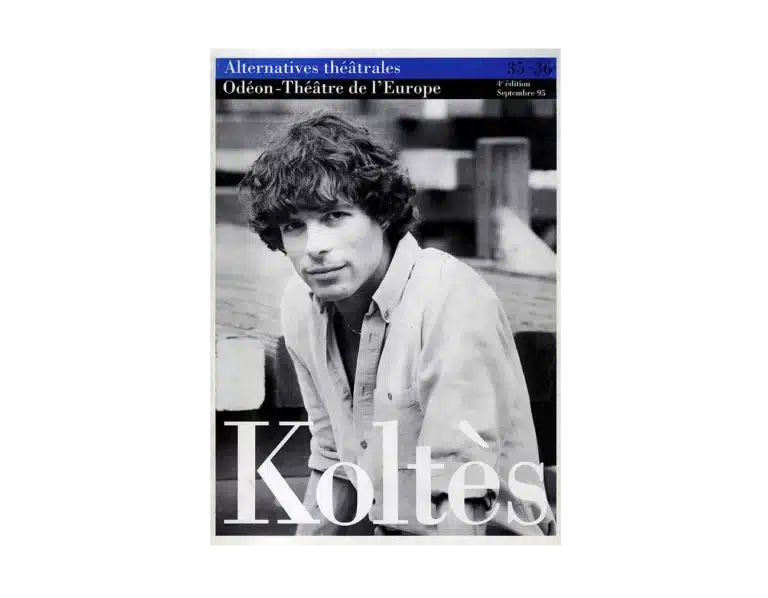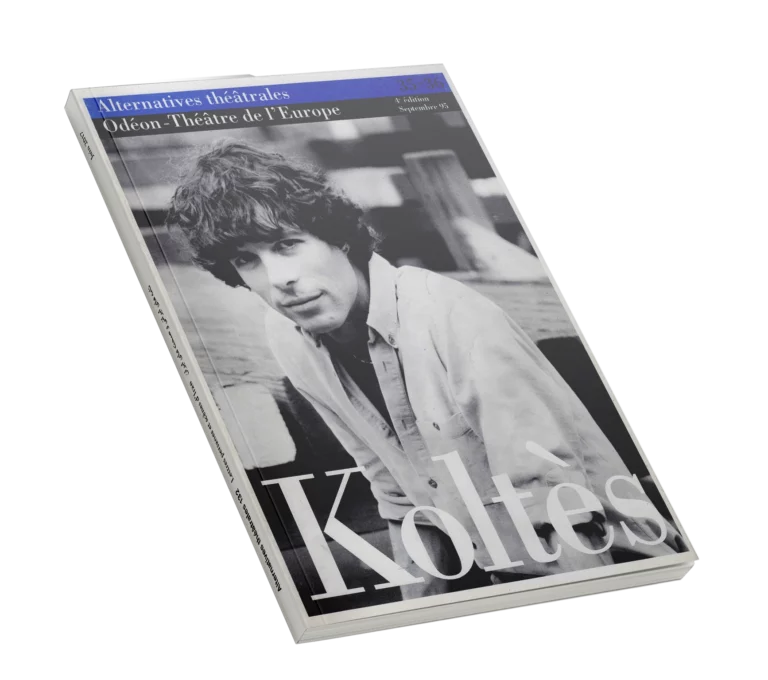Mon premier choc a été Casarès dans Médée. C’est ça qui m’a fait écrire. elle m’a inspiré des rôles. Elle a joué dans QUAI OUEST, et je m’en mords les doigts, parce que, pour quelqu’un comme elle, il faut écrire un grand rôle sur mesure, une pièce où elle est pratiquement seule. Je vais écrire une pièce pour Casarès, quelque chose que je prendrai dans le livre de Job.
Bernard-Marie Koltès
Serge Saada : Vous avez lu à France Culture un des premiers textes de Koltès L’HÉRITAGE. Vous interprétiez le rôle d’Anne Agathe. Puis, vous avez joué au théâtre le rôle de Cécile dans QUAI OUEST. Comment s’est passée votre rencontre avec Bernard-Marie Koltès et avec ses textes ?
Maria Casarès : J’ai eu des rapports étranges avec Koltès. Finalement, nous nous sommes peu rencontrés. Il s’est développé entre nous un rapport mystérieux fait de petites touches. Un rapport pudique et en même temps très privé, très intime, comme si on se connaissait déjà et qu’on n’avait ainsi que des petits mots à se dire. J’avais avec Jean Genet des rapports semblables, même si je le connaissais un peu mieux. Avec Koltès, c’étaient des relations de grande amitié, un respect subtil et discret fait de soin et d’attention à l’égard de l’autre. Tout cela construit des rapports très rares et très forts.
On s’est rencontrés au moment où j’ai joué dans QUAI OUEST, mais aussi avant. Lorsqu’il a monté LEs PARAVENTS, Chéreau lui a demandé d’être là. Patrice s’entourait de gens pour avoir des avis différents et il lui a demandé de venir. C’est presque la première fois que j’ai rencontré Koltès. J’avais tout de suite l’impression qu’on s’était connus depuis toujours. Je me souviens que je lui ai dit : « Qu’est-ce que tu fais là ?» Il m’a répondu : « Chéreau m’a demandé de venir ». Je lui ai dit : « Tu devrais être chez toi à écrire » (rires) et il n’est plus revenu aux répétitions — Plus tard, pendant qu’on jouait QUAI OUEST, il venait de temps en temps et ce qui m’a beaucoup frappée chez lui c’est sa présence. On aurait dit un nomade qui passait, qui regardait avec bienveillance et avec une luminosité exceptionnelle. Il passait avec une sorte de sympathie de sentiment, peut-être de compassion, mais dans le grand sens du mot, c’est-à-dire qu’il souffrait avec les gens qui étaient là et qui travaillaient. Il accompagnait cela d’une telle légèreté qu’on se demandait où il « accrochait » sur terre. Quand on lui posait une question il pouvait y répondre, mais il évitait de nous dire des choses pour ne pas interférer dans le travail de Chéreau. Dès l’instant où c’était Patrice qui mettait en scène, il ne voulait pas y revenir.
Il intervenait quand il aimait beaucoup. Par exemple, je me souviens qu’un jour une scène qu’il a vue a totalement répondu à son appel. C’est la scène entre Isaach de Bankolé et moi, c’est-à-dire entre Abad et Cécile. Il l’a vue une fois et on a compris tout de suite qu’elle était telle qu’il l’avait imaginée ou rêvée. Il montrait son ravissement d’une façon très simple et en même temps on avait l’impression, ce qui est très rare, qu’on n’avait pas besoin de recommencer à être aussi juste. Il l’avait vue une fois et ça comptait pour toujours.
Je crois que Koltès est un baladeur, un errant qui regarde dans les confins des villes, dans les confins du monde, les endroits les plus éloignés, les plus perdus.A mon avis, ces confins vont devenir le centre du monde. L’Europe qui était le phare de l’humanité a vu les extrémités du monde s’implanter au centre et j’ai la profonde impression que dans ses pièces il place au centre tout ce qui était à la périphérie. En fait, le centre s’est momifié et c’est la circonférence qui commence à vivre, à entrer dans le centre, à le faire vivre et à devenir le centre. QUAI OUEST serait maintenant au centre de la ville. Ce n’est pas dit, ce n’est pas explicité, mais je crois profondément que dans notre monde, dont les valeurs, les places et les lieux sont bouleverses. QUAI OUEST se situerait, par exemple, à la place de la Concorde ou plutôt à la place de la Place de la Concorde.
S. Sa. : Koltès disait, en parlant de ce quartier de QUAI OUEST, qu’il est comme le carré d’un jardin qu’on a oublié d’entretenir et où les plantes ont poussé différemment.
M. C. : Oui, et comme les plantes poussent d’une façon différente, elles poussent vivantes, pendant que dans les jardins trop faits. les belles plantes finissent par être sclérosées.
S. Sa. : Dans QUAI OUEST. Cécile parle trois langues : celle du quartier de Quai ouest, l’espagnol et le quéchua. Avant de s’éteindre, elle parle quéchua. Que pensez-vous de cette mort en quéchua ?
M. C. : Quand on lit le rôle de Cécile, c’est une chose qui saute aux yeux. Cette mort, c’est un retour en arrière, un vertige qui fait passer d’une langue à l’autre, pour arriver à la langue première : le quéchua. C’est une trouvaille absolument extraordinaire et d’une inspiration incroyable. On dit que quand on va mourir tout revient, tous les souvenirs de votre vie. Mais ce serait simplifier cette mort que de la réduire à cela, car ce que Koltès a écrit, ce n’est pas la vie de Cécile. Dans ces mots en quéchua, c’est toute sa lignée qui surgit ; et en remontant le temps ainsi, elle est repossédée par ses origines complètes.
S. Sa. : Comme si l’histoire de l’humanité revivait à travers elle ?
M. C. : En tout cas la sienne, son histoire, celle qui va jusqu’aux premiers Incas, avant même que l’Espagnol arrive (rires). Au début de la pièce, elle parle la langue de ce quartier et ce qui est fondamental revient peu à peu, d’abord c’est l’espagnol, et ensuite c’est le quéchua. Comme Cécile va mourir, elle revient en arrière et elle voit toute sa lignée.
S. Sa. : Koltès disait : « Les racines, ça n’existe pas. Il existe n importe ou des endroits. À un moment donné, on s’y trouve bien dans sa peau…». Pensez-vous que Cécile puisse se sentir bien quelque part ?
M. C. : Je crois que c’est une éternelle déracinée, comme on en voit partout dans le monde. Cécile ne peut prendre racine nulle part, tout comme les autres personnages de QUALOEST. Ce n’est qu’à la mort où elle remonte dans le temps que le problème est posé. Mais avant cette mort, elle s’occupe plutôt de l’instant présent. Ainsi, je ne pense pas qu’elle soit vraiment une bourgeoise comme elle le prétend devant Koch. Elle fait la bourgeoise, tout comme elle irait jusqu’à dire qu’elle est la fille d’un général. Tout cela pour faire la mondaine et pour jouer.
On m’a souvent parlé des grandes tirades que j’avais à dire dans ce texte. mais à mon avis ce ne sont pas des tirades.
La scène entre Abad et Cécile, c’est vraiment un monologue à deux. Abad ne dit rien, mais j’ai toujours l’impression que ce texte est écrit pour les deux personnages.
S. Sa. : Cécile a un rapport à la réalité qui est singulier. Elle semble dominer les éléments naturels. Quand elle rencontre Abad, « le hangar [est] traversé de rayons dorés » du soleil, et à la fin de la scène, quand elle le quitte, elle se tourne vers le plafond, elle dit « couché », et, « les rayons (…) perdent leur éclat ».
M. C. : Elle a un rapport naturel à la réalité. Elle parle avec le soleil, la lune, toutes les choses qui l’entourent. Si elle s’est civilisée pour pouvoir manger, elle est restée reliée à la nature. Il y a encore des personnages comme ça dans le monde. Des êtres près de la nature, des êtres qui sont en rapport avec la terre qui leur monte par les pieds. Ces personnages peuvent avoir des rapports avec les rochers, la lune, et il n’y a rien dans la natute qui leur soit étranger.
J’imagine que les personnages de Koltès ne peuvent être étrangers à tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge, que ce soit un chien ou un homme. À l’arrivée de cet étranger, ils se demandent si le nouveau venu peut leur servir pour continuer à vivre.
Les personnages de QUAI OUEST n’ont pas grand chose pour vivre et ils sont ainsi dépouillés des notions superflues que les sociétés très organisées imposent souvent.
Bien sûr, on ne pourrait pas vivre dans ces conditions, mais il y a encore beaucoup de personnages comme ça dans le monde et Koltès les met en scène.
S. Sa. : Dans ce rapport à la réalité, vous n’avez pas l’impression que Cécile ressemble à d’autres personnages du théâtre de Koltès, comme Alboury de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS ou le Dealer de DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON ?
M. C. : Oui, ces personnages prennent un lieu qui, en principe, n’est pas le leur et tout d’un coup ils le font vivre par des moyens en rapport direct à la réalité. Alors, dès que quelqu’un arrive dans ce lieu, il faut payer ; sinon, comment vivre… (rires). Dans QUAI OUEST, tout est très vivace.
Dans cette pièce, il y a presque trop de richesse et on devrait pouvoir s’arrêter comme dans un livre et retourner en arrière. Quand les mots passent, on a quelquefois l’envie de dire : revenez en arrière et recommençons. Il y a un beau contraste entre les habitants de ce quartier isolé et les deux étrangers, Koch et Monique, qui sont d’un autre monde et qui vont être complètement paumés dans cet univers qui leur est inconnu. Dès lors, il y a toujours des situations qui portent au rire : mais deux secondes avant on est dans le tragique le plus complet. D’ailleurs, on rit aussi du tragique et les gens qui portent en eux la tragédie éclatent de rire à un moment donné, sinon ils ne pourraient pas continuer, ils étoufferaient. Il y a toute une partie picaresque dans QUAI OUEST. C’est toujours tout pour vivre, tout pour continuer à vivre. Les personnages veulent à tout prix vivre le plus possible, là, et tout de suite. Parce que la mort est présente, ils prennent la vie comme une pomme et ils la mangent violemment. Un peu comme Dom Juan : c’est un personnage tragique, mais ça ne veut pas dire qu’il est sinistre ou solennel.
Dans QUAI OUEST, le tragique, cette espèce de besoin de vivre multiplié par cent, mis en rapport avec la vie et ce qui vous entoure, entraîne des situations comiques. Même si le fond est souvent tragique, je pense que les pièces de Koltès présentent des situations où il faudrait souvent rire. D’ailleurs, le tragique et le cocasse vont toujours bien ensemble. Si vraiment vous êtes dans un sentiment tragique et qu’il y a subitement quelque chose qui cloche, vous éclatez de rire.
Pourtant, dans la tragédie française, on ne peut pas vraiment rire. Dans celle de Shakespeare, oui.
S. Sa. : À la lecture du texte, on a l’impression que Cécile ressemble aux grands personnages shakespeariens. On pourrait l’imaginer avec une grande robe flottant au rythme de ses déplacements.
M. C. : Cependant la pièce était montée avec des petites robes et des petites jupettes (rires). Mais en fait je pense qu’on pourrait la voir ainsi et en tout cas pas seulement elle, mais aussi tous les autres personnages de la pièce.
S. Sa. : Que pensez-vous des désirs de ces personnages ?
M. C. : J’ai toujours pensé qu’ils veulent vivre là où ils sont et puis le reste du temps ils disent… ils se complaisent à dire… que l’avenir va être meilleur, mais ils n’y croient pas vraiment.
Les personnages de QUAI OUEST ne sont pas des rêveurs qui pensent à l’avenir, mais plutôt de grands cabotins qui se font du roman. Ils disent qu’ils vont faire ceci ou qu’ils vont faire cela, mais la vie ne leur permet pas vraiment de se coucher et de rêver. Ainsi, les arguments des personnages interviennent pour sortir du présent et leurs rêveries font plutôt partie du parfum de la vie.
S. Sa. : J’ai l’impression qu’on ne peut pas isoler QUAI OUEST des autres pièces de Koltès. Est-ce que vous percevez une cohérence dans son théâtre ?
M. C. : Oui, je crois qu’il y a une grande cohérence dans son œuvre. On dirait même qu’il y a un plan quelque part.
Il y a dans son écriture une rigueur qui est celle de la grande veine française, celle du plus pur style. Ses pièces offrent un mélange subtil de passion et de maîtrise ; tout cela s’enrichissant de ses errances et de ses voyages.
QUAI OUEST est un texte démoniaque parce qu’il est écrit d’une manière qui fait penser aux textes classiques, mais avec des virevoltes, des méandres, des allers-retours et encore des méandres qu’il faut toujours intégrer dans un grand mouvement d’ensemble. Il faut tout le temps revenir au grand parcours total, scellé, avec des tas de petites choses intérieures. Ainsi, quand on joue du Koltès, il faut être virtuose, mais assez pour oublier qu’on l’est. Il faut que ce soit clair pour ceux qui écoutent et il faut dire les phrases comme si on avait affaire à une tirade de Racine.
Koltès est un auteur qui me raconte des choses d’une telle manière qu’elles sont toutes neuves pour moi ; et même si elles sont neuves, j’ai l’impression de les reconnaître au fond de moi. C’est ce qui fait qu’on a cette sorte de sympathie poétique avec un auteur.
Koltès vous parle de choses que vous ne connaissez pas, ou alors que vous connaissez ; mais tout en les découvrant neuves et nouvelles, elles éveillent en vous des choses aussi anciennes que le quéchua. Pour arriver à le jouer et à le représenter pleinement, il y a encore à chercher.
Propos recueillis par Serge Saada
Et plus à l’ouest, en amont, le lieu de la ville monstrueuse mettait encore sa marque sinistre sur le ciel : une lourde pénombre dans le soleil, une lueur livide sous les étoiles. « Et ceci aussi », dit soudain Marlow, « a été l’un des lieux ténébreux sur la terre ».
Joseph Conrad