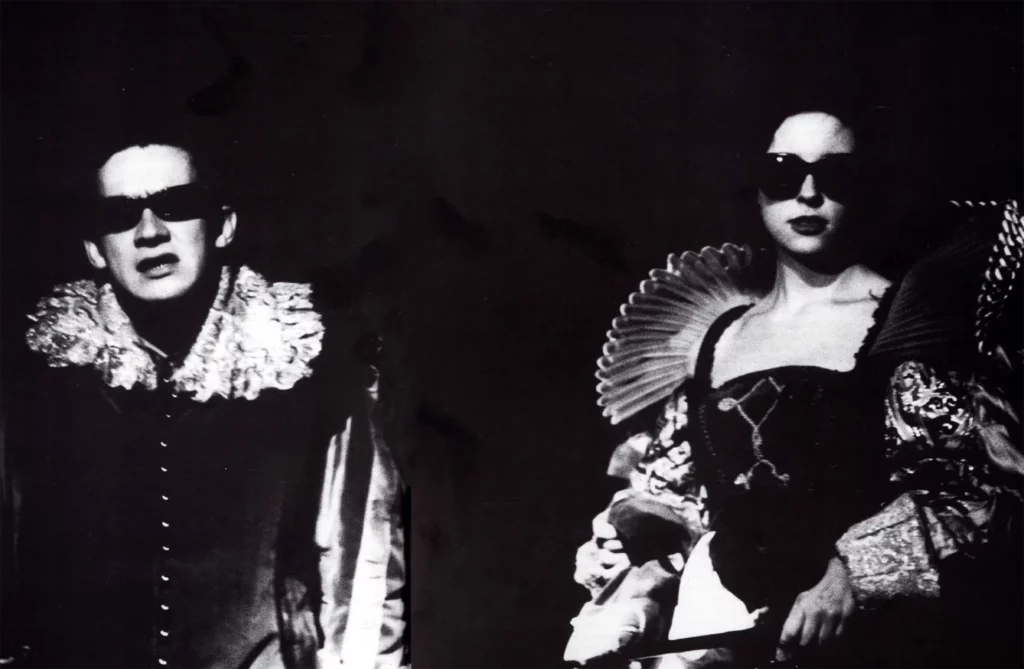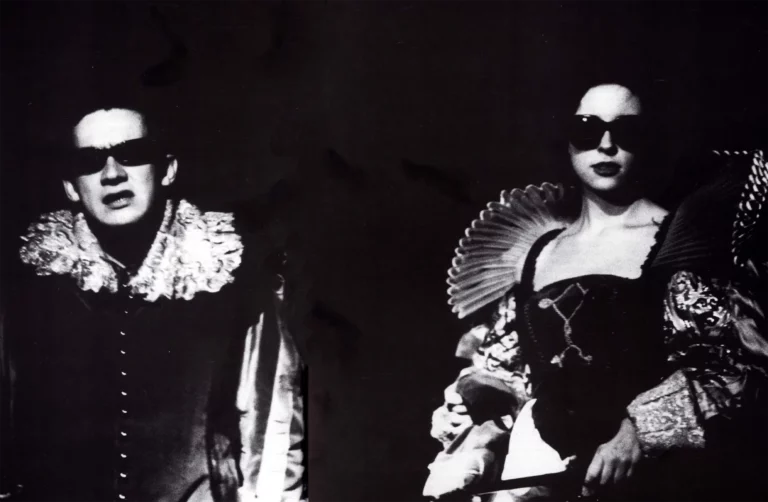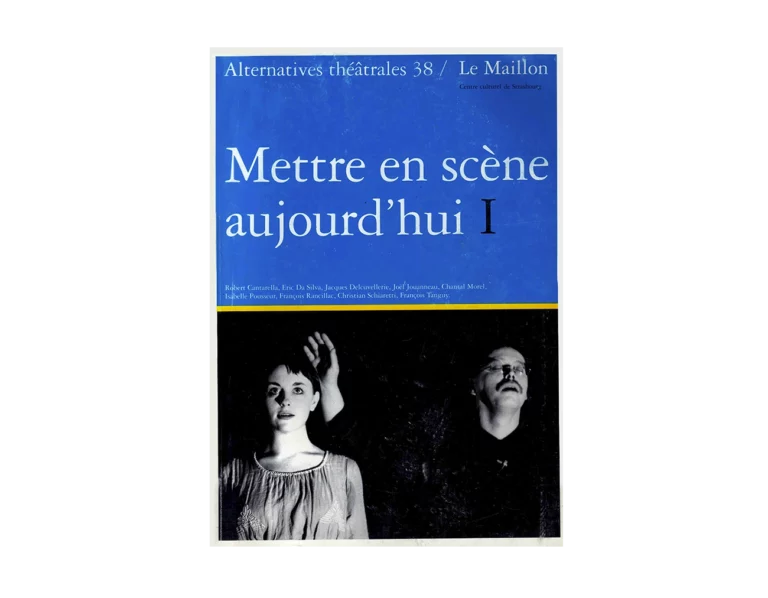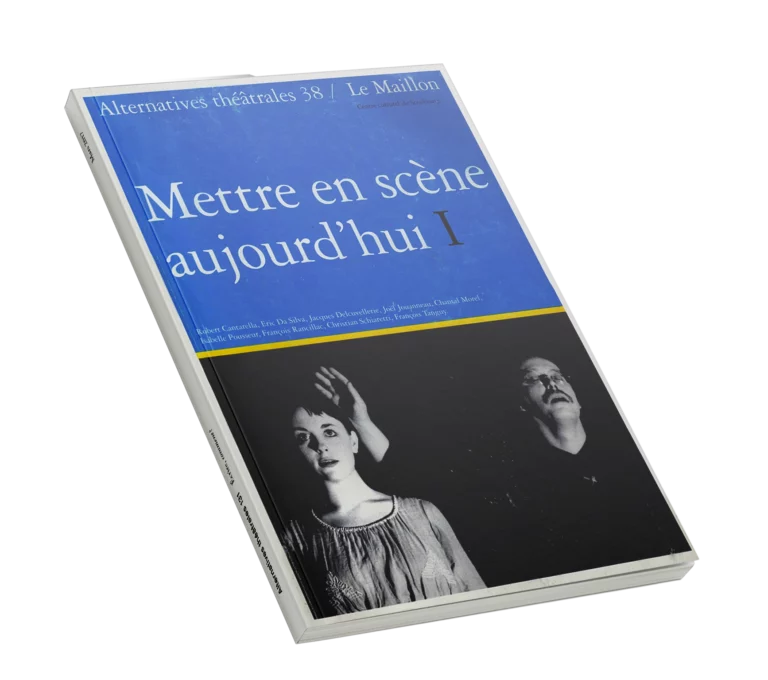Depuis la fondation du Groupeov, il y a juste neuf ans ce mois-ci, et jusqu’à KONIEC, j’ai toujours situé mon travail dans la problématique des Restes. Éric a décrit en son temps quelques aspects d’une machinerie du Reste, comme hypothèse de travail. Plus tard, pour moi-même, j’ai donné des bribes de justifications historiques (j’en ai toujours besoin !) à cette position. Il y aurait un “âge d’or” de la culture occidentale coïncidant avec l’aboutissement de la formation impérialiste et ses premières grandes secousses autodestructrices (± 1870 – 1930). De Marx à Freud, de Kafka à Eisenstein, de Joyce à Stanislavski, d’Armstrong à Duchamp, etc., toutes les aventures fondatrices du siècle émergent dans cet intervalle, qui connaît en même temps, en dépit de ses odieuses rares, la meilleure articulation entre l’éducation populaire (primaire et secondaire) et l’état réel des connaissances. Ensuite, il n’y aurait plus d’œuvres inaugurales mais seulement des déclinaisons, plus ou moins habiles ou sensibles, en même temps que le savoir s’éparpillerait définitivement en spécialités, que les pratiques artistiques contemporaines se coupaient de 95 % de la population, que l’enseignement se réduisait à un erratum incomplet des médias, et que la grande espérance d’une science de l’histoire chavirait.
Dans cet état, de surcroît, nous nous exprimions dans la forme artistique la plus archaïque, celle du “hic et nunc” irréductible, de la minorisation sans faille, quel que soit le genre (le théâtre n’a même pas, comme la musique, ses départements ‘pop’, le public du théâtre de boulevard n’atteint pas 0,5 % de celui de Michael Jackson), et enfin la forme qui vit le plus nettement cette marginalité sociale comme une perche de centralité – puisqu’il fut, avec l’opéra, le seul arc de la représentation que les sociétés se donnèrent d’elles-mêmes, de façon vivante, pendant des millénaires.
Au début des années 80, conscients de vivre dans cet amoncellement d’héritages désaccordés, nous avons d’abord refusé de “fonctionner” comme s’il n’en était pas ainsi.
La plupart de nos jeunes contemporains, plus ou moins ‘de gauche’ ou ‘de droite’, bricolaient gentiment les trouvailles de leurs prédécesseurs sans souci aucun des questions qui les induisirent. Nous avons maintenu l’exigence – au moins pour le théâtre – d’une vision du monde et d’une attitude fondée sur la pratique. Et comme cela semblait, justement, impossible, il nous fallait bien vivre sur la perte, sur l’hétérogénéité des restes, et sur ce qui en résulte : le sentiment du tragique et de l’urgence, puisque dans un pareil contexte la ‘fin’ semble nécessairement proche, inéluctable. No future. Voilà le credo initial, et nous connaissons les pratiques où le Groupov l’a inscrit. Comme il nous paraissait que nous étions bien peu à situer ainsi les exigences actuelles, nous acceptions encore d’être la marginalité de la marginalité, d’où ce mélange enivrant de déréliction et de mégalomanie désespérée des premières années. D’où aussi la tentation d’en sortir, régulièrement… Aujourd’hui, mes convictions n’ont pas fondamentalement changé, mais je ne les vis pas de la même manière. Après coup, nous survivons. Comment être au plus juste ? Comment situer à nouveau une pratique ‘hic et nunc’ avec cette violence d’évidence que nous soyons jetés dans la brutalité de l’expérience, comme en 1980 ? En partant de ce qui s’échange actuellement autour des deux projets en cours, TRASH et Luw/LovEILIFE, des craintes que j’ai pour eux, j’ai essayé de définir plus précisément ma position. Brecht a écrit en son temps ce texte admirable : CINQ DIFFICULTÉS POUR ÉCRIRE LA VÉRITÉ (1934), on ne saurait aujourd’hui entreprendre pareille provocation mais je puis tenter d’énoncer, à l’usage du Groupov : CINQ CONDITIONS POUR TRAVAILLER DANS LA VÉRITÉ. Ces conditions (ou ces ‘vertus’) ne sont pas vraiment nouvelles, je les rattache même – ci-dessous – à des intuitions anciennes, mais le sens que je leur assigne désormais modifie l’exigence que nous leur accordions jadis.
Fin de la LETTRE À CELLE QUI ÉCRIT LULU/LOVE/LIFE CINQ CONDITIONS POUR TRAVAILLER DANS LA VÉRITÉ
« Au moment de conclure cette lettre, ô Bien-Aimée, moi qui dois écrire à d’autres, moi qui ne suis peut-être que celui qui garde certaines paroles, je voudrais déposer dans ton cœur trois présents précieux, trois diamants qui blessent à s’enchâsser dans leurs blessures :
Rimbaud :
« La vraie vie est ailleurs. »
Filliou :
« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. »
Müller (citant Genet) :
« L’unique chose qu’une œuvre d’art puisse accomplir, c’est d’éveiller la nostalgie d’un autre état du monde. Et cette nostalgie est révolutionnaire. »
Dans leur éloignement et leur recouvrement, elles s’éclairent l’une l’autre, ces paroles qui signalent que, par instants, on peut être juste, être justifié, travailler dans la vérité. Quelques instants seulement – et c’est déjà miracle dans ce monde écrasé par l’indifférence de la matière, ce que nous appelons le Mal – et donc la vérité n’est qu’un éclaircissement fugitif.
À Liège.
Jacques Delcuvellerie (dit Jack)
L’intégralité de cette lettre (60 pages) est disponible au Groupov, 16, rue du Mail, 1050 Bruxelles ou en téléphonant au 02/5 38. 81. 72