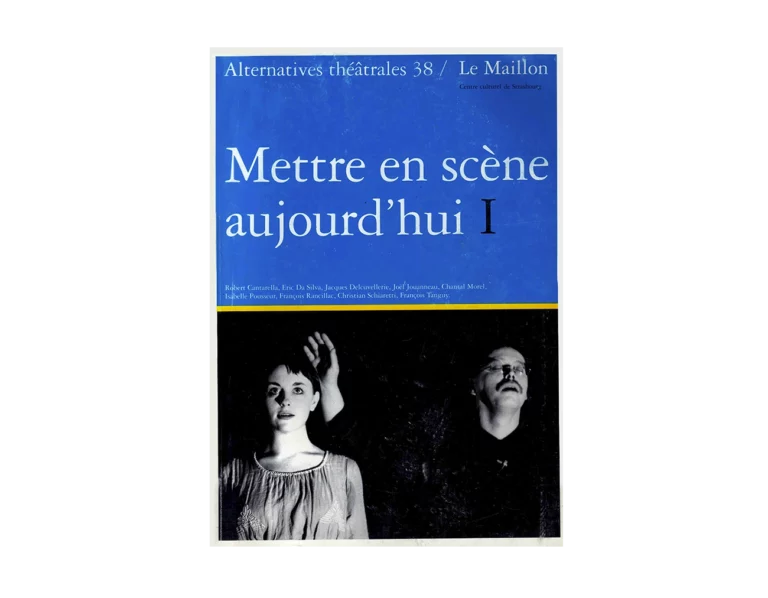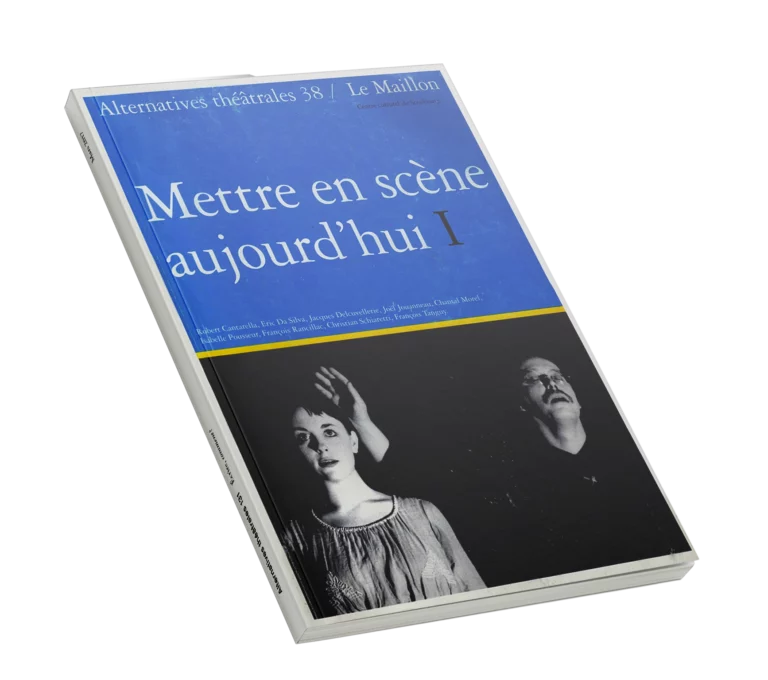La sollicitation était claire. Il faudrait parler de la jeune mise en scène, mais sans l’évoquer comme reliée : parler de l’ère présente de la mise en scène pour y mieux intégrer, sans polémiques inutiles, son évolution récente. Ce qui me convient court à faire : la jeune mise en scène n’existe pas. Cette boutade est d’abord un constat, puisque cette facette de l’art théâtral semble désormais, dans les travaux les plus intéressants de la jeune génération, céder la première place à l’écriture du spectacle. Elle est aussi une hypothèse, dès lors que la finalité de la mise en scène, qui apparaît aujourd’hui avec force dans les réalisations les plus marquantes de leurs aînés, pourrait bien constituer son terme.
Pour empêcher que cette déclaration préalable ne me range sans appel dans le camp des « anti-metteurs en scène », voire dans celui des « anti-jeunes », me suffira-t-il d’alléguer ma (provisoire) jeunesse ou mon (épisodique) activité de metteur en scène ? En aucune façon, car c’est précisément sur ce terrain que je voudrais ne pas situer la discussion.
Question piégée, celle de la jeune mise en scène entraîne en effet deux types de réponses aussi aporétiques l’une que l’autre. La première est bien connue, et consiste, sous l’affrontement des générations, à rejouer la vieille chicane des Anciens et des Modernes — qui a pour but essentiel, me semble-t-il, de dissimuler l’attaque ad hominem sous le pieux vernis de la classe d’âge. Mieux vaut dire alors franchement qu’on préfère les fragiles œuvres de Py ou de Grand Magasin aux élégantes superproductions de Ronconi ou de Strehler — tout en précisant que Jourdheuil paraît plus moderne que Braunschweig, et Sadin plus dépassé que Lassalle. Tout ça ne mène pas bien loin, et l’on abandonnera sans regrets une approche aussi pauvre.
Sur l’autre versant, celui de la mise en scène, une seconde chausse-trappe nous attend : celle de l’opposition en termes corporatistes du metteur en scène à l’auteur ou à l’acteur — dispute digne de l’Éducation Nationale, et dont on sait d’avance, selon le bord où elle s’engage, qui en sera déclaré gagnant. Rappelons au passage que, quelle que soit l’ancienneté dont on crédite la mise en scène comme fonction autonome, elle est en tout cas suffisante pour que cette polémique ait eu lieu à trois ou quatre reprises déjà, au cours des deux derniers siècles d’histoire du théâtre.