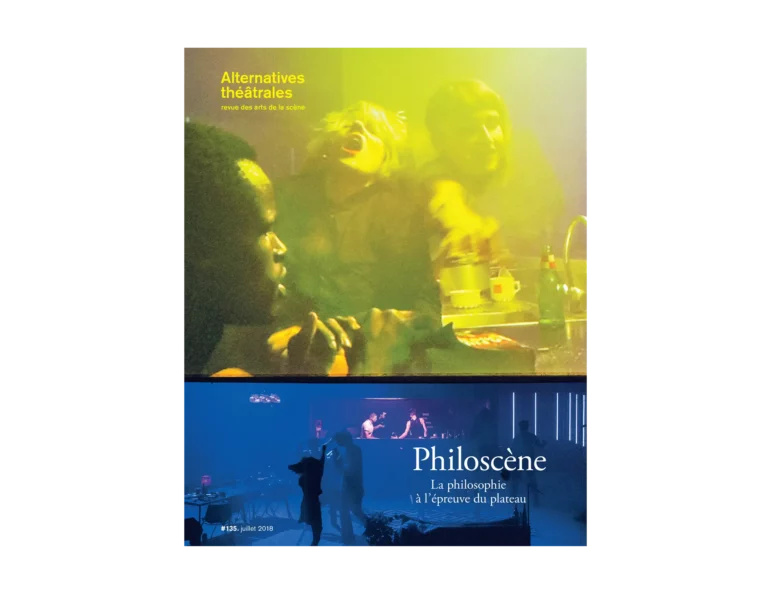Bernard Debroux : Dans Méta physique du bonheur réel1, vous citez plusieurs fois cette phrase de Saint- Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Par association d’idées, elle m’a ramené à un des spectacles les plus marquants dans mon souvenir de spectateur, 1789 du théâtre du Soleil, découvert en 1969 (!) et dont le sous-titre était une autre phrase de Saint-Just : « La révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur ». Dans ce même livre, vous proposez une distinction entre différents types de vérité et les différentes formes de bonheur qui y sont liées : le plaisir pour l’art, la joie pour l’amour, la béatitude pour la science et l’enthousiasme pour la politique. Dans mon expérience de spectateur, il me semble que la réception de 1789mêlait ces différents états : du plaisir bien sûr, mais aussi de l’enthousiasme !
Alain Badiou : Si l’on parle de ce spectacle en particulier, il est évidemment inséparable de l’enthousiasme flottant de l’époque toute entière, surgi en 1968. On allait de l’enthousiasme politique au théâtre et du théâtre à l’enthousiasme. Au théâtre, il y a une capacité singulière pour le spectateur qui consiste à transformer sa réception en quelque chose comme un bonheur, le bonheur du spectateur qui va faire l’éloge du spectacle à partir d’éléments qui peuvent être au contraire sinistres, tragiques, effrayants, etc. C’est en ce sens que je dis que le théâtre reste dans le registre de l’art. Il y a un bonheur singulier qui est lié, non pas à ce qui est, mentionné, représenté, mais au théâtre lui-même, le théâtre en tant qu’art. Dans le spectacle que vous évoquez, je suis d’accord avec vous, il y avait à la fois le bonheur du théâtre et l’enthousiasme qui vous mobilisait subjectivement pour changer le monde…
BD … et de la joie aussi …
AB Aussi, oui.
BD Peut-être pas la béatitude que procure la découverte scientifique !
AB Oh, sait-on ? Voyez la pièce de Brecht sur Galilée ! La singularité du théâtre est peut- être de produire un affect affirmatif avec des données qui, du point de vue de leur apparence ou de leur évidence, ne le sont pas du tout. J’ai toujours trouvé extraordinaire que les spectacles les plus effrayants, ceux dont on devrait sortir anéantis, arrivent à prendre au théâtre une espèce de grandeur suspecte qui fait qu’on sort de là illuminé, en un certain sens, par des crimes et d’infernales trahisons.
BD Les pièces de Shakespeare en sont un exemple frappant…
AB C’est la question paradoxale du plaisir de la tragédie. Aristote a tenté d’en donner une explication. Il a dit qu’au fond, nos mauvais instincts se trouvaient purifiés parce qu’ils étaient symbolisés sur la scène, et ainsi comme expulsés de notre âme. Il appelait ça « catharsis », purification. Nous sommes heureux au théâtre parce que nous sommes déchargés, par le spectacle réel, de ce qui empoisonne notre subjectivité. Le théâtre est une machine assez complexe. Il est toujours immergé dans son temps, donc il est traversé par les affects dominants du temps. C’est pour cela qu’il y a un théâtre dépressif ou un théâtre de l’absurde ou un théâtre épique, etc. Mais d’un autre côté, quand il est réussi, quand il a la grandeur de l’art, il crée un affect qui est fondamentalement celui de la satisfaction, quelle que soit sa couleur, avec des matériaux on ne peut plus disparates.
BD En prolongement de cette réflexion, je voudrais faire référence à cette même époque (de l’après 68) et à mes débuts de travail dans l’action culturelle où j’aimais éclairer le sens de cette action en m’appuyant sur les concepts développés par Lucien Goldmann2 et repris à Lucácz de « conscience réelle » et « conscience possible ». C’était une idée très positive, très affirmative (qu’on peut bien sûr interroger et critiquer différemment avec le recul) qui supposait que l’art, la création, les interventions culturelles et artistiques pouvaient bousculer les habitudes sclérosées et produire du changement… Pourrait-on mettre en lien ces concepts et ces pratiques avec ce que vous appelez le « théâtre des possibles » que vous mettez en opposition avec le théâtre « théâtre » qui est dans la reproduction d’un certain réel édulcoré et où rien ne se passe… ?
AB Je pense que le grand théâtre propose toujours une espèce d’éclaircie à la pesanteur du réel, éclaircie qui reste dans l’ordre du possible, et donc fait appel chez le spectateur à un type de conscience qu’il ne connaît pas immédiatement, qui n’est donc pas sa conscience réelle. Le théâtre joue en effet sur cette « possibilité ». Antoine Vitez répétait souvent que « le théâtre servait à éclairer l’inextricable vie ». L’inextricable vie, c’était le système d’engluement de la conscience réelle dans des possibilités disparates, des choix impossibles, des continuités médiocres. Le théâtre fait un tri, dispose tout cela en figures qui se disputent ou qui s’opposent, et ce travail restitue des possibilités dont le spectateur, au départ, n’avait pas conscience.
BD Le théâtre européen a été fortement influencé à partir des années 1970 et 1980 par l’irruption des sciences humaines dans l’espace social. À côté du metteur en scène, on a vu apparaître le « dramaturge » au sens allemand. Celui-ci a pu même être considéré à un certain moment comme le « gardien » du sens. Le théâtre est un univers de signes (texte, jeu de l’acteur, scénographie, lumières, costumes) où tout fait sens. On entendait souvent lors de répétitions dire à l’acteur : « là, ce que tu fais, c’est juste ». Paradoxalement, je me souviens d’avoir assisté à des répétitions de pièces mises en scène par Benno Besson (qui avait pourtant travaillé de longues années avec Brecht à Berlin) qui encourageait l’acteur en lui disant : « là, ce que tu fais, c’est beau ».
AB Je serais assez tenté d’admirer les deux approches et d’être dans une synthèse prudente afin d’éviter le choix. D’une certaine façon quand on dit « c’est juste », on emploie un mot qui est, soit du registre de l’exactitude, soit du registre de la norme. « Juste » est un mot équivoque. On peut en effet aussi bien dire : « Le résultat de cette addition est juste ». Le mot « juste » tire vers justice ou vers exact. Il est au milieu des deux.
Je pense aussi que lorsqu’on disait « c’est juste » dans un contexte sournoisement politisé, c’était parce qu’on préférait dire « juste » que « beau ». Dire « c’est beau » était considéré comme trop intemporel… Les deux appréciations peuvent en vérité apparaître chez le metteur en scène à des moments et dans des contextes différents. « Juste » va tirer du côté de la conscience possible, de la fonction éducative du théâtre. « Beau », c’est autre chose, c’est le sentiment qu’on peut avoir d’être dans une lumière singulière, une éclaircie visible. « Beau » est une qualité intrinsèque de ce qui se voit, de ce qui apparaît, de ce qui est dit, de ce qui s’entend. Je dirais volontiers que la ruse du théâtre, c’est de toujours, sournoisement, soutenir le juste par le beau, de faire comme si le juste était lui-même toujours beau. Si un moment de théâtre est à la fois juste et beau, quelque chose exerce sur nous une attraction singulière qui, par ailleurs, peut être aussi la révélation que telle action est possible alors qu’on la croyait impossible. Cette confusion du juste et du beau, je la voyais, chez Vitez, dans beaucoup de ses actions de metteur en scène. Souvent les acteurs se plaignaient qu’il ne leur donnait pas d’indications au sens strict du terme. Il était l’opposé de Strehler, qui, lors des répétitions, finissait par jouer la pièce entière tout seul ! Les acteurs étaient assis au premier rang, regardaient… Et finalement, ainsi étrangement « travaillé », le spectacle était extraordinaire quand même !
Chez Vitez, c’était très différent. Je me souviens de la répétition d’un moment de mon Écharpe rouge, dans lequel un acteur, qui n’intervenait pas dans ce moment, regardait et suivait les choses, assis au fond de la scène. Au moment où, se levant, il allait entrer à son tour dans l’action, Vitez est intervenu pour lui dire : « Ne te lève pas, c’est très beau que tu sois assis, que tu commences la scène comme ça, sans te lever. » S’il avait dit « c’est juste », on n’aurait pas bien compris pourquoi le fait qu’il soit assis renforçait son entrée en scène. Vitez disait « c’est beau » parce que le non-geste qu’il allait faire en phrasant sa posture assise était singulier, et allait imposer à la scène une espèce de frappe particulière. Voilà pourquoi je suis pour la beauté autant que pour la justice !
BD Pourriez-vous expliciter, en regard de l’opposition que l’on fait parfois entre théâtre du corps et théâtre du texte, et que vous récusez, les notions d’immanence du texte et de transcendance de l’image ? Vous dites que le théâtre, ce n’est pas de la politique, ce n’est pas de la philosophie, mais qu’il se situe entre les deux…
AB J’ai toujours été, peut-être de façon réactive et parfois même réactionnaire, déçu par les controverses sur l’importance respective de la présence théâtrale du corps ou du texte. Je pense que l’apologie du corps, cette fausse philosophie de la présence vitale, finit par aboutir à une entrée massive de la chorégraphie dans le théâtre. Je parlerais même d’une sorte de cor- ruption du théâtre par la danse. Je ne le dis pas contre la danse que j’aime beaucoup par ailleurs, mais ce n’est pas la même chose. La danse peut exister dans l’espace de la scène, cela ne signifie pas qu’elle se résume ou se résout en théâtre. Le théâtre peut bien entendu comporter des élé- ments chorégraphiques, mais, pour moi, ce n’est pas son essence propre. Je pense que le théâtre, c’est ce qui se tient dans une relation serrée entre immanence, côté corps, et transcendance, côté texte, assez serrée, indémêlable. Il y a l’évidence du visible d’un côté et la saisie du sens audible de l’autre. Ce n’est pas la même perception. L’audition n’est pas la vue. Par une combinaison de l’audition et de la vue le théâtre est capable de symboliser une relation entre immanence et transcendance qui aboutit à quelque chose d’inséparé. C’est cet inséparé qui me fascine dans le théâtre. Le fait que quelque chose est reconstruit sur scène dans une figure de présence absolue qui cependant touche aussi au plus complet imaginaire (lequel est porté par des questions de personnages, de textualité etc.) Quand on défait cela, quand on valorise ou surestime un des aspects, qu’il domine l’autre, je suis inquiet…
Cela veut dire au fond que le théâtre, pour moi, c’est fondamentalement et de façon supérieure, l’art dialectique, la séparation-inséparée comme contradiction active. Que l’on ait un texte qui a 3000 ans d’âge, et qu’il devienne immédiatement saisissant aujourd’hui quand il est porté et présenté par des corps- parlants est vraiment extraordinaire !
Par ailleurs, je suis frappé par le fait que dans l’histoire du théâtre, il y a des moments où il se gonfle par des apports extérieurs importants et où il tend vers l’idéologie du théâtre total. On sent cette courbe monter au XIXe siècle, par exemple, au point même que Wagner va faire construire à Bayreuth le théâtre du « théâtre total ». Mais ensuite, à un moment donné, arrivent des gens, comme Copeau, qui proposent une brutale simplification et qui disent : « le théâtre, c’est quelques acteurs sur un plancher nu ». C’est l’histoire dialectique du théâtre et c’est aussi la dialectique du théâtre lui-même : chaque représentation est un certain parti pris sur cette dialectique.
BD Cette dialectique peut se retrouver à l’intérieur du parcours d’un metteur en scène. Si on pense à Chéreau qui a mis en scène le Ring de Wagner à Bayreuth, mais qui pouvait se retrouver pour La Douleur de Marguerite Duras, seul, sur une scène nue, pourvue d’une table et d’une chaise, en compagnie de Dominique Blanc, ou encore la lecture spectacle qu’il fit, pieds nus, de Comade Pierre Guyotat…
AB Je suis absolument de votre avis. Cette dialectique, on peut la voir historiquement, elle est présente comme virtualité théâtrale à l’intérieur de n’importe quel spectacle, et finalement, chez le même metteur en scène, on peut voir la satisfaction de l’ornementation et la satisfaction de l’ascétisme.
BD Cocteau disait de la poésie que « c’est un mensonge qui dit toujours la vérité ». Aragon, dans le même ordre d’idée parlait du « mentir vrai ». On peut considérer le théâtre comme le lieu d’une tension entre le vrai et le faux, question philosophique par excellence…
AB Quand Platon prend des positions très raides vis à vis du théâtre, c’est évidemment en raison du fait qu’il s’inquiète de ce que le spectateur puisse éprouver des affects ou porter des jugements au regard de choses qui ne sont finalement que des fictions. Platon remarque que, souvent, le personnage qui attire le plus l’admiration du spectateur parce qu’il est joué par un acteur extraordinaire, c’est le méchant, l’horrible, le traître, le bandit, l’assassin. N’importe qui peut accéder à la gloire théâtrale porté par le texte, l’acteur, la poésie… Il pense que ce n’est pas moral ! Et l’immoralité est une question récurrente dans l’histoire du théâtre. Les églises ont toujours suspecté le théâtre d’être un lieu de falsification et de débauche…
BD … Jusqu’à excommunier les acteurs, ce qui fut jusqu’au XVIIIe siècle en France la position catholique et protestante …
AB Pour moi, le philosophe doit accepter que la fonction du théâtre ne soit pas réellement d’indiquer ce qui est bien ou ce qui est mal. Même Brecht n’avait pas cette intention. Il voulait montrer que, de toutes façons, nous sommes confrontés à des choix nécessaires et que nous devons le savoir. Ce n’est pas la même chose que de dire : « ceci est bien, ceci est mal ». C’est une instruction générale sur le côté problématique de nos engagements. Brecht nous demande d’être au clair, quand on fait quelque chose, sur ce qu’on est en train de faire. Le théâtre a une fonction qui n’est pas de dire le vrai, mais une fonction d’éclaircissement sur l’arène où le vrai et le faux, le juste et l’injuste sont en conflit. Il jette sur cette arène un rayon de lumière spécifique, nouveau. Il s’agit moins d’instruire les spectateurs que de les avertir de ce qu’est le réel.
BD N’est-ce pas aussi la fonction de la philosophie ?
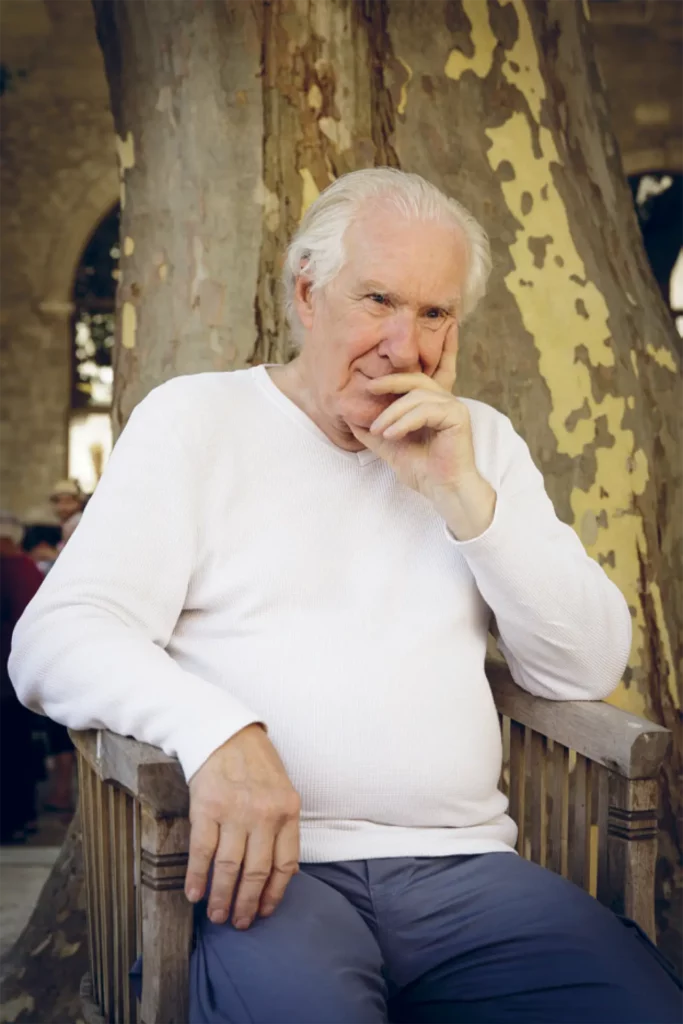
Photo Christophe Raynaud de Lage.
AB Il y a une théâtralité de la philosophie. Le théâtre et la philosophie sont complices. Platon lui-même parle de « rivalité » entre la poésie et la philosophie. Rivalité veut dire qu’il y a communauté de destin et de fonction. Je penche plutôt du côté des philosophes attirés par le théâtre, convaincus que le théâtre peut être une forme appropriée pour parler de certains aspects de ce qu’ils pensent. Lorsque j’étais jeune, j’étais très attiré par Sartre qui, à cette époque, était bien plus connu pour être l’auteur de Huis clos que de L’Être et le néant.
Entre nous, ce qui éclaire la chose de façon singulière la critique du théâtre par Platon, c’est qu’il n’a lui-même écrit que des dialogues, que du théâtre ! C’est le seul grand philosophe qui ait trouvé le moyen de ne jamais écrire le moindre traité systématique, avec des définitions, des conséquences tirées des définitions, des polémiques académiques, comme le feront juste après lui Aristote puis toute la tradition métaphysique. Platon ne procède pas du tout comme ça. Il monte des petites pièces de théâtre ! On a là une bonne conclusion : le destin de cet immense philosophe, explicitement ennemi du théâtre, est d’être joué…