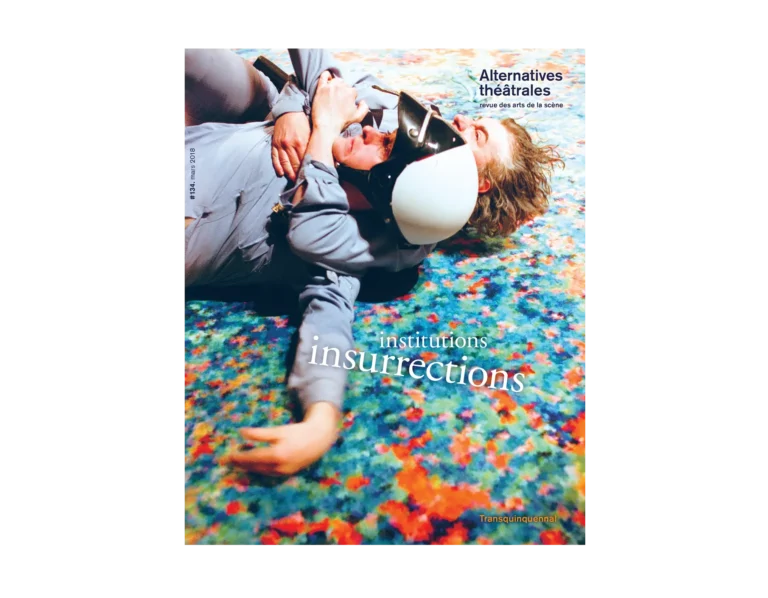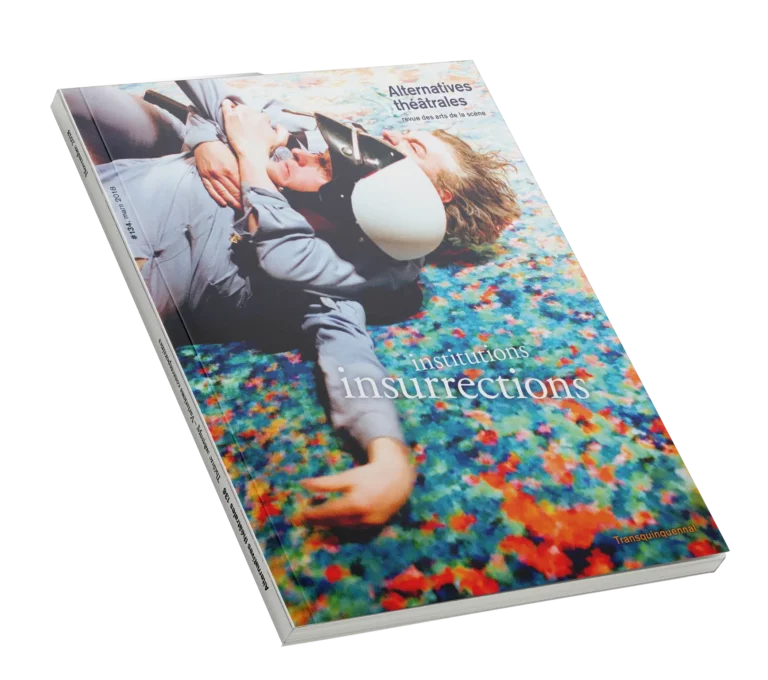Lors d’un entretien réalisé pour ce numéro d’Alternatives théâtrales avec les membres du collectif Transquinquennal, un étudiant de 2e master en Arts du spectacle1 qui nous écoutait demanda ce qu’au fond, nous entendions par « institution(s) », terme que nous ne cessions d’employer. La question était posée certes avec un peu de timidité (peut-être feinte !) mais non sans pertinence.
La notion revient sans cesse dans les discours et les débats et lorsque, dans le monde théâtral, on évoque les institutions, on fait aujourd’hui d’emblée référence à un vague clivage, à une vague dichotomie. La convocation du terme au pluriel désigne en effet souvent les structures théâtrales établies, celles dont la pérennité et l’ancrage sont assurés par une subvention publique récurrente dont l’attribution se passe généralement sans surprise. Des structures bien visibles dans le paysage et dont les autres, plus petites, ne peuvent se passer en vertu de la nécessité de coproductions et de lieux de programmation. Les institutions sont donc celles qui ont des moyens confortables, qui disposent d’espaces pour préparer des spectacles et les montrer à un public et qui, dès lors, peuvent contribuer à faire vivre l’ensemble du milieu mais, et telle est la connotation latente dans l’usage commun du mot, souvent au gré de leur bon vouloir. Et si, chez beaucoup d’artistes, la référence aux institutions s’accompagne d’une moue dépréciative, c’est qu’un certain malaise tend à croître à l’égard des formes de domination exercées par des forts sur des faibles, des gros sur des petits…
De plus en plus d’artistes en effet s’organisent en compagnies et cherchent à garder une autonomie maximale dans la création, la production et la diffusion de leurs spectacles.
Aspirant ainsi toujours davantage à une subvention qui permette un fonctionnement structurel (et non plus seulement une aide aux projets), ils deviennent des concurrents réels des théâtres « établis ». Et ce d’autant que, pour tenter de rééquilibrer quelque peu les mécanismes aliénant les « faibles aux forts et les petits aux gros », les compagnies indépendantes tendent à se structurer et se sont notamment fédérées dans une Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes (CCTA). Dès lors, une certaine tension tend à s’accroître. Les relations se font plus dures et les positionnements plus nets. C’est que, en se structurant de la sorte, les compagnies s’inscrivent différemment dans le paysage théâtral : elles sortent de la position de petits opérateurs, nombreux mais dispersés et isolés, animant largement la vie théâtrale mais restant en position de demandeurs vis-à-vis de ceux susceptibles de leur octroyer les conditions matérielles de leurs créations.
Constituant une CCTA, elles prennent une place plus centrale dans l’institution théâtrale et, à ce titre, deviennent susceptibles de participer à l’orientation de celle-ci. Cette volonté de s’organiser, de se fédérer, qui a guidé les compagnies est bien un geste politique par lequel sortir de la seule position d’« opérateurs » requérants, de bénéficiaires sans autre voix que l’éventuelle revendication portée sur la place publique. L’autoconstitution en sous-structure implique ipso facto l’engagement dans le fonctionnement institutionnel, la participation à l’édiction des règles et des normes du milieu, en somme à la politique de l’institution. Du moins cela en affirme-t-il le dessein et le projet. Car encore faut-il accumuler le pouvoir de le faire en capitalisant des moyens, soit du personnel, du pouvoir économique et, surtout, une dimension symbolique via la reconnaissance par un public national ou international et par les médias.
Ce qui signifie qu’il faut donc bien d’abord adopter les règles de l’institution pour obtenir une certaine légitimité, avant de chercher à transformer les normes en vigueur.