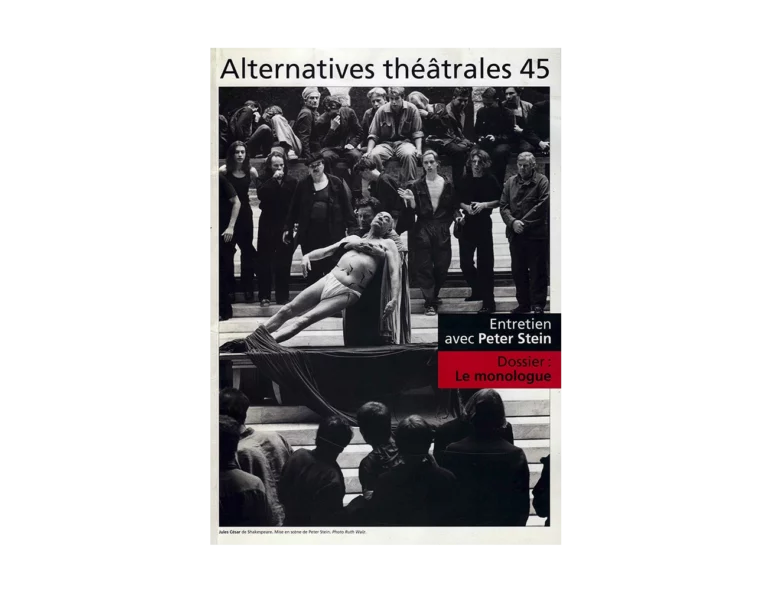L’oublié porte l’inoubliable dans ses mains vides et nous sommes nous-mêmes portés par l’inoubliable.
LE RÉCIT DE LA SERVANTE ZERLINE1
DANS LA CONFÉRENCE DE BROOKLYN SUR LES GALAXIES de Serge Valletti, dès l’instant où le personnage est sur le point d’aborder le sujet titre, il raconte une autre histoire. Parfois il donne une information qui pourrait à elle seule constituer le début d’un récit, mais l’évocation s’arrête brutalement pour changer de sujet. Quand il dit : « Je suis chanteur »2, nous pouvons espérer qu’il nous parle de ce métier, mais il stoppe le déploiement de la parole en poursuivant : « Enfin je chante pour moi ». Par un continuel retour à de petites obsessions, il commence et refuse de commencer. Le monologueur trompe le titre et cela nous fait rire ! La parole solitaire devient alors un grand aparté, l’art de l’intermède qui se prolonge, celui où la digression est là pour relancer une histoire, feindre de l’oublier, ou devenir l’essentiel du dis cours. Le personnage glisse entre ses phrases des éléments d’information qui déstabilisent toute trame et font d’une incongruité le sujet du récit avant qu’une autre ne la remplace. C’est peut-être l’incongruité de sa position qu’il joue, cette chance de s’adresser à une audience qui a payé sa place, une envie de tout dire, de jouer l’éphémère d’une écoute. L’intermède se prolonge, le rendre acceptable c’est souvent le rendre comique en faisant des petites histoires de sa vie le sujet du récit. Il rappelle ainsi le personnage de Tchekhov qui dans LES MÉFAITS DU TABAC profite de la conférence qu’il doit donner pour faire l’étalage des méfaits de sa vie conjugale.
Les plus grands skieurs utilisent le dérapage pour aller plus vite. C’est en refusant le cheminement linéaire d’une pensée logique que le locuteur solitaire nous intéresse ; il dévoile ainsi une plage indécente du discours qui permet d’éviter le sujet annoncé, de tourner autour, ou de le relier abusivement à sa vie privée. Dès lors, nous pouvons imaginer que le personnage est un imposteur, un charlatan du verbe qui s’adresse à nous, audience bienveillante, qui, comme dans un radio crochet, lui laisse une chance de nous intéresser.
Par son fonctionnement analogique la parole autorise les développements digressifs. Très souvent le discours solitaire fait revivre, déclenche, ou relate un trouble mais le théâtre n’est résolument pas un cabinet de psychanalyse et nous voyons rarement un personnage solitaire quitter la scène et dire : « merci je me sens mieux maintenant ». Sur le plateau, la parole qui ne se laisse pas domestiquer par les réactions d’un interlocuteur feint de se développer librement et prend une valeur hypnotique qui parfois enferme celui qui la profère dans une complaisance qui, pour le spectateur, devient à la fois comique et tragique. Si le discours solitaire cherche à formaliser un tourment, celui-ci est renvoyé à toutes ses implications. Le sujet énonciateur se laisse rapidement entraîner par toutes les possibilités du langage. Le personnage subit devant nous les méfaits de sa propre parole et la forme si répandue du ressassement cristallise son désir obsessionnel de détailler au mieux ce qui le fait parler.
Ce que plusieurs auteurs contemporains mettent en scène c’est l’échec de la parole. Il est lié à sa capacité d’expansion. Au théâtre comme à la vie, la parole solitaire, en détaillant un thème ou un problème, suggère de multiples issues, une quantité de choix possibles qui placent celui qui parle dans l’embarras et évacuent toute éventualité d’un choix unique. Le monologueur se retrouve rapidement dans la situation d’un voyageur qui doit prendre un train sans connaître aucune des destinations proposées. Il reste sur le quai, continue à parler et multiplie encore les voies d’une hypothétique solution. En détaillant un tourment qui devrait se résoudre en une phrase, idéalement en un mot, celui qui parle seul fait d’un petit soldat un régiment. Là où le conteur traditionnel ou le simple témoin semblent programmés par une histoire qu’ils doivent transmettre et raconter au mieux, certains personnages contemporains construisent une spirale de mots dont ils sont les premières victimes. Affirmation polémique ou idée terroriste : le plaisir de parler seul porte en lui l’échec de toute résolution.
Le jour de la représentation le monologueur semble sortir de sa solitude mais son discours est comme une routine dont il évoque la répétition, l’ancienneté à laquelle notre présence va donner une autre dimension. Il constitue cette part d’inoubliable dont parle LE RÉCIT DE LA SERVANTE ZERLINE : « J’ai traversé les années, et les années passent, et le passé demeure, même si je le raconte mille et mille fois. Je ne peux pas m’en défaire, je ne peux pas m’en débarrasser »3 ou Wolf qui dans LES GUERRIERS de Philippe Minyana dit : « Si je l’ai déjà racontée l’histoire tu m’arrêtes hein Taupin ! »4