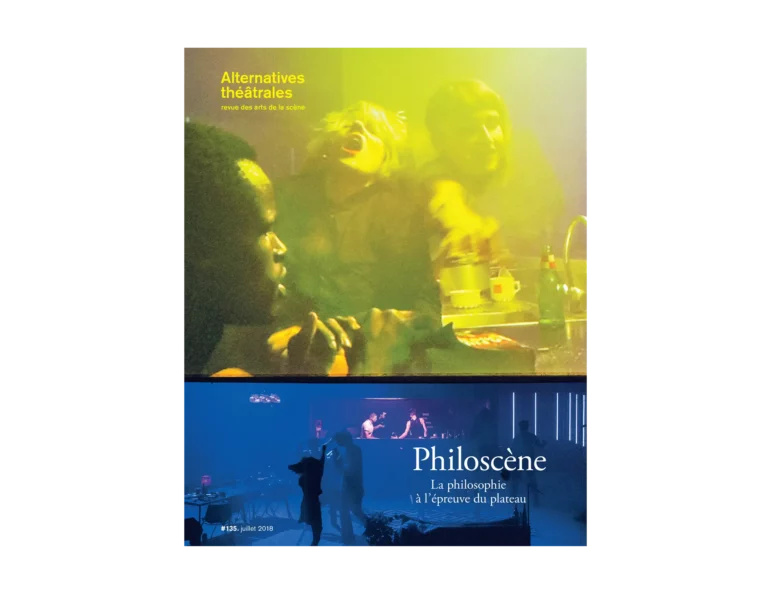1.
La question du texte de théâtre suscite ces derniers temps beaucoup de réflexions et de débats, dans lesquels le (fait même qu’il y ait un) texte apparaît parfois comme « suspect ». On peut penser qu’il s’agit d’un épisode ponc- tuel, ou à l’inverse qu’un profond changement est en cours. Mais, sans nier sa singularité à la manière dont les questions se posent aujourd’hui, ces débats ont un air de déjà-vu qu’il peut être éclairant d’interroger.
Il semble en effet qu’ils se nourrissent en partie d’une configuration de pensée héritée de l’époque où le théâtre a, comme les autres arts entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, effectué sa « révolution moderniste », c’est-à-dire s’est renouvelé en interrogeant la spécificité de son médium. De cette époque datent notamment l’« invention » de la mise en scène1 et la remise en cause du « textocentrisme » (conception jusque-là dominante selon laquelle le texte est l’essence du théâtre, et les affaires scéniques sont secondaires, accessoires). La révolution moderniste du théâtre s’est manifestée par une réflexion sur le plateau, dans l’idée que le medium spécifiquement théâtral est la scène, et non le texte. Or, la dynamique de ce mouvement de renversement s’est souvent accompagnée de l’opposition, terme à terme, du texte et de la scène, opposition elle- même volontiers soutenue, à travers différents relais, par celle de l’esprit et du corps. Le vieux textocentrisme était cohérent de l’idée du primat de l’esprit (texte) sur le corps (scène) – système de valeurs qui était loin de ne concerner que le théâtre –, et la réflexion sur la scène a souvent maintenu cette opposition du corps et de l’esprit, en inversant le rapport de forces. Explicitement, cette opposition est rarement défendue en tant que telle, et ceux mêmes qui la convoquent, souvent, dénoncent, comme incidemment, son caractère inadéquat2– c’est bien la preuve, à mes yeux, que cette configuration s’apparente aux « faux problèmes » créés par de mauvais jeux de langage, pour parler en termes wittgensteiniens. Elle reste néanmoins active dans les discours : le texte est abstrait et le plateau concret, le texte établit l’élément imaginaire ou spirituel (la « réalité dramatique ») et le plateau est le lieu d’une réalité non fictionnelle, physique (« réalité scénique »), etc.3. Bref, le texte est étranger à ce qui fait la spécificité du théâtre, qui est la scène, le plateau, le caractère vivant, actif, « performatif » dit-on aujourd’hui, l’inventivité du jeu, de la mise en scène, etc. Et c’est parce que c’est le sens même de la « modernité » théâtrale, d’une révolution engagée il y a plus d’un siècle, que ce dont le (fait qu’il y ait un) texte peut paraître suspect, c’est d’un certain passéisme.
2.
En 1984, Bernard Dort proposait une autre manière d’envisager les choses. Dans Le texte et la scène : pour une nouvelle alliance, il invitait à penser qu’à la révolution copernicienne du théâtre (passage du textocentrisme au scénocentrisme) avait succédé une « révolution einsteinienne », qu’il caractérisait comme une « relativisation généralisée des facteurs de la représentation théâtrale, les uns par rapport aux autres »4. Parler de ces différents facteurs, c’est, pour commencer, défaire la prétendue unité de « la » scène, qui est en réalité au croisement de plusieurs pratiques, chacune déterminant une perspective propre : la perspective du jeu n’est pas tout à fait celle de la mise en scène, qui n’est pas tout à fait celle de la scénographie, etc. Dans ce cadre pluriel, Dort proposait que le texte, lui aussi, peut agir sur la scène, organiser la modalité de l’apparition scénique – ce qui semble une évidence : on sait bien qu’un texte de Beaumarchais ne travaille pas la scène de la même manière qu’un texte de Tchekhov, un texte de Müller qu’un texte de Fosse ; chaque texte met en relief, appelle, des aspects spécifiques, selon une manière et une économie singulières. Mais cette activité du texte sur la scène n’est, encore aujourd’hui, que rarement étudiée – probablement en raison de cette opposition du texte/esprit à la scène/corps, et Dort précisait d’ailleurs que, pour rendre la scène accessible au texte, il fallait la caractériser conceptuellement, là où l’on s’en tient souvent, encore aujourd’hui, à une équivalence entre la scène et « le corps » ou « la réalité » ou « la vie » (par opposition au texte). Et en effet, il semble que l’évolution du texte de théâtre depuis la « révolution moderniste » du théâtre s’écrit dans son coin, que les textes s’écrivent surtout par rapport aux autres textes, sans rapport avec la globalité du fait théâtral, sans trop avoir entendu que quelque chose s’était passé autour de la scène – rappelant ce soldat japonais isolé dans la montagne qui ne fut convaincu que la Seconde Guerre Mondiale était terminée, et ne déposa les armes, qu’en 1974.