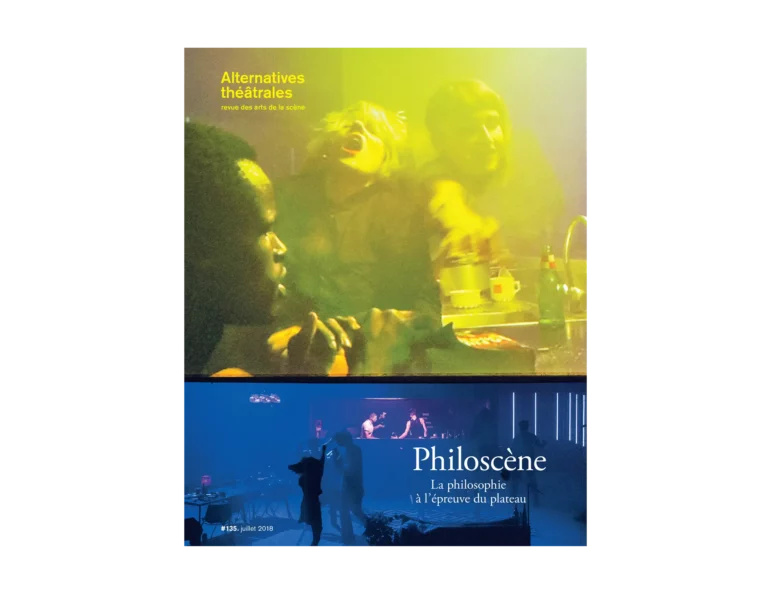Camille Louis est artiste dramaturge, co-initiatrice du collectif kom.post (composé de chercheurs, artistes et activistes) et docteure en philosophie. Elle a soutenu en 2016 sa thèse à l’Université Paris 8 sur La Recomposition de la politique dans les décompositions des politiques. Conflictualité des dramaturgies politiques. Elle est dramaturge associée à La Bellone (Bruxelles) ainsi que pour différents festivals en Europe. Ses travaux artistiques ont été montrés au festival d’Avignon, festival TanzImAugust de Berlin, Biennale de Moscou, festival MIR d’Athenes, etc. et, en 2017, au festival Experimenta Sur de Bogota. Ses recherches en philosophie se déplacent régulièrement de la rédaction d’essais à des terrains d’action concret, en particulier, depuis quelques années, celui lié aux situations d’exil et d’hospitalité.
En 2015, j’invite Camille Louis à se joindre à l’équipe de La Bellone1. Depuis nous entretenons un dialogue sur nos pratiques dramaturgiques respectives et sur la conceptualisation du projet de la Bellone. À partir de ce dialogue, j’ai relevé les huit mots couplés ci-dessous qui permettront aux lecteur.rice.s d’entrer brièvement, ici, dans la pensée de la dramaturge/philosophe. Huit mots tendus qui forment un pointillé au sein duquel le regard de Camille Louis ne cesse de s’activer.
Agir/Action
Ou bien Action => Agir, car peut-être est-ce dans ce passage que se tient et se développe ce dont je crois avoir fait une méthode d’analyse, un mode de penser et de penser en philosophie : la dramaturgie. Il dit Drama+ Ergon. Il dit donc action finie, considérée au moment de son achèvement (drama) et mouvement (ergon) que l’on peut aussi traduire par création. Il dit une alliance impossible entre « fin » et « sans fin » du mouvement ; entre arrêt et invention de début nouveau ; entre action (finie) et activation d’un élan tel qu’on l’entend dans le verbe « agir ». Ce que le mot dramaturgie nous dit surtout et nous dit enfin, c’est une ouverture de possible. Un possible pour « l’après », pour ce qui continue après l’arrêt, pour un « post » qui n’est pas un « stop »2.
C’est dans ce possible là que j’ai placé toute ma recherche en philosophie et qui, dans le cadre de ma thèse, a consisté à relire un ensemble de nos récents moments politiques majoritairement décrits dans le registre de la fin malheureuse (l’échec), comme des débuts ou, du moins, des terrains en mouvement. Je me suis particulièrement intéressée à ce que l’on a nommé « les printemps des places »3 et à la manière dont ce qui a été diagnostiqué dans la langue dramatique de la défaite pouvait être ressaisi à partir d’une torsion dramaturgique venant dé-faire les imageries en les recomposant différemment. Cela non pas depuis le regard surplombant de la philosophe qui nous dirait quelles sont les fausses représentations et où trouver les justes présences, mais depuis une « descente au plateau » de ce regard : son passage de la theoria– qui donne à voir – au theatron qui ne cesse de repenser et redistribuer les données et les conditions d’un voir.