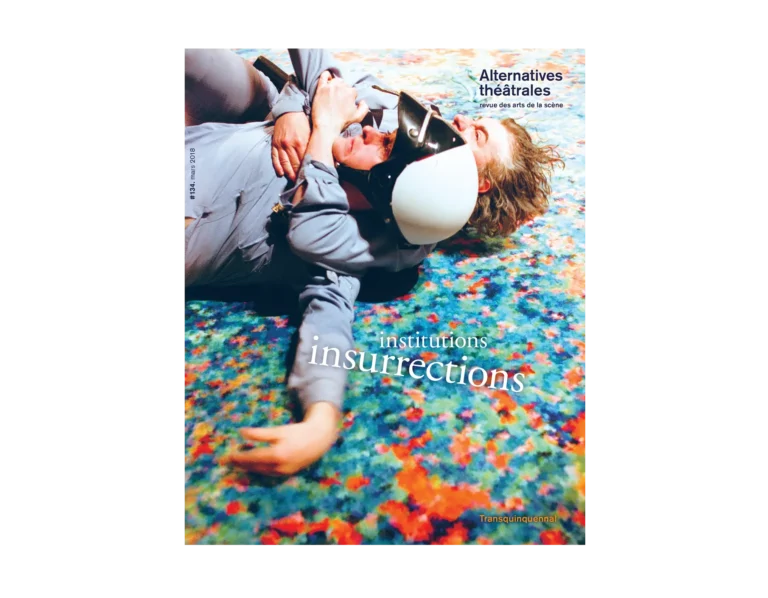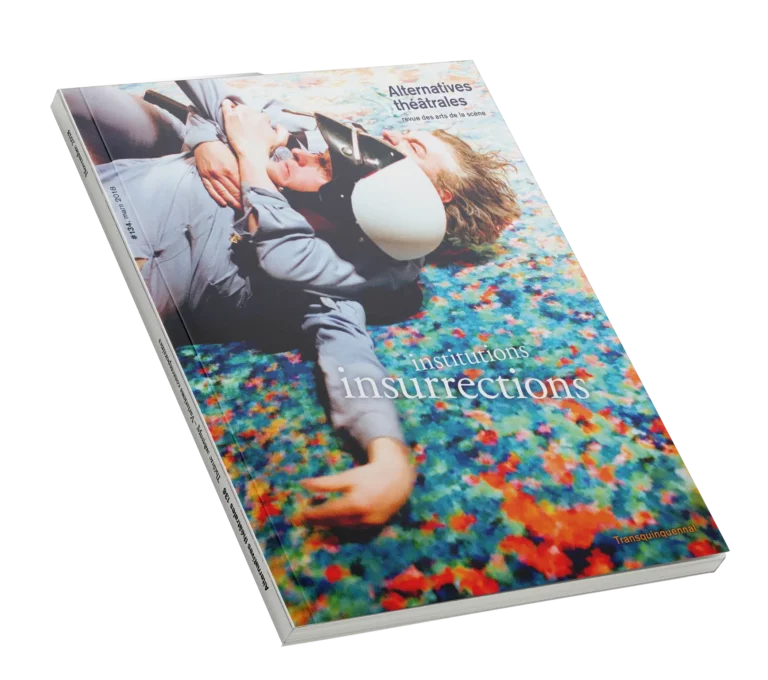En présence de quelques étudiants en Arts du spectacle de l’ULg, le 20 octobre 2017, au Théâtre de Liège, rencontre avec les quatre membres de Transquinquennal (Stéphane Olivier, Miguel Decleire, Bernard Breuse, Brigitte Neervoort) axée sur leur rapport à l’institution.
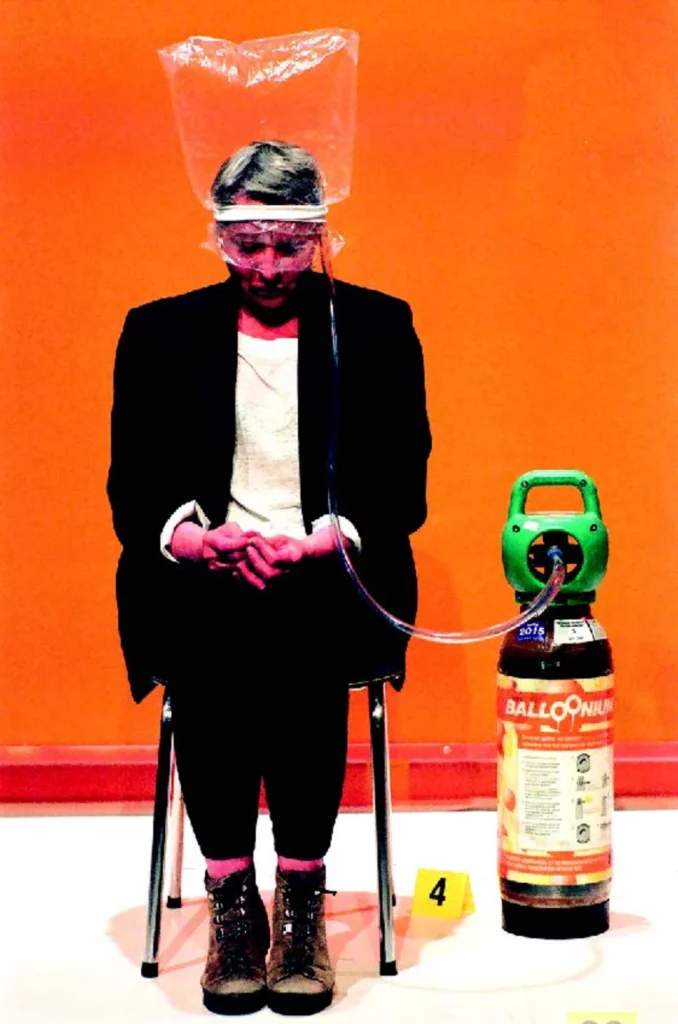
AL Dans votre projet pour les années 2018 – 2022, rédigé dans le cadre de votre demande de contrat-programme et rendu public sur votre site web, vous mettez en avant le concept chimique de sublimation, passage de l’état solide à l’état gazeux. Comment comprendre ce concept à la lumière de votre décision – rare dans le champ théâtral – d’arrêt de votre pratique et de la revendication de cet arrêt comme d’un geste artistique ?
SO La réflexion a commencé il y a quatre ou cinq ans. Ça faisait plus de vingt ans que la compagnie existait. D’une part, il y a la visibilité vers l’extérieur : nous faisons un spectacle et puis un autre spectacle et encore un autre spectacle et, à chaque fois, en parallèle, un travail spécifique sur ce qui est proposé au spectateur. Le travail artistique se fait peu à peu dans la continuité et les spectacles deviennent les moments publics d’un travail plus continu. De cette particularité naît aussi une difficulté : ce travail artistique permanent, qui a toujours été voulu par la compagnie, n’a pas de place réelle dans le paysage théâtral. Organiser une forme de fidélité sur la durée n’est pas possible. Voilà le point de départ de notre réflexion. Quarante-et-un était une première réponse à cela : c’était le quarante-et-unième spectacle et nous souhaitions poser
un regard sur les quarante premiers, tout en nous projetant dans l’avenir. Et puis, l’autre question importante, liée directement à cette idée de sublimation, était celle de la dynamique artistique de changement, c’est-à-dire de mobilité de notre façon de travailler. Cette question interne à la compagnie habite beaucoup de personnes au sein de la société, au sein des relations humaines, donc ça devenait un sujet potentiel. Un des facteurs du changement, c’est de parvenir à faire le deuil de ce qu’on a.
MD Souvent, on a besoin, pour des raisons bêtement économiques et structurelles, de pouvoir voir à long terme. Ce qui est permanent est une forme de condition pour changer un petit peu. Mais si on veut vraiment aller plus loin, ou faire les choses plus radicalement, il faut pouvoir se passer de ça aussi.
BB Je vois cela comme un cadre. Pour que l’œuvre persiste, il faut lui donner un cadre. Et le fait de terminer, c’est faire le cadre. Pour compléter notre œuvre – je sais que c’est un grand mot– il faut absolument la clôturer. Transquinquennal a toujours intégré cette dimension : il était inscrit dans nos statuts dès la fondation que l’aventure durerait cinq ans.
SO Elle a eu un sursis assez long !
MD C’est le sens du mot « Trans » qui a changé pour nous. Au départ, il signifiait plutôt « jusqu’à » et ensuite c’est devenu « à travers ». On a fait plus ou moins cinq plans quinquennaux !
SO Nous avons toujours recherché ce que le collectif permet qu’une autre forme de “pratique ne permet pas. Une des choses que le collectif permet, c’est de s’arrêter. Quand tu es un individu créateur, que tu es metteur en scène ou auteur, tu ne peux pas t’arrêter. La seule chose qui va t’arrêter, c’est ta mort. Et, si tu t’arrêtes quand même, tu restes l’incarnation de ce que tu as été. En arrêtant, nous ne serons plus identifiés individuellement comme Transquinquennal.
On pourra avoir des conversations dans des cafés avec des gens qui ne sauront pas qu’on a fait partie de Transquinquennal…
BB C’est déjà le cas pour Pierre ! C’est terriblement angoissant pour ta vanité mais en même temps, ça a vraiment beaucoup de sens. Artistiquement, ça a du sens. Avec l’âge, l’angoisse de se répéter est terrible : on se dit qu’on connaît un certain nombre de choses sur le métier, on a de l’expérience, on rejoint une certaine tradition… C’est très rassurant sur un plateau de se dire « oui, oui, on a des solutions », mais c’est aussi terrible, artistiquement…
SO Un autre aspect était d’accepter de renoncer à notre inclusion dans le « monde artistique dans sa normalité ». On n’ira pas à Avignon, en tout cas on ne se bat plus pour ça ; on ne fera pas de tournées mondiales ; on ne remplira pas quinze fois l’Aula Magna à Louvain-La-Neuve ; on ne fera pas un succès international. Ça, c’est bon, on laisse ça aux
autres et maintenant c’est clair. C’est une forme de soulagement de laisser tomber cette pression qu’on se mettait à nous-même.
MD D’une certaine manière, on se réapproprie le cadre dans lequel on s’inscrit. C’est la poursuite de ce qu’on fait au niveau artistique : essayer de s’approprier toutes les phases du travail.
SO C’est tellement à nous que nous pouvons l’arrêter, et fuck off !
AL Était-ce une décision facile à prendre ?
Étiez-vous d’accord tous les quatre ?
MD Tout de suite !
SO C’est une décision qui a été prise avant que Brigitte ne soit engagée, donc nous n’étions que trois à être d’accord ! La décision a été prise environ au moment où Céline a dit : « Si je continue avec vous, quand vous serez retraités, je serai trop vieille pour changer de métier. J’ai envie de changer maintenant. » Et nous, on a dit « Oui, si tu penses que tu commences à ronronner, c’est le moment en effet ». Quand on a fait les appels d’offre et que Brigitte a accepté de travailler avec nous, on lui a tout de suite dit qu’on allait arrêter.
Le capital symbolique accumulé par Transquinquennal peut être une arme de combat. Qu’en fait-on ?
BN J’avais déjà signé le contrat ! [rires] Mais je trouvais ça super. Cette idée renverse le rapport au temps : habituellement, tu penses à partir d’aujourd’hui jusqu’à l’année prochaine, et ainsi de suite. Nous, on pense à partir de 2022 et alors, on fait une espèce de planning rétroactif qui est comme un futur et ça, c’est un exercice très intéressant.
SO Le questionnement par rapport au processus de subvention a joué aussi. On défend par ailleurs que les subventions ne soient pas automatiques, qu’il n’y ait pas de récurrence, qu’un projet artistique puisse être chaotique, puisse être renouvelé, puisse être changé, qu’il y ait une réévaluation continue des projets artistiques et en même temps, on ferait exactement l’inverse ? Un autre aspect important de cette décision est la réappropriation pour chacun d’une pensée individuelle, qui ne concerne pas les autres : « qu’est-ce que je vais faire après ? »
BB Je vais pouvoir enfin les inviter à manger à la maison comme des amis ! Juste comme ça quoi…
SO Ce qu’on ne fait jamais !
ND Un élément central dans votre travail, c’est la dimension de la contrainte. Cette ultime contrainte que vous vous imposez est une forme de grimace. Finalement, l’institution a l’air d’avoir gagné dans la mesure où vous ne parlez que de l’aspect interne : d’une sorte d’essoufflement de la structure que vous avez créée. Vous avez été des pionniers en matière d’exploration de ce qu’était un collectif, et c’était aussi une manière d’élaborer une structure en pied de nez à l’institution. C’est un constat de défaite que vous faites.
MD, SO, BB Non !
NB Le capital symbolique accumulé par Transquinquennal peut être une arme de combat. Qu’en fait-on ?
BB L’ambition de Transquinquennal, très naïve, c’était de réinventer. Aujourd’hui, je me dis que ce pouvoir de réinvention, il est à d’autres que nous. D’une certaine manière, on doit toujours faire une forme de guérilla dans une compagnie. Et nous, on n’est plus vraiment dans la guérilla : on est devenu une petite institution. Socio-économiquement, on était encore des enfants des Trente Glorieuses.
Or, il y a un retour terrible du théâtre bourgeois. Stéphane nous disait que ses élèves à l’INSAS devaient tous travailler pour pouvoir payer leurs études. Nous, on a pu s’inscrire là où les loyers n’étaient pas chers, on a pu travailler, on a pu faire Transquinquennal parce qu’on avait un chômage qui nous permettait de vivre. Toutes ces conditions-là ont disparu. Et nous, on est ailleurs. Et je me dis : cette réinvention-là, on n’est plus capable de la faire, on n’est pas dans les conditions, on est propriétaire de notre maison. Je ne suis plus celui que j’étais il y a vingt ans.
SO Notre potentiel symbolique, il est instrumentalisé par l’institution. Contre ça, on ne peut pas se battre. Pire : l’institution s’en sert contre nous-même. Et ça, c’est très très pénible.
S’arrêter, c’est essayer de mesurer la valeur de ce qu’on a fait. Si trois ans ou dix ans après, la valeur symbolique de Transquinquennal continue à exister et qu’il y a un manque, on aura accompli quelque chose. Quand on voit des gens qui parlent de nos spectacles sans les avoir vus, ça commence à m’intéresser.
ND La valeur au capital symbolique de Transquinquennal est construite à la fois par les spectacles, par le geste artistique mais aussi par les conditions du travail artistique. Et justement par ces questionnements permanents sur l’institution et y compris à travers l’instance du public. Cette trace-là ne peut pas se décliner uniquement en terme de nostalgie…
SO Je comprends tout à fait cette question et je ne pense pas qu’on l’ait résolue. Dès le début, le trajet le plus difficile et celui qui nous mettait le plus en danger était pour nous le plus intéressant. On n’a jamais eu l’idée de se battre contre l’institution en dehors de l’institution.
Le choix était fait à un moment : essayer de se mettre à l’intérieur, et d’essayer de travailler avec le langage de l’institution, de s’y confronter, et de potentiellement la redynamiser dans certaines formes. Ça marche parfois et parfois pas. Transquinquennal prend aujourd’hui cette décision-là parce que le milieu est figé. On a les mêmes interlocuteurs depuis trente ans… Dans certaines institutions, on a atteint le maximum de tolérance à Transquinquennal ! Certaines institutions ne nous tolèrent plus. Et ça, on doit faire avec…
ND « Ne nous tolèrent plus », c’est-à-dire ?
SO Ils voudraient qu’on soit comme les autres : qu’on produise des produits à la chaîne, tout en ayant la valeur symbolique de « progressistes ». Le problème, le danger, c’est que nous-mêmes pouvons avoir l’envie d’aller vers cette direction-là…
« On défend qu’il y ait une réévaluation continue des projets artistiques et en même temps, on ferait exactement l’inverse ? »