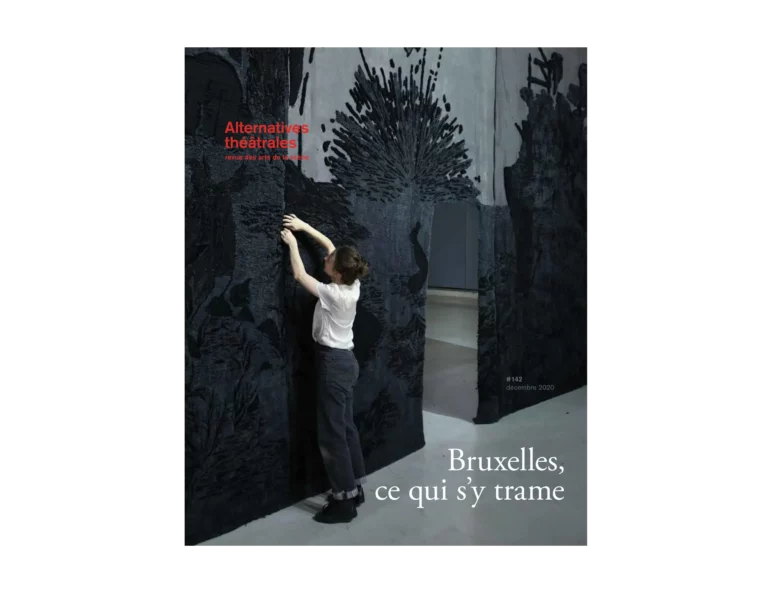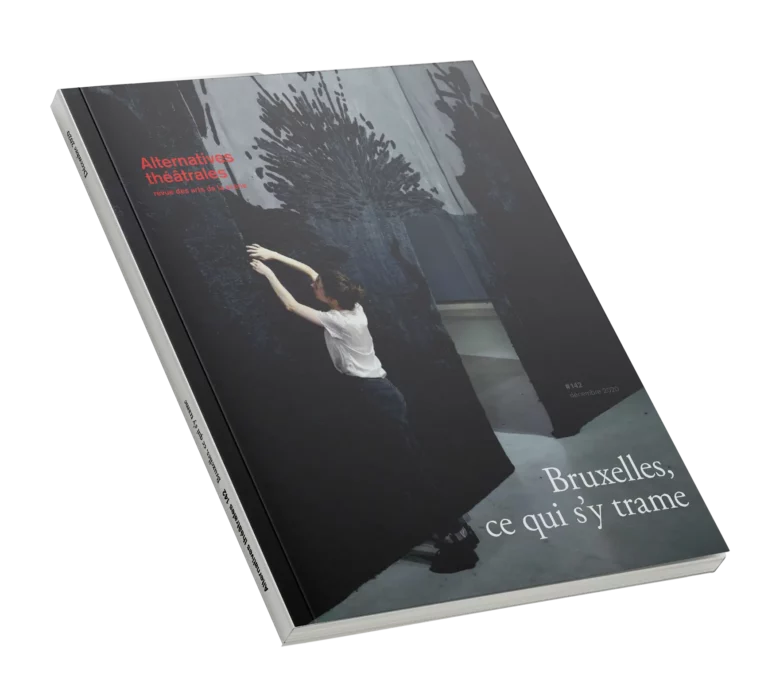Il est toujours difficile de reprendre même si cette difficulté est peut-être le propre d’une pratique qui a plus tendance à reprendre et rejoindre ce qu’un.e autre – metteur.e en scène, chorégraphe, directeur.rice de structure… – a lancé qu’à radicalement initier. Quand on exerce la pratique dramaturgique1, on sait que l’on vient toujours « après », que ça a toujours déjà commencé et que notre tâche consiste moins à tenter de « remonter » à l’idée originelle qu’à accompagner le déploiement, le prolongement et parfois la transformation de ce avec quoi l’autre partait. Accompagner des départs sans avoir à en connaître en amont la destination, se mettre au service des bifurcations, habiter une double attention qui prend soin tout autant de ce qui met quelqu’un.e en route que de tout ce qu’elle ou il va trouver, accidentellement, sur sa route : c’est dans cette zone sensible, sans contour fixe mais se reconfigurant à chaque nouvelle collaboration, que me semblent en effet se mouvoir certaines pratiques dramaturgiques contemporaines autour desquelles je me meus moi-même.
Reprendre, donc. Prendre sans entièrement maîtriser, sans avoir et sans chercher la propriété mais en ayant accepté le petit décalage qui pose, l’air de rien, l’espace d’une différence et d’une altérité tel que le contient le minuscule préfixe « re ». Reprendre, recommencer, ce n’est jamais répéter en pensant retrouver le même originel. Cela relève plutôt d’une confiance donnée à l’impossible identité et à la magie des trajets au sein desquels, comme le dit le philosophe Jean Borreil : « Il n’y a pas de revenir, il n’y a que des devenirs. »2 Pour une philosophe-dramaturge qui a fait de toute sa vie – tant intime que professionnelle – un perpétuel déplacement et qui s’est « formée » en ne cessant de reposer les conditions des possibles dé-formations, dé-centrements, désappropriations… une telle présentation de la reprise devrait entraîner adhésion joyeuse, à la fois apaisée et dynamisée, ainsi qu’élan prolongé en compagnonnage de chemins d’invention.
Pourtant, aujourd’hui, cette même singularité dit qu’il est particulièrement « difficile de reprendre » et elle le dit sans pouvoir faire si facilement de la difficulté une qualité propre à la pratique dramaturgique qui saurait la tordre du dedans pour en faire un ressort de création. Elle le dit sans pouvoir convertir le « dur » en « complexe », en complication que sait généreusement produire l’entrelacement du même et du différent. Elle l’écrit et, surtout, elle le vit en se sentant abîmée, amputée de ce qu’elle se confectionnait dans la reprise et qui confectionnait celle-ci dans une alliance, fine et épaisse à la fois, de mouvement et de stabilité. Elle perçoit l’invitation à la reprise en en ayant, comme cela est tellement craint en ce moment, « perdu le goût ». Mais justement, ce n’est pas le goût « normal » qu’elle voudrait retrouver en se fiant pour cela aux ordonnances des bons gestes, et en se méfiant, comme tout nous l’indique en ce temps de « pandémie », des potentielles altérations. C’est, au contraire, le goût déviant, fait de déviances et de torsions des ordonnancements que, jusqu’à présent, le fait de « reprendre » lui procurait.
Partout, au moment où elle écrit, au moment où j’écris, j’entends les annonces de « la rentrée » et les appels à « la reprise ». Et partout, tout le temps, je me sens privée de la dynamique d’un « reprendre » qui veut dire rencontrer, pour me trouver assignée au piétinement qui le fait rimer avec rentrer et retourner. Rentrer au foyer confiné après être retourné.e.s dans les institutions rigidifiées qui nous assurent, sans trembler, sans se voir en rien altérées, que rien n’a changé alors que nous savons bien que tout a changé. Nous sommes en septembre 2020 et, en effet, c’est la rentrée.
C’est la rentrée, la « reprise » des cours, des transports bondés, des emplois du temps surchargés et des charges qui pèsent sur la « responsabilité » de chaque travailleuse ou chaque travailleur qui doit décider de « rentrer » au lieu du travail ou de « rentrer » à la maison : ce qui compte c’est qu’il ou elle puisse faire au maximum « comme avant ». C’est la rentrée, c’est le rituel par lequel redémarre chaque année, et dans celle-ci, comme dans toutes les autres, on doit reprendre exactement dans les mêmes formes que précédemment, retrouver les mêmes usages, les mêmes visages en oubliant presque qu’ils sont à présent masqués. C’est la rentrée, rien n’a changé et pourtant, on le sait, tout a changé. Mais ce savoir sensible qui, lui, perçoit, dans le même martelé, la résistance de la transformation, le rythme des dissonances et la saveur des harmoniques plurielles qui font grincer les appels à l’unisson, lui, ce savoir savoureux, ne cesse d’être attaqué et capturé au moment où la reprise se voit confisquée. Elle est brutalement enfermée dans la case identitaire du retour au même qui efface ce que la reprise est ou, plus précisément, qui annule ce qu’elle fait. À présent elle est assurée ; les auteurs de son assurance sont les experts des santés et des normalités à retrouver et ses acteurs, comme son potentiel singulier d’action et d’agitation, sont arrêtés et forcés au mutisme et à la disparition. C’est la rentrée, c’est la reprise et nous sommes nombreux.ses à ne plus trouver aucune prise et à tout simplement perdre pied.
Alors oui, il est difficile de reprendre, difficile de s’inscrire sous un verbe qui définit l’inverse de ce que nous pensions qu’il faisait. La difficulté est d’autant plus ressentie ici qu’elle se joue pour moi à plusieurs niveaux. Elle commence dans le simple fait d’être invitée à « reprendre » une réflexion déjà entamée et partagée plusieurs fois et, en réalité, tout près d’« ici ». Beaucoup de mes réflexions autour de la dramaturgie se trouvent sur le site Internet de La Bellone que dirige celle qui, avec Caroline Godart, m’invite ici à écrire : Mylène Lauzon. À ce niveau-là, la difficulté s’éprouve donc d’abord comme une crainte de contradiction, une peur de finir par rigidifier ce qui est essentiellement fluctuant et mouvant et de le faire en répétant justement ce que je dis souvent à partir du terme même de dramaturgie qui, lui aussi, l’air de rien, implique le mouvement : face aux dramatiques qui ont pour centre unique le drama, autrement dit – ou comme le dit l’autre de l’étymologie grecque – l’action en tant que finie et achevée, la dramaturgie décentre ce drama en lui ajoutant la subtilité de l’ergon qui, lui, signifie, mouvement. La dramaturgie remet en mouvement le fini comme le défini et pouvoir parler d’elle ou avec elle implique donc de fuir les dé-finitions et de constamment inventer des manières déplacées de la présenter ou plus précisément de la faire expérimenter.
Or c’est là que la difficulté se redouble et passe du singulier au partagé. Car ce qui pourrait me préserver d’une forme de trahison quant à ce qui fait pour moi la dramaturgie ou quant à ce qu’elle fait et qui la fait résister aux dé-finitions ; ce qui pourrait en effet ne pas me faire tomber, par répétition assurée, dans le carcan de la représentation qui fige et donc rate la dynamique dramaturgique, c’est ce dont nous nous trouvons collectivement privés : la faculté d’expérimenter. Dans cette capture morbide de la reprise qui nous enjoint de recommencer « normalement » sur fond d’exceptionnel, de crise et d’urgence sanitaire prolongée, ce sont bien nos capacités à éprouver qui sont « contaminées ». Les conditions minimales de l’expérience que sont l’espace et le temps nous sont en effet chaque fois plus fortement enlevées. D’un côté, l’espace dense et sensible des mouvances est remplacé par la ligne droite de la restauration et du rétablissement des normalités supposées représentatives de la « santé » de nos sociétés – que l’on sait bien, pourtant et depuis longtemps, être malades, toxiques et intoxiquées. De l’autre côté, le temps disparaît, il n’y a plus de durée à éprouver, il n’y a que l’urgence et ses injonctions à agir vite et à suivre les mesures prises « vite fait ».
Depuis plusieurs années les É/états d’urgence s’installent en promettant leur rapide interruption, la libération proche des espaces publics et la restitution du temps commun.
Il y a cinq ans, il y a trois ans, il y a trois mois… il devait, il devrait y avoir un arrêt mais la fin ne vient pas et le temps nous est dérobé.
Ça ne s’arrête pas, ça reprend, c’est la rentrée. C’est la reprise : reprise de la circulation des avions et du virus, reprise des augmentations d’aide donnée aux PME et de celles du nombre de malades ou de personnes étant hospitalisées.… Tout se confond, les formes ne se distinguent plus, on perd, avec le temps qui nous est ôté, nos capacités à discerner et à considérer vraiment, profondément, ce que nous expérimentons. Plus d’espace, plus de temps, plus de sensibilité et d’expérimentation, nous avançons tête baissée comme une masse hyperanesthésiée. Or, étonnamment, c’est ici, en ce point maximal d’obscénité que nous nous voyons « massivement » toucher, que quelque chose continue de s’éprouver, en dehors de la fantasmée « totalité » et en débords de la représentation dramatique que l’on peut facilement en donner. L’expérience résiste au même moment où elle se voit exister à l’endroit d’une résistance qui, elle, se vit au croisement du singulier et du partagé. Une résistance que n’expriment aucun discours, aucun représentant, aucun corps trop molaire de la manifestation « anti-masque » ou anti telle ou telle mesure prise par un gouvernement, mais qui réside d’abord et seulement à l’endroit d’une sensation.
Nous sommes nombreuses et nombreux – sans doute bien plus que nous ne le pensons – à éprouver aujourd’hui l’âpreté d’une reprise et d’une rentrée et, tout simplement, à ne pas y arriver. Les corps boitent, les marches ne vont plus si droit, les yeux que l’on continue de pouvoir regarder sont fatigués et les souffles sont coupés, non pas par le port du masque mais par le déportement de la durée et l’emportement du temps. Tout va trop vite, on voudrait laisser déposer tout ce qui s’est renversé, on voudrait « saisir ce qui nous saisit »3, attraper ce qui nous attrape et qui nous fait passer d’un état à l’autre en un instant. On voudrait arrêter et expérimenter à nouveau le temps, non pas ce temps confiné auquel toute notre épreuve de la durée a été, pendant des mois, assignée en se comprimant, mais le temps réel, dense et épais car tissé des sensations et de leurs partages. On voudrait en somme « reprendre » les conditions de l’espace et du temps qui nous permettent d’éprouver que nous sommes vivants, que nous sommes mouvants, que nous sommes forcément changeant, devenant, et non « revenant » en forme de morts-vivants. On voudrait, on pourrait et le potentiel peut ouvrir des possibles d’incarnation et surtout d’expérimentation. C’est aussi cela qui constitue le trajet des créations et des inventions de formes et de partage de sensibilités que tente le si bien nommé et dont le nom fait du bien : « art vivant ». On peut reprendre le temps et rouvrir l’espace de nos croisements, on peut se déconfiner, vraiment.
La résistance de l’expérience rouvre ainsi la possibilité de la reprise : ce qui la rend possible et ce qu’elle rend possible. Ressaisir l’espace et le temps mais aussi et surtout pouvoir les redéployer, les désencastrer de ce qui, sous les noms d’urgence et de retour sans déviation, les a capturés. Pouvoir les refaire circuler et nous laisser, avec eux, bouger. Cela peut commencer en effet par la réinsertion du mouvement dans cet apparent arrêt généralisé, par la perturbation des linéarités posées entre un début et une fin identifiée, et par la torsion du trajet simplifié en retour et destination déjà fixée.
En somme, l’expérience peut reprendre et redémarrer par une « reprise », reprise par une pratique qui a fait de la résistance à l’arrêt sa première dynamique, elle peut être relancée par la dramaturgie et plus précisément par une dramaturgie qui agit au nom de l’impossibilité des arrêts, en faveur des durées partagées et en s’occupant des espaces qui permettent ces dernières.
Les espaces qui prennent soin du temps commun et du temps du commun tel qu’il ne se décrit pas, ne se planifie pas, ne se décide pas par des un.e.s pour des autres mais s’éprouve à plusieurs, qui existent et portent un nom. Le philosophe Maurice Merleau-Ponty, entre autres, appelle ces organisations qui « donnent de la durée aux expériences » des « institutions »4. Dans ces espaces que l’on reconnaît comme relevant de nos dessins d’humains pensant-parlant-rêvant, de nos inscriptions et de nos manières de nous inscrire dans l’espace et le temps, nous fabriquons les conditions d’un soin donné à ce à quoi nous tenons. Depuis plusieurs années, j’ai trouvé dans l’occupation de certaines institutions, le milieu « ajusté » pour déployer la dramaturgie à laquelle je tiens et qui circule des plateaux artistiques aux places politiques en passant par des scènes théoriques conflictuelles. Aujourd’hui plus que jamais j’y vois des ressorts pour continuer, ensemble, de circuler, pour résister à l’assignation.
À La Bellone, dans le cadre des séminaires de dramaturgie et surtout des conversations dramaturgiques que j’ai avec des artistes en résidence qui se vivent comme des expériences de codéplacements, tout comme au théâtre Nanterre-Amandiers au sein du cycle Mondes possibles, je crois que c’est cela que l’on fait. Se rencontrer, « reprendre » sensibilité et vivacité grâce à l’autre qui raconte son trajet d’invention, mais aussi reprendre pied, ensemble, dans ce que nous habitons et que l’on peut habiter autrement qu’en fonction des appels à la rentrée ou au confinement. Tout autour de nous se déploie le paysage sur fond duquel nous nous parlons, nous partageons des expériences et pouvons passer des ordonnancements forcés au désordre propre au vivant que l’on décide, justement, de soigner.
Saisir, percevoir ce qui nous écrit pour écrire différemment, voilà ce qui constitue pour moi la vitalité de certaines institutions et ce qui, en les occupant de nos présences dramaturgiques, nous offre des vivacités d’attention et, tout simplement, nous rend vivant.e.s.
Dans un présent morbide, elles peuvent constituer des poches de respiration et nous donner un droit à respirer, non plus ponctuellement mais dans une durée épaisse et éprouvée à égalité. Des institutions comme La Bellone ou comme le cycle Mondes possibles peuvent nous laisser sentir l’air d’un présent où il est impossible de recommencer mais où l’on devrait tout reprendre en altérant et en redistribuant ce qui fait altération et ce qui, réellement, nous redonne santé.
- Nous nous référons dans cet article aux « pratiques dramaturgiques » et non à ce que l’on connaît davantage, dans la tradition théâtrale, comme « écriture dramatique ». Un.e dramaturge accompagne un.e artiste (metteur.euse en scène ou chorégraphe le plus souvent) au cours d’une création, soucieux.se de ce qui se dessine « entre » intentions de l’artiste, réalisation scénique ou du moins physique et perception que peuvent en faire les spectateurs. ↩︎
- In La raison nomade, Éditions Payot et Rivages, 1993. ↩︎
- Selon la formule de Marshall McLuhan. ↩︎
- Voir notamment : L’Institution, la passivité. Notes de cours au Collège de France (1954 – 1955), Maurice Merleau-Ponty. Éditions Belin, 2003, p. 6. ↩︎