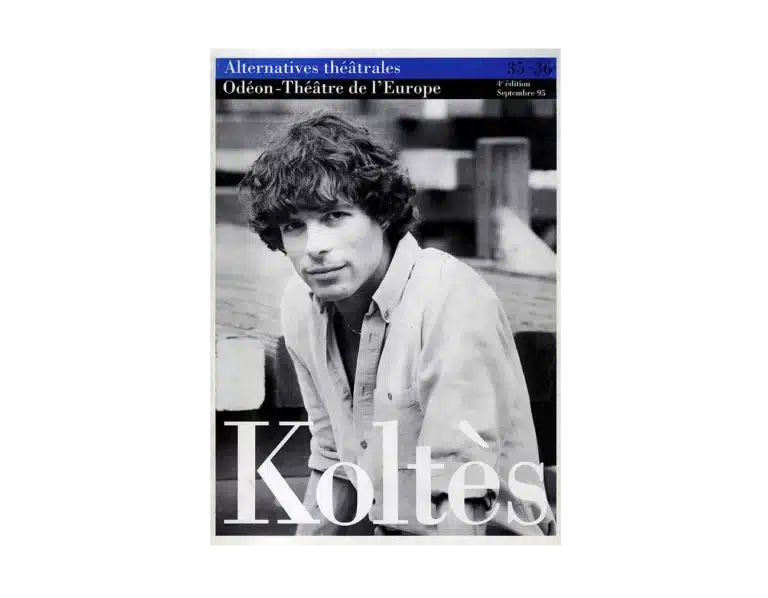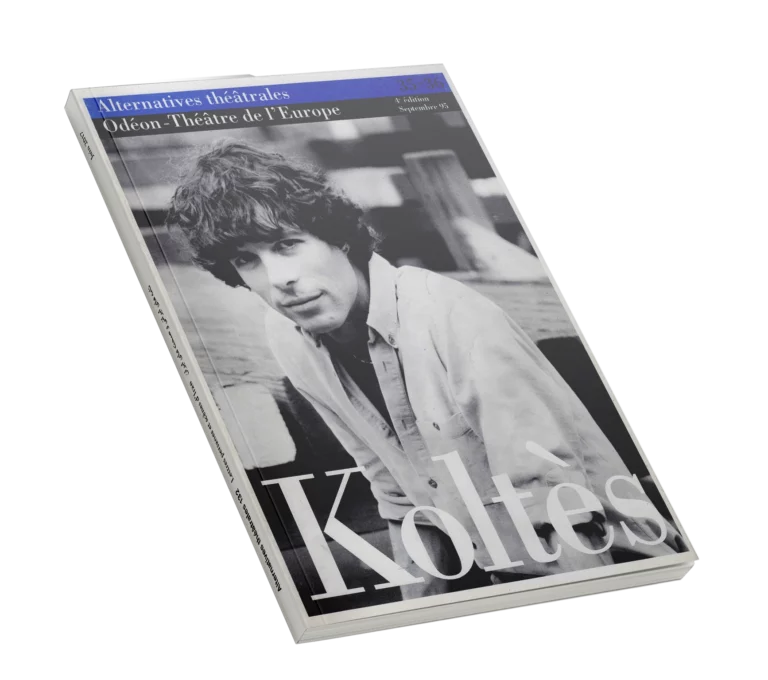« Why grow the branches now the root is wither’d ?
Why wither not the leaves that want their sap ?»
Pourquoi les branches poussent-elles encore, alors que la racine est desséchée ?
Pourquoi les feuilles ne dessèchent-elles pas, alors qu’elles sont privées de leur sève ?
Shakespeare, RICHARD III (exergue au RETOUR AU DÉSERT)
Une plante qu’on a coupée trop vite et à qui l’on tâche de faire prendre racine dans un terreau étranger souvent s’y refuse et dépérit ; mais si un habile jardinier s’obstine et que, sur des générations, inlassablement, il coupe tôt les racines, il taille, hybride et bouture soigneusement, il finit par faire renaître une nouvelle plante aux facultés d’adaptation infinies ; de telle sorte qu’on peut mutiler une fleur par le bas, par le haut, de tous les côtés, sans que jamais l’instinct de vie ne soit mis en défaut, comme si le souffle de l’existence pouvait varier indéfiniment de foyer, qu’à l’extrême mutilation correspondait l’extrême souplesse de la vie.
Bernard-Marie Koltès
«Douze notes prises au Nord »
LE RETOUR AU DÉSERT reste la seule pièce de l’œuvre de Koltès qui se passe nommément en France, en province, et en un temps relativement précis, le début des années soixante. Ce marquage et le rapport, plusieurs fois souligné par Koltès, avec sa propre biographie, donne d’emblée à la pièce un statut différent des autres. Analysant l’univers de Koltès de LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS à DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON, Michel Bataillon notait : «… le point que Koltès affectionne, c’est cette étrange zone de contact entre la vie policée et le monde sauvage, cette lisière où rien n’est jamais acquis, où la ville et la jungle tantôt s’affrontent tantôt font bon ménage »1. Une rue, une cité de chantier qu’entoure l’Afrique, un hangar désaffecté de l’ancien port dans une grande ville occidentale, un no man’s land entre deux îlots d’habitation : tels sont les lieux qu’investit le théâtre de Koltès. Avec LE RETOUR AU DÉSERT, Koltès, le « flâneur infatigable », rentre à la maison. Il s’amuse, dit-il, à écrire des scènes en intérieur, des scènes qui se passent « à l’heure du petit déjeuner ». Et pourtant, à l’intérieur de la clôture choisie, il va exercer une Liberté d’écriture totale, une liberté toute neuve, acquise sans doute grâce à la rencontre avec Shakespeare (la traduction du CONTE D’HIVER précède immédiatement LE RETOUR). Koltès qui disait, au moment de QUAI OUEST, avoir découvert la nécessité de La règle des trois unités, Koltès met paradoxalement en scène, avec LE RETOUR, le lieu le plus ouvert, la temporalité la plus libre, l’action la plus plurielle de tout son théâtre. Il rentre à la maison, il retourne vers son passé, mais c’est pour les reconstruire de bric et de broc, ouverts à tous les vents, traversés de lignes de fuite et de trous de mémoire.
« Je vois un peu le plateau de théâtre, écrivait-il, comme un lieu provisoire, que les personnages ne cessent d’envisager de quitter. C’est comme le lieu où l’on se poserait le problème : ceci n’est pas la vraie vie, comment faire pour s’échapper d’ici »2 De la clôture provinciale du RETOUR, on s’échappe en définitive comme on veut, quand on veut : ses murs n’ont été construits que pour offrir le plaisir de les sauter, son jardin est le lieu des rencontres les plus imprévues, on y tombe du ciel ou on s’y envole avec la même facilité. Rien de l’enlisement de QUAI OUEST, du piétinement de LA NUITou de la SOLITUDE, de l’empiègement de COMBAT. On change d’endroit sans cesse, on parcourt la maison en enfants curieux et imaginatifs, une grande maison pleine de recoins propices aux secrets et aux évasions. Cette liberté, ROBERTO ZUCCO vient maintenant la confirmer : d’intérieurs en extérieurs, appartement, rue, hôtel, métro, cuisine, gare, jardin, la cavale de Zucco fait tout communiquer, et même la terre directement avec le soleil. Il suffit de ne pas voir les obstacles, et ils tombent tout seuls, dit Zucco, et on s’échappe de n’importe quelle prison. Il suffit, dit Edouard dans LE RETOUR de cesser deux secondes de s’agripper à la planète et on se retrouve à voltiger dans l’espace.
Même liberté dans la temporalité de la pièce. A la lecture, le texte est pris dans un double système temporel. La pièce combine en effet deux divisions en cinq temps, la première d’ordre dramatique et rythmique (chaque temps est divisé en trois ou quatre scènes alternativement), et la seconde (qui ne recoupe pas la première) d’ordre rituel : les quatre premiers temps ont pour titre (mais non pas dans l’ordre naturel) quatre des cinq prières de la religion islamique (SOBH, à l’aube ; ZOHR, à midi ; ‘ICHÂ, la nuit ; MAGHRIB, le soir); le dernier temps, qui coïncide avec la dernière scène du V, porte le nom de la fête qui marque la fin du Ramadan ; cet ordre rituel est donc lui-même hétérogène, mêlant un rythme journalier et un rythme annuel.