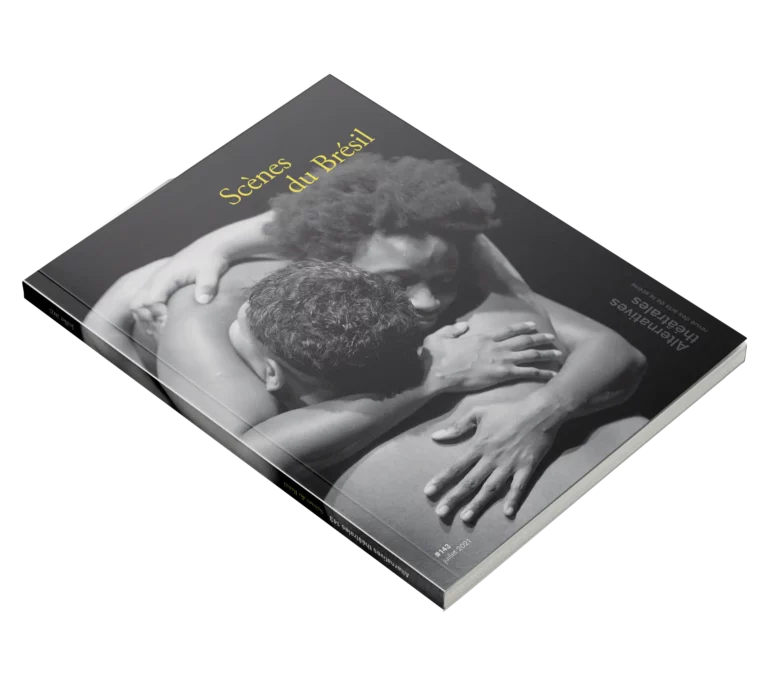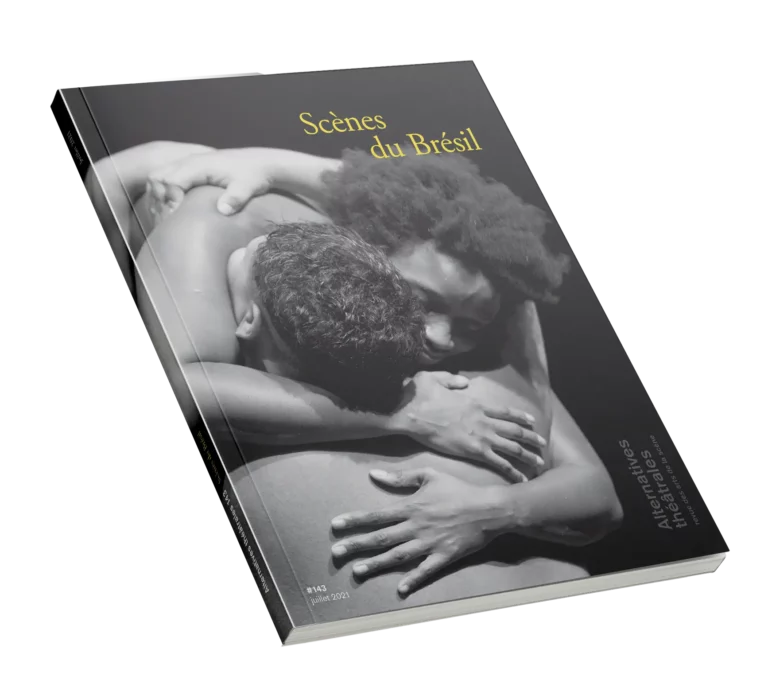Luiz Davi Vieira Gonçalves est performer, metteur en scène, anthropologue et professeur de Licenciatura en théâtre1 à l’Universidade do Estado do Amazonas (Université de l’État d’Amazonas). Il dirige le groupe de recherche Tabihuni enregistré au CNPq. En qualité d’artiste-anthropologue, comme il se définit lui-même, il a travaillé pendant plusieurs années avec les Yanonami, sous-groupe des Yanomami, dans la région du Maturacá dans l’Alto do Rio Negro, en Amazonie, à la frontière du Brésil avec le Venezuela. En cherchant à comprendre les pratiques corporelles mises en œuvre dans le cadre de rituels indigènes, il a été profondément affecté par l’univers du groupe en question au point que cela a entraîné de profondes transformations dans ses pratiques artistiques et pédagogiques.
Briser le langage pour toucher la vie,
c’est faire ou refaire le théâtre.
Antonin Artaud
Vous êtes enseignant à l’université et directement engagé dans la formation de professeurs de théâtre qui auront un rôle à jouer au sein des cycles d’enseignements primaires et secondaires. Qui sont ces jeunes étudiants, et quelle est la motivation qui les amène à rechercher cette formation ?
Quels élèves nous avons et quelle formation nous voulons ? Ici, à Manaus, c’est le cœur de nos questionnements. Nous avons réuni dans la formation des élèves complètement différents les uns des autres. Il y a l’étudiant qui vient parce qu’il veut jouer à la télé. Il y a celui qui vient de territoires éloignés des grands centres urbains et qui cherche une première formation dans le domaine des arts parce que, dans sa ville d’origine, il a côtoyé des formes spectaculaires traditionnelles, par exemple. Et maintenant, depuis environ trois ans, nous recevons un autre profil d’étudiants au sein de l’université : des indigènes, qui sont en train d’arriver en nombre. Parmi eux, il y a ceux qui sont nés en ville et qui ont déjà eu quelques informations sur l’enseignement du théâtre ; ceux qui ont reçu une formation de base au village, ou parfois au sein d’écoles, souvent salésiennes, dans la ville la plus proche ; ceux enfin qui viennent directement d’une communauté amérindienne et qui ne parlent pas portugais. Ces étudiants, en arrivant dans les grandes villes, vivent des expériences très lourdes, car, avec ce changement de territoire, ils ont beaucoup d’informations à assimiler en même temps. Il existe également une forte présence du mouvement noir dans nos cours, avec des étudiants quilombolas2. Ainsi, nous avons un groupe d’étudiants dont l’envergure, par sa pluralité, est merveilleuse. Mais cette envergure implique beaucoup d’attention et de réflexion lorsque l’on travaille sur notre structure pédagogique. Il y a quelque temps, j’ai été contacté par Célia Bettiol, une professeure en Sciences de l’éducation d’ici. Comme elle avait accompagné mon travail avec les Yanomami, elle m’a proposé de développer un projet que nous avons appelé « Dialogues Interculturels ». Notre idée a été de mettre en pratique, en tant que méthodologie, la notion kõkamõu qui signifie « agir ensemble, d’un commun accord » dans la langue des Yanomami. Avec une professeure en linguistique, Jeiviane Justiniano, qui connaît des langues indigènes, nous avons commencé à travailler à partir du domaine des arts et de l’anthropologie pour consolider un projet intitulé « Tecendo Diálogos Interculturais » (« Tisser des dialogues interculturels ») et, surtout, pour penser la manière dont nous pourrions travailler avec ces indigènes qui arrivent à l’université.
Nous avons vingt indigènes dans le projet, et six tuteurs blancs. Ensemble, nous agissons dans une perspective kõkamõu, c’est-à-dire qui prend en considération de la même manière les réalités de toutes les parties prenantes, et réfléchissons à la façon d’accueillir toute cette diversité et de développer des activités qui aident à faire que leur présence ici soit réellement effective. Et ce, sans leur imposer un modèle. Notre intention est d’intégrer les particularités de la culture indigène et de remettre en question le cadre parfois vertical de l’université.
Comment conçois-tu l’enseignement du théâtre à l’adresse de ces étudiants ? Quels sont les contenus prévus dans cette formation ?
Il y a une base préétablie : nous abordons des auteurs comme Stanislavski, Brecht, etc. Il existe de grandes tensions entre nous, professeurs, lorsqu’il s’agit de préparer les cours et de penser les contenus pédagogiques. On m’a déjà dit en réunion « non, là tu parles d’anthropologie, ce n’est pas du théâtre » parce que je voulais, notamment, penser l’expression corporelle à partir d’une perspective indigène. Par exemple, j’aimerais travailler cosmologiquement le thème du corps. Plutôt qu’enseigner la notation Laban, je préfèrerais inviter un indigène tukano qui fait son doctorat en anthropologie pour qu’il nous explique la notion cosmologique du corps et que nous essayions de l’expérimenter tous ensemble.
Ce genre de choix génère des tensions et nécessite donc du tact. Nos collègues sont jeunes, parfois nous nous trompons, mais nous acceptons les erreurs. Et c’est vraiment bien parce que, d’une certaine manière, nous sommes en train de réussir à prendre en compte ces perspectives davantage plurielles que l’Amazonie nous demande.
Mais je considère que c’est encore trop peu. J’aimerais que ce dialogue soit plus ouvert et plus récurrent. Nous pourrions par exemple créer un concours pour recruter un enseignant indigène qui serait force de propositions et dont la pédagogie serait plus adaptée à nos différentes formations. C’est quelque chose que je revendique. Mais je pense qu’on doit avancer pas à pas.