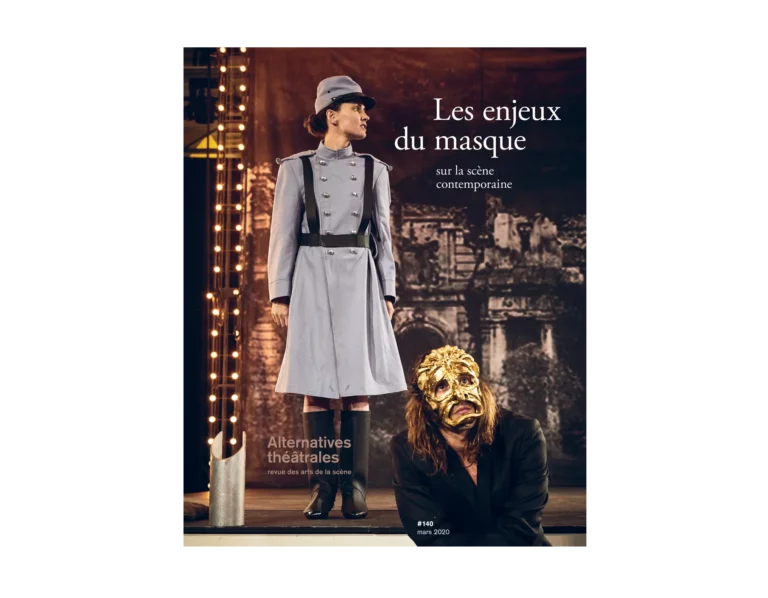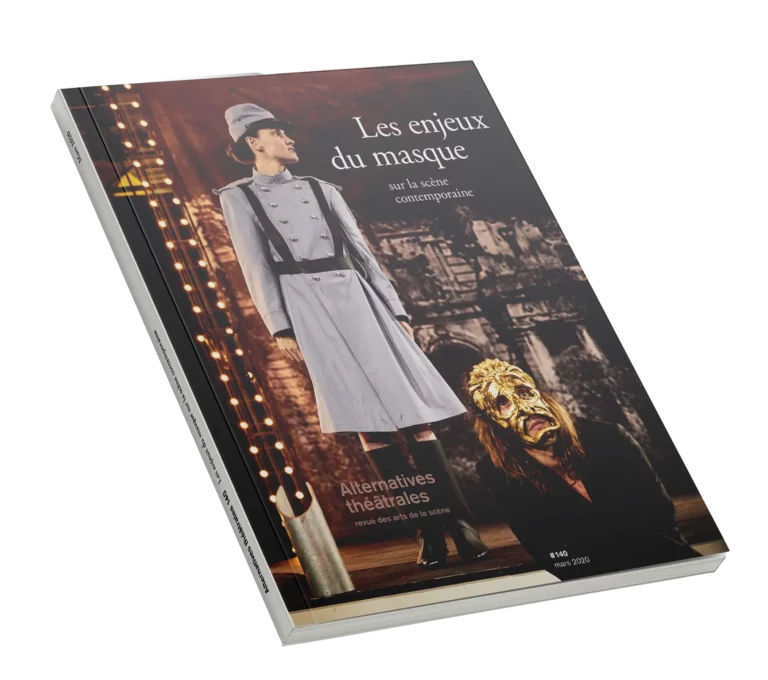La performance, « l’art-action », entretient avec le masque une triple relation. Tout d’abord, l’image historique de Dada s’imposant, l’on peut penser à ces masques de carton d’Hugo Ball, d’où sortaient de longs hululements, des cris, des vociférations, ou une puissante poésie, puisque de langage réinventé : blago blunt blago blunt blago blunt ! Or, ces sons ne sont pas ceux d’un interprète au sens traditionnel du terme. Ridicule et enfantin, le masque conçu comme costume entier délivre un message mythique où le comédien doit disparaître dans sa subjectivité.
Aussi semblerait-il, ici en tout cas, que l’on puisse sans mal se référer à Nietzsche dont les rares analyses sur le masque sont des plus pertinentes. Pour l’auteur du Zarathoustra, le masque est avant tout ce qui permet d’échapper à la subjectivité de l’acteur. Le masque impose un rôle sans compromis ni arrangement possible, pour le dire plus crûment le masque est ce qui permet d’échapper à « l’histrionisme »1. L’acteur masqué se fait la figure hiératique de la parole et du cri qu’il profère : il a toujours quelque chose à voir avec la défiguration. Sortir du figuré pour rejoindre le sens propre ; sortir du visage pour opter pour le triomphe du personnage ou plutôt du très lointain appel de celui-ci sur l’acteur.
L’on peut aussi songer à Alejandro Jodorowsky qui, dans son théâtre de la guérison, appelle le « panique » contre le « tragique »2 ; le panique qui parcourt le chemin inverse des anciens conservatoires, chemin qui est précisément celui du masque.
Le masque du performeur rappelle par exemple que sa nudité n’est sienne qu’à proportion où aucune réelle identification n’est possible ; si Claude Boudeau3 disparaît sous son masque de saumon, c’est qu’il s’agit non d’un numéro d’acteur mais d’une incarnation. Et son caractère non subjectif, sans recherche d’effets d’aucune sorte, nous permet de saisir la portée universelle du message. L’indifférence vaguement amusée ou surprise des buveurs dans ce café d’Athènes entre dans la signification sans qu’on applaudisse au brio ou que l’on s’identifie au comédien. Actant, il est sujet libre, certes, mais non interprète.
La parole de Nietzsche à l’égard de l’opéra wagnérien – devenu à Bayreuth un petit théâtre de pacotille et d’allégories vides – nous fait comprendre à l’inverse son goût du masque. Cet orientaliste d’un hellénisme hors pair le sait bien, lorsque Tristan se révulse et que vient le temps de la surenchère gestuelle ou sonore, le mythe s’efface devant la propagande.
Le masque, chez Nietzsche, dans son refus de toute contamination subjective, est comme le point aveugle vers lequel se tendent tous les performeurs véritables, celui d’être soi, loin de toute subjectivité.
Peut-être devons-nous éclairer ce point crucial : le sujet, comme sa polysémie l’indique, est toujours assujetti. La ruse de la subjectivité est de faire croire que la sincérité se confond avec la vérité ou, plutôt, pour rester dans le vocabulaire du penseur de Haute-Engadine, de la valeur. Or, précisément elle ne vaut rien, elle est le simple produit de ces endoctrinements simplistes qu’on nomme pompeusement « éducation » ou « culture » ou « religion » et de ce conditionnement social qui fait de ces acteurs des pantins aux fils solides, toujours en laisse.
Au contraire, le masque, paradoxalement, libère. En faisant taire la subjectivité, l’assujetti disparaît pour laisser parler le sujet véritable, le très enfoui, dont il a fallu détruire la gangue à coups de marteau pour que triomphent enfin l’enfant et sa liberté véritable de sujet vaillant. Le masque, en somme, permet de devenir ce que l’on est.