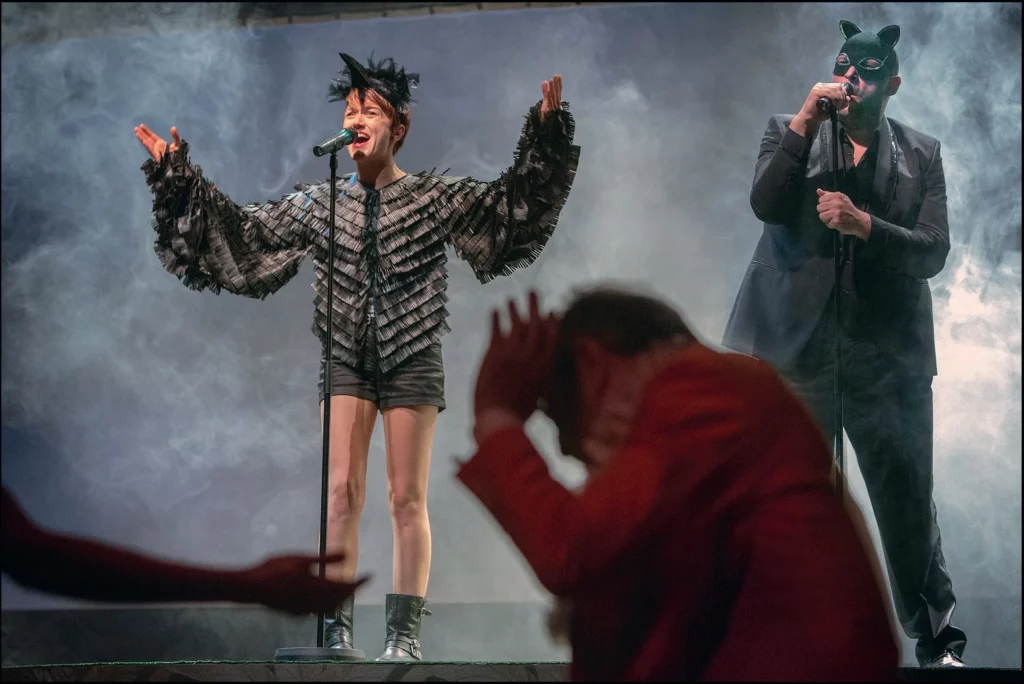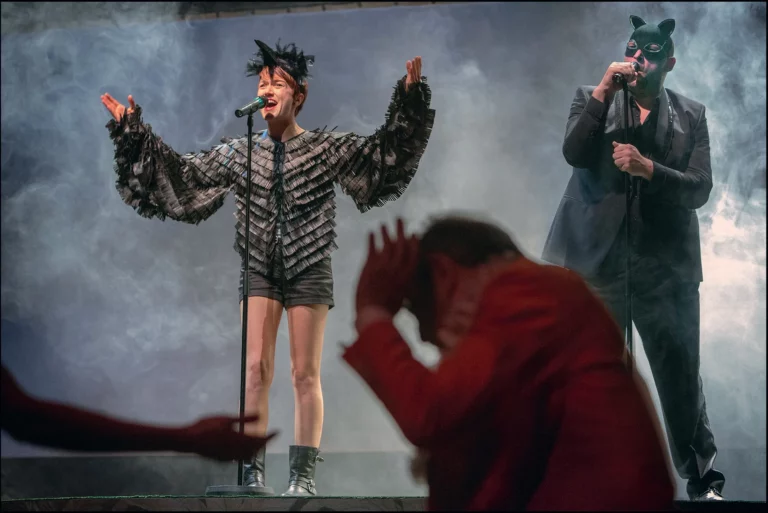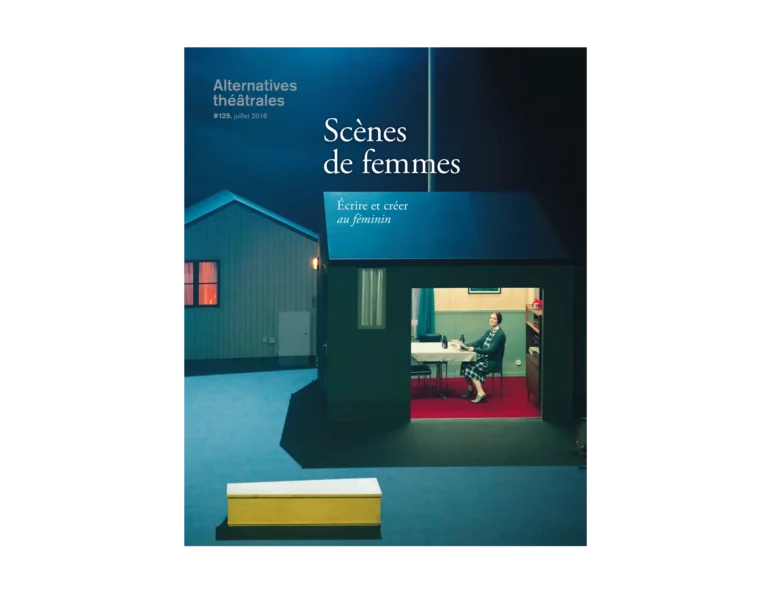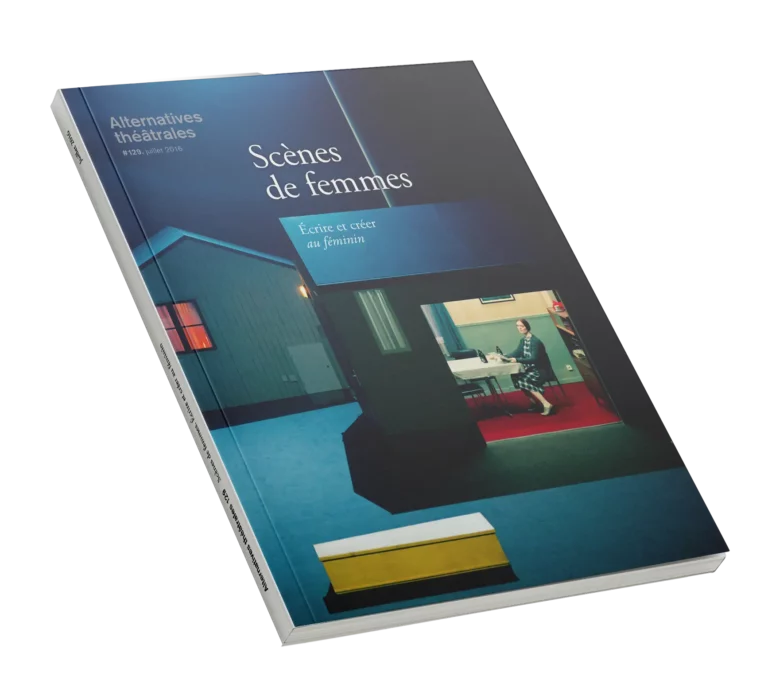Débat conçu et animé par Sylvie Martin-Lahmani, codirectrice d’Alternatives théâtrales.
Participants : Muriel Genthon, Haute fonctionnaire à l’Égalité femmes-hommes, Ministère de la Culture et de la Communication, Sophie Deschamps, présidente de la SACD en France, Clotilde Thouret et François Lecercle, directeurs du projet Haine du Théâtre (Labex Obvil, Paris-Sorbonne), Phia Ménard, jongleuse et metteuse en scène (Cie Non Nova), Judith Depaule, metteuse en scène (Cie Mabel Octobre), directrice artistique de Confluences, fut en charge du dossier « parité » au Syndeac, Inès Rabadan, présidente du comité belge de la SACD en Belgique, Selma Alaoui, comédienne et metteuse en scène, Belgique (programmée au CWB en mars 2016, Homme sans but), Christine Letailleur, metteuse en scène (programmée au Théâtre de la Ville en mars 2016, Les Liaisons Dangereuses).
SML Nous avons le plaisir d’accueillir des artistes, des intellectuels et/ou des responsables d’institutions qui ont bien voulu réfléchir avec nous à la création au féminin, puisqu’aujourd’hui c’est LA journée consacrée aux droits des femmes… Pour aborder ce vaste sujet, j’ai demandé à deux universitaires spécialistes de littérature et de théâtre de bien vouloir nous éclairer sur la place des femmes dans le domaine du spectacle vivant. Leur approche historique nous permettra d’appréhender la situation actuelle dans toute sa complexité. François Lecercle et Clotilde Thouret, enseignants à la Sorbonne, sont également les directeurs du projet Haine du Théâtre (Labex Obvil, Paris-Sorbonne). Une de leurs dernières séances de travail était consacrée à un aspect qui nous intéresse singulièrement : « La Haine des femmes ».
François Lecercle et Clotilde Thouret ont choisi de parler de la place des femmes en tant que dramaturges, théoriciennes, actrices et spectatrices, à l’époque moderne (XVIIe–XVIIIe)1. Nous présentons dans ce numéro un article qu’ils ont co-signé : « Misogynie et théâtrophobie : les femmes et les controverses sur le théâtre ».
Muriel Genthon, vous êtes haute fonctionnaire chargée de l’Égalite femmes-hommes au Ministère de la Culture et de la Communication. L’objet de votre intervention est de dresser le « panorama » des inégalités entre hommes et femmes dans les domaines couverts par vos études (le champ de la culture et de la communication). Lors de nos premiers échanges, nous avons pensé qu’il était fondamental d’ouvrir le débat avec des constats chiffrés, dans le champ du spectacle vivant, parce qu’ils sont sidérants et affligeants – comme dans les autres secteurs de la société d’ailleurs –, et parce qu’ils conditionnent consciemment ou pas les gestes artistiques.
MG Oui, j’interviens en tant que haute fonctionnaire chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes au Ministère de la Culture et de la Communication. Ces postes, qui existent dans tous les ministères, ont été mis en place en 2012, lorsque le gouvernement a souhaité que cette politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes prenne plus de force et soit appliquée dans tous les secteurs de l’action de l’État, et donc en particulier au Ministère de la Culture. Le rôle du haut fonctionnaire est d’évaluer dans quelle mesure on peut progresser, dans les secteurs culturels comme à l’intérieur de l’administration, sur l’égalité professionnelle, sur la mixité des métiers, sur la question des stéréotypes. Il y a beaucoup de sujets qui concernent notre activité au Ministère de la Culture, à la fois à l’intérieur de la maison, c’est-à-dire tout ce qui touche les agents, les rémunérations, les promotions, les nominations, et puis tout ce qui a trait aux politiques publiques, ce qui nous préoccupe davantage aujourd’hui.
Nous n’avons pas commencé en 2012. Il y a eu, en 2006 et 2009, les deux rapports de Reine Prat, qui ont montré pour la première fois à quel point, dans le secteur du spectacle vivant, les femmes n’étaient pas l’égal des hommes. Entre-temps, et depuis 2006, on constate quelques progrès, mais significativement peu pour ce secteur. Signalons, en 2013, une circulaire qui exigeait la parité dans les jurys de nomination d’un directeur ou directrice pour un établissement labellisé, et la parité également dans le choix des pré-sélectionné.e.s. C’est un levier qui permet de donner plus de poids aux candidatures de femmes, et surtout de faire émerger des femmes qui, sans cette disposition, n’oseraient peut-être pas candidater. Personnellement, j’étais DRAC en Île de France et le fait d’être contraint à des listes paritaires a permis de faire monter des femmes qui n’auraient pas pu émerger sans cela. Mais cela reste insuffisant, les chiffres le montrent. Je vais vous parler des derniers chiffres qui ont été publiés au mois de mars dans l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes par le ministère de la culture, par le Département des Études, de la Prospective et des Statistiques (DEPS), qui dévoile au grand jour les chiffres de l’égalité femmes/hommes sur tous les secteurs du Ministère de la Culture et de la communication.
En 2016, il est assez désespérant de constater, notamment en ce qui concerne les établissements du spectacle vivant (Théâtres nationaux, les centres chorégraphiques nationaux, scènes musicales, les CNAR, les opéras, les orchestres, centres nationaux d’arts du cirque, d’arts de la rue, etc.) que 8 % seulement de femmes sont directrices ou présidentes. Pour les théâtres nationaux, une seule femme sur onze établissements. Les chiffres sont un peu meilleurs sur les établissements labellisés (c’est-à-dire des nominations conjointes entre le Ministère de la Culture et les collectivités territoriales), où seuls 26 % sont dirigés par des femmes. On sait bien que 30 % est le seuil d’invisibilité, et qu’en dessous, on ne les voit pas. Nous y sommes. Seules 11 % de femmes sont à la tête de centres chorégraphiques nationaux, et 10 % pour les scènes de musiques actuelles.
Autre constat plus décourageant : plus le budget est important, moins il y a de femmes à la tête des établissements. Dans les établissements où le budget est inférieur à 500 000 euros, on trouve 56 % de femmes à la direction, tandis que lorsque le budget est de l’ordre d’un million d’euros, il n’y a plus que 26 % de femmes. Même constat dans le cinéma.
La programmation des théâtres montre une inégalité importante. On constate que 27 % des femmes sont programmées parmi les metteurs en scène et chorégraphes présents dans les saisons de nos théâtres. Si l’on prend en compte les spectacles jeune public, on monte à 40 %. C’est sans doute ce phénomène, qui assigne les femmes dans certains secteurs, qui permet de faire remonter un peu la moyenne. Par rapport au nombre de représentations, c’est 25 % de celles-ci qui sont conduites par des femmes, ce qui montre que les femmes bénéficient d’un plus petit nombre de représentations de leurs spectacles que les hommes.
L’Observatoire délivre quelques chiffres sur la reconnaissance artistique des femmes, basés sur les Victoires de la Musique et les Molières : il y a 25 % de Victoires remportées par des femmes pour les albums, 0 % de Victoires dans le secteur du jazz, 17 % dans le classique et 0 % de femmes primées sur les 7 % de femmes participant aux Molières. Et pourtant, la parité est de mise chez les étudiants qui font des études dans le secteur artistique. Qu’en est-il de leur avenir ? Il semblerait que la parité se constate en début de carrière, et qu’avec le temps, le fossé se creuse. Ce phénomène est très prégnant dans le secteur de l’audiovisuel et de la publicité, où il y a 5 % seulement de femmes qui sont chefs d’entreprise.
Enfin, on constate les inégalités de rémunération, un écart de 11 % entre les femmes et les hommes pour les contrats d’artistes, et de 17 % pour les contrats de techniciens.
Que fait-on maintenant de ces chiffres ? Tout d’abord, il faut savoir que le secteur des arts vivants est l’un des secteurs les plus inégalitaires envers les hommes et les femmes dans le domaine culturel. C’est la raison pour laquelle il est urgent d’agir. Plusieurs pistes pourraient être explorées. Dans la mesure où le Ministère de la culture soutient beaucoup de structures, lieux, compagnies, il serait efficace de proposer que, pour chaque contrat, convention, signés avec un organisme de spectacles vivants, la question de l’égalité des sexes apparaisse. Sans imposer nécessairement telle ou telle mesure, il serait important que chacun prenne conscience de ces inégalités en les mesurant. Première obligation qui ferait progresser les choses. À partir du moment où chaque responsable d’institution ou de compagnie prendra la mesure de ces inégalités, il sera à même de les corriger.
Pourtant, il existe des résistances. Certains diront que la liberté de programmer est fondamentale. Nous en sommes d’accord. Mais les conventions sont d’ores et déjà assorties de conditions sur l’éducation artistique, sur la création contemporaine ou l’emploi d’artistes. Elles constituent un cadrage dans lequel s’inscrivent les missions de service public, et l’égalité entre les femmes et les hommes en fait incontestablement partie. Néanmoins, ces mesures peinent à se mettre en place. Je pense que c’est par la persuasion vis-à-vis des acteurs culturels, et la plus grande prise en compte politique de ces questions que l’on pourrait parvenir à de plus grands résultats. C’est en tous cas ce à quoi je m’efforce.