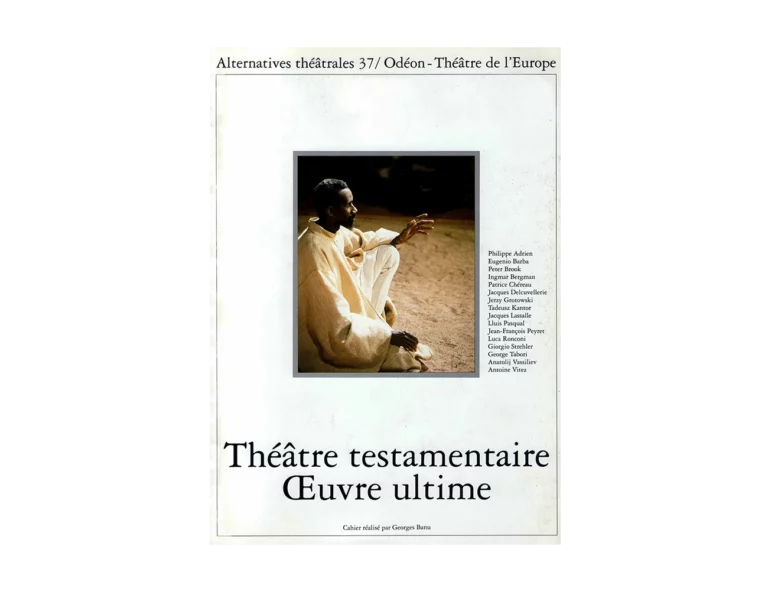« Nous devons faire renaître cet impact originel de l’instant où un homme (acteur) est apparu pour la première fois en face d’autres hommes (spectateurs) exactement semblable à chacun d’entre nous et cependant infiniment étranger, au-delà de cette barrière qui ne peut être franchie. »
Kantor, Le THÉÂTRE ET LA MORT
AVANT de devenir décor ou machine, le théâtre est un site : paysage achéron ; lieu d’intense communication entre les vivants et les morts.
Que dit au juste Genet, lorsqu’il exhorte Blin, metteur en scène des PARAVENTS, à ce que tout soit « réuni afin de crever ce qui nous sépare des morts » et à « tout faire pour que nous ayons le sentiment d’avoir travaillé pour eux et d’avoir réussi », sinon que les défunts forment la multitude du public, dans laquelle va se fondre, et se trouver ainsi légitimée, la minorité des spectateurs vivants ?
Pour commencer, hasardons ceci : l’acteur comme un spectateur avancé, simplement plus engagé que le spectateur dans ce commerce avec l’invisible qu’implique l’acte théâtral. Le temps de la représentation, la mort enveloppe le spectateur, mais l’acteur, lui, elle le travaille.
Le seuil
Et si ce qu’on appelle le personnage (que l’acteur va prendre en charge, comme sur ses épaules) n’était qu’un effet de ce passage de limite ou de frontière, de ce franchissement de seuil ou de cette prise de champ qui nous permet, au théâtre, de saisir la vie depuis la mort afin de la mimer et de la dire en entier ?
L’Antigone de Sophocle, paradigme du personnage dramatique, pour laquelle « la vie n’est abordable, ne peut être vécue et réfléchie, que de cette limite où déjà elle a perdu la vie, où déjà elle est au-delà — mais de là, elle peut la voir, la vivre sous la forme de ce qui est perdu » (Lacan, Le SÉMINAIRE, Livre VII : L’ÉTHIQUE DE LA PSYCHANALYSE).
Au seuil de l’invisible, non pas d’outre mais de la tombe, celui qui se sait dès la naissance condamné à disparaître délivre son « testament de mort ». Car « On ne pense, on ne parle avec force que du fond de son tombeau : c’est là qu’il faut se placer, c’est de là qu’il faut s’adresser aux hommes » (Diderot, Essai SUR LES RÈGNES DE CLAUDE ET DE NÉRON, II, 7).
Je ne sais si le théâtre est un art suffisamment philosophique pour nous « apprendre à mourir », du moins nous permet-il de mettre nos pas dans les traces des morts.
Le site originel du théâtre, ce lieu d’échange entre la vie et la mort, il revient à Strindberg de le rebaptiser à l’aube du XXe siècle. C’est l’«île des morts », la TOTEN-INSEL, cette peinture de Bôcklin qui encadre la scène et sert d’emblème à l’éphémère (1907 – 1910) et décisif Intima Teatern.
Strindberg l’écrivain est un colon. L’ÎLE DES MORTS donne une image du territoire par lui colonisé. Une base, une zone franche de l’autre côté, à partir de laquelle il pourra, dans le fragment dramatique intitulé précisément L’ÎLE DES MORTS, « décrire le réveil après la mort » ou dépêcher les créatures de ses pièces de chambre : revenants pour maisons hantées.
L’écrivain, lui-même en posture testamentaire ; son œuvre toujours déjà posthume. Strindberg, qui multiplie les déclarations comme quoi il est un mort vivant : « En écrivant beaucoup, j’ai fait de ma vie la vie d’une ombre ; j’ai le sentiment de ne plus me déplacer sur terre mais de flotter sans pesanteur dans une atmosphère qui n’est pas faite d’air mais de ténèbres » (lettre de 1887 citée par C.G. Bjurström dans son Introduction à I’ŒUVRE AUTO-BIOGRAPHIQUE). Strindberg qui, au lieu de la vivre, écrit la légende de sa propre vie dans ses textes autobiographiques ou bien qui se projette sur la scène afin de nous donner à entendre et à voir sa parole et son geste testamentaires.
Au commencement de la représentation, le relèvement du personnage.
L’archaïque
Aller au théâtre, c’est prendre le risque, c’est courir la chance de rendre visite aux morts — ou d’être par eux visité. Jeu confondant où les morts se tiennent debout, plus grands que nature, parlent et agissent avec force, tandis que nous, les vivants, ne le sommes plus que par procuration, réduits deux heures durant à une envoûtante passivité, soumis à l’attraction exclusive de ces grands fantômes, de ces magnifiques cadavres ambulants portés par lesacteurs.
Du personnage, nous défalquons la personne. Et ne retenons que le masque. Plus exactement ce masque mortuaire attaché à des rituels qui sont à l’origine du théâtre.
Le personnage dans la grandeur et la splendeur de sa « ressemblance cadavérique » (Blanchot) exhaussé par un vivant, l’acteur. Mû par un vivant qui s’est détaché du groupe humain ici rassemblé afin d’être lui-même un pont entre l’une et l’autre rive.
Récrivant La MUSICA, Duras recompose les personnages à partir de leur propre dépouille : Marie et Michel Nollet (que déjà, dans la première MUSICA, elle n’appelait publiquement qu’Elle et Lui), elle les désigne désormais, dans La MUSICA DEUXIÈME, comme le « mort » et la « morte debout ».
Ce lieu où toujours l’archaïque réémerge dans l’actuel. Archaïque comme déjà, à l’origine du théâtre, la langue du chœur.
Avènement toujours recommencé, au théâtre, de la langue des morts. L’archaïque éclaire d’étrangeté le monde dans lequel nous vivons et, à partir de ce lieu déterritorialisé, de cette enclave symbolique au cœur du réel, le théâtre, propage la bonne inquiétude.
Duras entaillant la pièce de naguère afin de l’ouvrir à ça : l’archaïque, la langue des morts.
Sous l’apparence d’un échange de répliques entre vivants, le dialogue des morts.
Le testament
Théâtre-testament : une dramaturgie qui n’est plus un enchaînement d’actions, une somme d’actes résumant les choix d’une vie et l’exercice responsable d’une liberté (comme a encore pu rêver Sartre au moment même où Beckett s’imposait); une dramaturgie en quelque sorte rétrospective, non plus primaire mais secondaire, qui ramasse d’un seul geste — le geste testamentaire — la totalité d’une existence puis l’égrène, moment après moment, comme un chapelet.