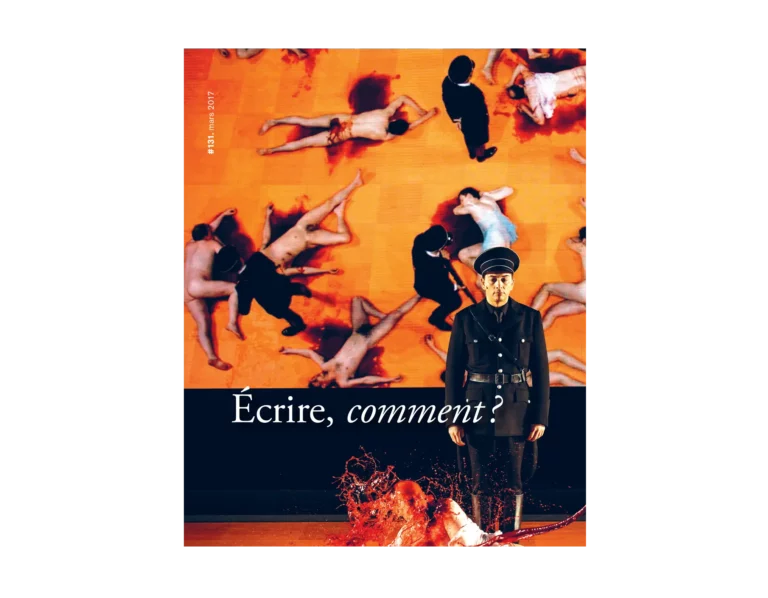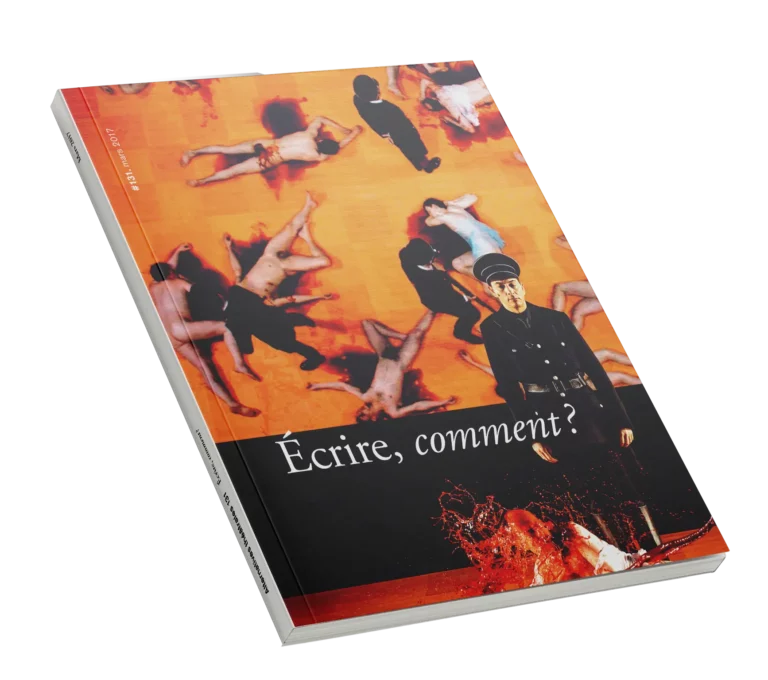Dans l’histoire du théâtre occidental, le rapport entre le texte et la représentation a souvent été problématique et la place des auteurs dans le processus de fabrication du spectacle sans cesse mise en question. Du moins quand ces auteurs n’étaient pas eux-mêmes les « artisans » du spectacle, comédiens ou chefs de troupe. Quels ne furent pas, par exemple, les combats de Beaumarchais ou les déboires de Musset quant à la défense de leurs textes face aux conditions de la représentation ? Cette lutte cependant a maintes fois conduit à des transformations importantes et elle semble bien organiser une dynamique bénéfique à la vie théâtrale. Si l’écriture de Tchekhov interroge la façon de représenter le monde tel qu’il se transforme sous les yeux de l’auteur, Stanislavski ne renouvelle-t-il pas le travail de mise en scène et le jeu de l’acteur notamment à partir des défis lancés par les pièces de Tchekhov ? Plus tard, dans les années 1970, à une tradition théâtrale largement centrée sur le texte et dominée par le modèle français, a répondu la grande remise en question du statut du texte et, par delà, le questionnement de toute parole érigée en discours. La relation entre écriture et plateau, jusque là très hiérarchisée (la mise en scène comme illustration ou comme transposition du texte dans un code différent), fut pensée de façon plus dynamique. Et lorsque la mise en scène s’est imposée comme l’élément majeur de l’élaboration du langage théâtral, la conception de l’autonomie des deux écritures tendit à se diffuser sans toutefois réellement l’emporter sur l’omnipotence du metteur en scène le plus souvent porteur du projet de spectacle sinon directeur de la structure qui allait l’accueillir. Les études de l’écriture dramatique ont alors coexisté avec celles de l’écriture scénique et ont intégré un nouveau champ de recherche lié à une nouvelle fonction : la dramaturgie.
Écriture et institution
L’écriture théâtrale (l’écriture pour le théâtre) se renouvelle considérablement à partir des années 1980, indubitablement sous l’influence des expérimentations de la mise en scène. Mais elle se transforme aussi en lien avec la critique du texte et du discours générée par les sciences sociales dès les années 1950. Cette pensée critique contribua à déconstruire les instances communes de la fable, du personnage, voire même de l’espace et du temps, et mit en avant de façon problématique le schème de la communication faisant ainsi vaciller le dialogue théâtral. De nouveaux auteurs émergent alors (Koltès, Piemme…) mais s’ils se situent souvent dans une grande proximité avec le travail du plateau, ils ont néanmoins à lutter pour se forger une place dans le monde théâtral. On se souvient de la formule de Bernard-Marie Koltès : « Personne et surtout pas les metteurs en scène, n’a le droit de dire qu’il n’y a pas d’auteur. Bien sûr qu’on n’en connaît pas, puisqu’on ne les monte pas…1 ». L’époque bruisse alors des débats autour de la place et du statut de l’auteur dans le théâtre. Or, un cercle vicieux semblait contenir toute la problématique : les responsables des structures hésitaient à programmer des auteurs contemporains sous prétexte qu’inconnus, ceux-ci n’attiraient pas le public. Les auteurs rétorquaient que, si on ne leur donnait pas l’opportunité de rencontrer le public, ils resteraient évidemment méconnus de lui et n’auraient dès lors aucune chance de l’attirer dans les salles. Pendant ce temps, les metteurs en scène trônaient au sommet de la hiérarchie théâtrale et rivalisaient de créativité sur les textes de répertoire.
Largement lié aux contextes français et belge francophone, cet état de choses conduisit, en dépit des remédiations et des actions qui furent tentées, à une situation très aporétique. En effet, on constate alors un nouveau développement de l’écriture théâtrale. L’apparition de nouveaux auteurs ainsi que la multiplicité de leurs textes constituent une pression en faveur d’un changement de la configuration du monde théâtral. Ces écritures devaient circuler, ces auteurs être lus et montés sur les scènes car ils étaient un facteur de renouvellement des contenus et des formes dont une certaine dérive spectaculaire trahissait le besoin urgent. Mais si l’on vit quelques partenariats mémorables se nouer entre un auteur et un metteur en scène (Koltès-Chéreau ; Piemme-Sireuil…), si l’on vit des maisons d’édition se créer (les Éditions Théâtrales en 1981 ; Lansman en 1989 ; Les Solitaires intempestifs en 1992…), la mise en scène de tous ces nouveaux textes fut loin d’aller de soi. S’inventèrent alors des formes d’alternatives : les textes furent « mis en voix », en « lectures-spectacles », ils circulèrent via des « tapuscrits ». L’institution se donna ainsi bonne conscience ne sachant trop comment intégrer des artistes se revendiquant parfois de la littérature (Olivier Py) avec laquelle le théâtre prenait toujours plus de distance.