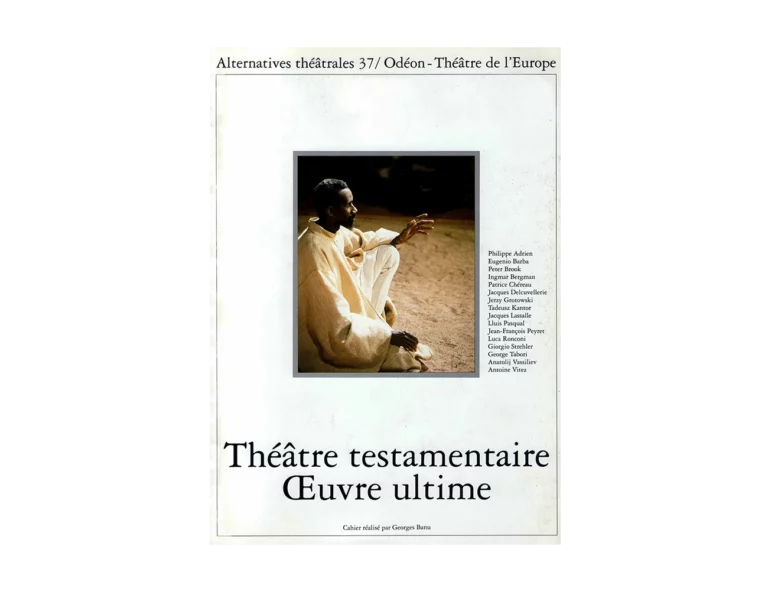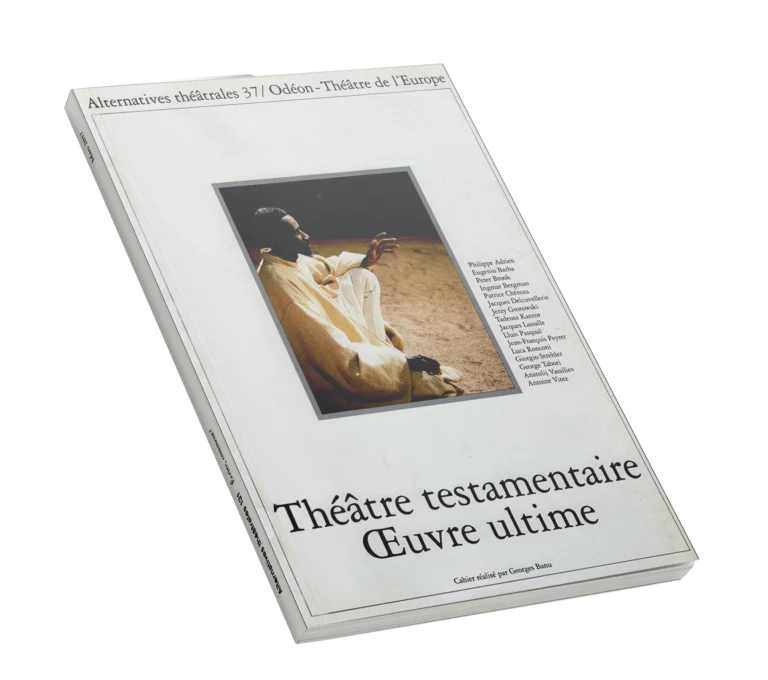STREHLER a souvent dit qu’il mettrait un point final à sa carrière de metteur en scène en montant l’UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL, pièce dans laquelle Carlo Goldoni fait ses adieux à son public avant de quitter Venise pour Paris. Par ce choix, à travers lequel il organise une rêverie autour de son spectacle ultime, Strehler attribue à Goldoni une fonction symbolique de passeur : c’est à Goldoni qu’il revient de guider le metteur en scène vers l’inéluctable passage final, après lui avoir permis de franchir le passage hasardeux du commencement. Il est indéniable que le succès immédiat de la mise en scène du SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES, réalisée en 47 lors de la saison inaugurale du Piccolo Teatro de Milan, fut le vrai départ de la carrière de Strehler. Au fil des ans, il a proposé plusieurs versions différentes de ce spectacle qui témoignent de l’évolution d’une pratique comme si un retour périodique à ce travail était l’étape nécessaire où puiser l’énergie pour affronter de nouvelles créations théâtrales. Ce spectacle, cent fois remis sur le métier, finit d’ailleurs par créer dans l’esprit du public une confusion entre l’auteur de la pièce et son metteur en scène : LE SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES de Goldoni devint l’Arlequin de Strehler. Et puis en 87, arriva l’heure de la séparation et, pour le quarantième anniversaire de la fondation du Piccolo, Strehler proposa une nouvelle mise en scène de son spectacle fétiche qu’il présenta au public comme étant la « Version des adieux ». En guise d’hommage, il fallait rendre Arlequin à Goldoni : aussi l’action se déroulait-elle sur une scène blanche dépouillée de toute surcharge narrative, à l’exception d’une ponctuation rythmique assumée par des paravents qui scandaient l’espace. Sur le fil, traversant de part en part la scène, en lui conférant une dimension épique, un signe ténu, presque imperceptible renvoyait nostalgiquement à un autre spectacle goldonien, LE CAMPIELLO : un serpentin rouge, léger et solitaire, comme une signature discrète du metteur en scène.
Cette signature semblait réitérer, à la fin du périple de ce spectacle, la foi de Strehler dans un théâtre qui fasse advenir la poésie, à travers la beauté et la légèreté : une légèreté aux confins de la profondeur, visant la mobilité de l’intelligence et de la sensibilité afin d’annuler la pesanteur. Cette conception du théâtre n’est pas sans évoquer ce que Calvino écrit dans son texte testamentaire, LEÇONS AMÉRICAINES, à propos du poète Guido Cavalcanti : « Si je voulais choisir un symbole augurai pour le passage au nouveau millénaire, j’opterais pour celui ci : le saut agile et soudain du poète philosophe qui s’élève au-dessus de la pesanteur du monde démontrant que sa gravité contient le secret de la légèreté, tandis que celle qui, bruyante, agressive, vrombissante, est prise par beaucoup pour un signe de la vitalité des temps, appartient au règne de la mort, comme un cimetière de voitures touillées ».

Malgré une interprétation qui traduisait la vitalité intacte de ce spectacle, cette version ultime d’Arlequin portait l’inévitable empreinte d’une nostalgie inhérente à la séparation, au terme de ce qui avait constitué une tranche de l’histoire du théâtre italien d’après-guerre. Car les différentes versions de cette mise en scène ont été aussi, en quelque sorte, des « spectacles-école » pour une bonne partie de ce que le théâtre italien compte de comédiens importants, venus aiguiser leur art dans les rôles de Brighella, de Pantalone, du Docteur, de Béatrice, de Florindo et des Amoureux qui entourent le personnage emblématique d’Arlequin, incarné, lui, pendant quarante ans par deux acteurs seulement. Cette ultime version était ainsi un adieu à l’aventure stimulante du Piccolo Teatro car si les mots de l’institution demeurent, les choses fatalement sont devenues et deviendront différentes.
L’inexorable course du temps a rattrapé un spectacle qui était pourtant un défi à l’éphémère du théâtre, mais si elle en provoqua la mort, elle ne sanctionna pas pour autant la fin d’Arlequin, puisque Strehler a choisi de monter LE SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES avec les élèves du cours Jacques Copeau de l’école du Piccolo fondée en 87, pour couronner leur cycle de fin d’études.
Cet « exercice scénique » public, comme Strehler définit lui-même ce travail avec ses élèves, n’est pas une reprise de la version de 87. Au contraire, Strehler opère un retour en arrière, en proposant, comme base de réflexion pour l’interprétation, le spectacle de 47. En optant pour la première version d’Arlequin, à travers laquelle il retrouva et réinventa, à partir des travaux de Copeau et de Reinhardt, la néanmoins très italienne Commedia dell’Arte, et non la version ultime, point d’aboutissement de sa pratique de metteur en scène, Strehler choisit de transmettre aux nouvelles générations une forme de théâtre basée sur une prodigieuse habileté au niveau du métier et dont l’apprentissage requiert rigueur et discipline pour acquérir rythme et maîtrise de jeu. Cet « exercice scénique » peut alors apparaître comme un testament en acte, de tradition socratique, d’un maître soucieux de léguer une virtuosité susceptible de permettre à cette forme de théâtre de renaître de ses cendres.
D’ailleurs, après la version dite des « Adieux » de 87, celle-ci est baptisée « Bonjour à la vie du théâtre ».