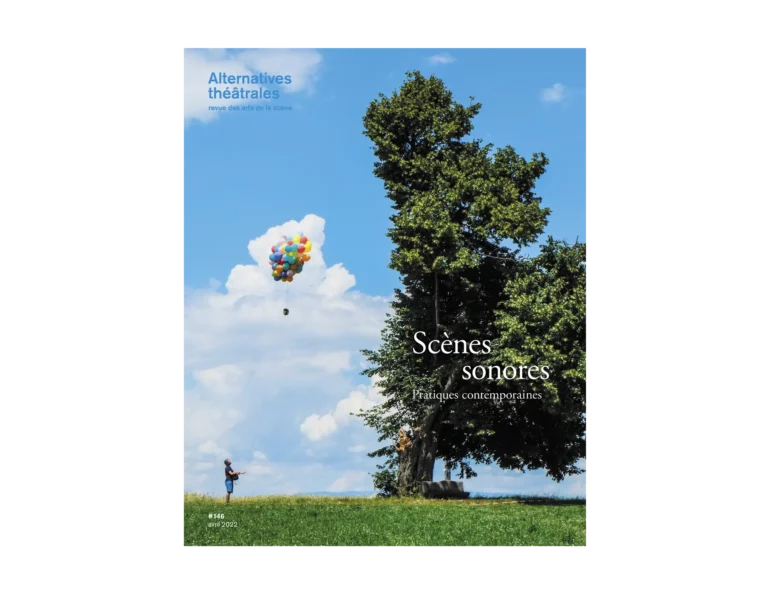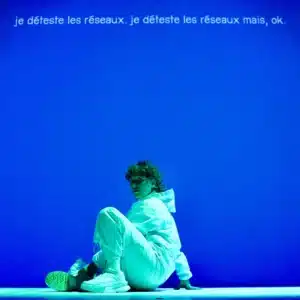Serge de Laubier est le fondateur de PUCE MUSE, une structure sonore pionnière en arts numériques. Depuis 1982, il y imagine avec ses équipes des créations sonores autour de la musique visuelle. Ingénieur du son de formation et pédagogue, il est également concepteur du « Méta-Instrument » et de nombreux logiciels. Ses créations personnelles mêlent musique, images et nouvelles technologies.
Qu’est-ce que PUCE MUSE exactement ?
PUCE MUSE va avoir quarante ans en 2022. Au départ, c’était une petite structure fondée par un groupe de compositeurs qui sortaient du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, tous élèves de Pierre Schaeffer. Dans un premier temps, notre idée, pragmatique et un peu simple, était de faire des concerts de musique électroacoustique à Paris ‒ il n’y en avait pas beaucoup à l’époque ‒ en regroupant le matériel de chacun d’entre nous. Ensuite, des enjeux artistiques sont arrivés ; on s’est demandé pourquoi faire des concerts, quel sens cela avait et on s’est demandé ce que l’on voulait dire. Il y a eu une évolution au fil du temps.
Aujourd’hui on parle de « musique visuelle vivante ». Là où cela frotte un peu selon moi, c’est que les musiques électroacoustiques sont souvent uniquement des musiques de support. L’idée à PUCE MUSE, c’est plutôt d’inventer des manières de jouer et de questionner ces musiques au sein des nouvelles technologies. Même si cela commence à se faire, cela reste encore balbutiant par rapport aux espaces à parcourir. En ce qui concerne le visuel, nous tentons depuis longtemps de réfléchir à ce que l’on voit et à ce que l’on veut montrer quand on joue de la musique. Il y a deux pôles derrière cette idée. Le premier c’est qu’il s’agit d’aider à entendre – voir un musicien jouer en lisant une partition par exemple. Ce sont des situations anciennes dans lesquelles l’image joue et qui aident à entendre la musique. Le numérique élargit encore plus cet espace. D’autre part, il y a un second pôle plus onirique et métaphorique selon lequel, au contraire, on désire ne pas trop en voir en écoutant, pour pouvoir imaginer. Les deux pôles ont du sens et nous essayons d’imaginer des réponses qui conjuguent les deux, en développant, par exemple, des logiciels qui génèrent de l’image à partir du son. Ces programmes qui avaient été imaginés initialement pour les personnes mal entendantes nous ont beaucoup aidé à avancer autour de ce travail.
Combien êtes-vous à travailler dans vos studios ?
Nous sommes une petite équipe de huit personnes. Nous essayons de fluidifier le travail le plus possible, aussi chacun d’entre nous a plusieurs casquettes. Le travail mené à PUCE MUSE est polymorphe, polytechnique et polyart ! Par exemple, notre chargée de com- munication a fait une thèse sur Andreï Tarkovski, le chargé de production est également com- positeur, l’administrateur est aussi metteur en scène, etc. La diversité des compétences est un formidable enrichissement.
Comment travaillez-vous avec les metteurs en scène et les artistes de manière générale pour faire de la scène à partir du son ?
Il y a deux types de projets. Ceux que l’on héberge et pour lesquels on nous passe commande et puis les créations que je pilote. On fabrique des instruments. On a également beaucoup travaillé à PUCE MUSE sur la pulpe des doigts, l’intelligence de la main. Elle est souvent marginalisée par rapport à cette notion « d’intelligence » si souvent prise au sens académique, ce qui je pense est une erreur. L’intelligence du geste est très importante. On fabrique des « méta- instruments », des instruments sur lesquels on peut modéliser des comportements d’instruments. Concrètement on dévalue les variables et l’on observe combien de gestes simultanés on peut faire sur un instrument. Lorsque l’on a commencé, en 1988, nous étions sur seize gestes et les gens nous rétorquaient qu’au-delà de seize gestes simultanés c’était monstrueux. C’est vrai et faux. Aujourd’hui nous sommes sur quatre-vingt-douze gestes exécutables simultanément. Le travail d’un musicien est toujours complexe. Le passage entre le moment où l’on travaille et celui où l’on joue est comme le passage d’un hémisphère à l’autre. En jouant, on passe une étape, la musique entre dans les mains, pénètre dans le corps. Et si à ce moment-là on réintellectualise le processus, on se trompe et on se met à faire des fausses notes. La pensée musicale du corps est donc très forte et cela intéresse grandement.
C’est très présent dans l’une de vos dernières créations, Le doux, le cacher et le ravissement (2019) avec le marionnettiste- manipulateur Jean-Louis Heckel, dans laquelle vous jouez le son et les images du bout des doigts grâce à un instrument numérique constitué de quatre-vingt touches extrêmement sensibles.
Jean-Louis étant marionnettiste, il a questionné la main toute sa vie. Après avoir vu ses spec- tacles vidéo, les séquences très émouvantes dans lesquelles il filmait les mains des gens, je lui ai proposé de faire une séquence de mains musicales. Nous avons également collaboré pendant quinze ans avec Catherine Hospitel, une artiste plasticienne disparue en 2018, qui était aussi dans l’aventure des mains. On a beaucoup travaillé avec elle sur le vertige entre réel et virtuel. C’est une exploration que l’on continue, pour la Nuit Blanche de septembre 2021, avec un orchestre d’organistes manipulateurs virtuels dont les images sont projetées et qui jouent avec un organiste réel, bien présent. Le jeu c’est d’arriver à être sur une ligne, un passage le plus continu possible et de déclencher des vertiges, d’ouvrir de nouveaux espaces sur ce passage que l’on ne connait plus très bien. On forme aussi des gens pour
constituer des orchestres de manipulateurs de sons et d’images.