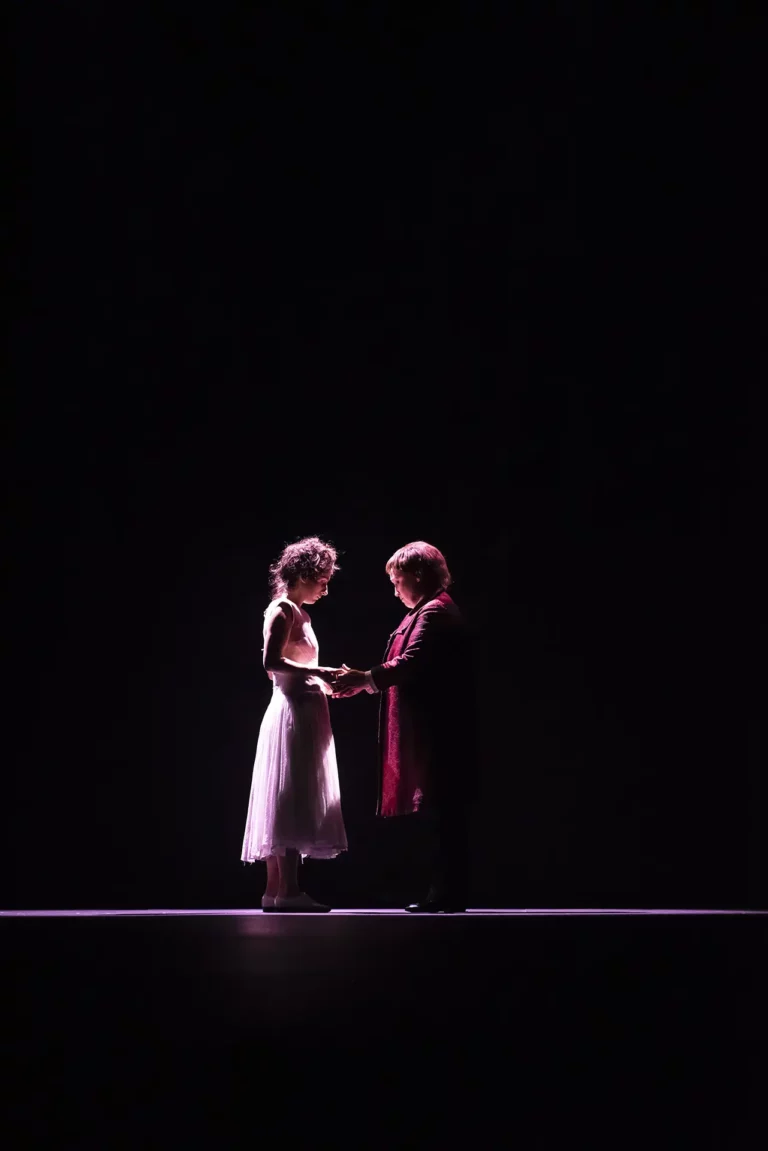La circulation de la phrase dans les nerfs
Le Kung-fu[1], un spectacle écrit et joué par Dieudonné Niangouna nous amène à réfléchir avec humour au phénomène d’identification qui dépasse toutes les frontières physiques et qui participe du plaisir à se raconter des histoires. Niangouna se projette dans Bruce Lee ou Jackie Chan, mais énumère aussi des dizaines de ses héros sans jamais faire référence à la couleur de peau :
« Ne m’appelle plus Dieudonné Niangouna.
Appelle-moi Jack Sparrow.
My name is Ajax.
Jake LaMotta.
[….]
Capitaine Grant.
Ivanhoé.
Costa Pinto.
J.R.Ewing.
Sabata.
Jim le Gaucher.
Blekle Roc.
Fantômas
[…]
Guimba.
Lancelot.
Calibos.
Edmond Dantès.
Dragon.
Kramer.
Django
[…]
Simon Templar
Freddy.
John Rambo.
Sarah Connor.
Indiana Jones.
[…]
Je suis Li Mu Bai.
C’est moi Hamlet le Danois !
Je suis Jean Valjean !
Je suis Spartacus !
Appelez-moi Puck.
Alceste !»[2]
Niangouna invite la puissance du théâtre à nous libérer des apparences. Cette liste de personnages hétéroclites, qui convoque sa culture télévisuelle et cinématographique, dit la vibration au monde qui est la sienne et les histoires qui le nourrissent. Ce que dit Niangouna, c’est qu’au théâtre, l’acteur congolais, tel l’enfant qui racontait les films karaté ou les western peut être tour à tour tous les personnages. L’acteur est un caractère, une énergie, un flux et c’est « la circulation de la phrase dans les nerfs » qui crée le personnage[3]. Le jeu d’identification pour Niangouna est son kung-fu :
« J’ai grandi à l’ombre des acteurs qui défilaient comme des images sur des écrans, mais ce n’étaient pas des images c’étaient des fables.
Puis plus tard des expressions.
Alors je me suis aperçu qu’elles étaient là avant,
ces expressions,
Et qu’elles se montraient en fables à mes yeux,
Et qu’elles finissaient par devenir le champ de ma tension interne. »[4]
S’identifier à un personnage pour un acteur ou un spectateur, ne passe pas par l’épiderme, mais par ce que l’on devrait bien plutôt appeler le tempérament ou « l’expression » pour reprendre le terme de Niangouna, c’est pourquoi Steve, le comédien du film d’Alice Diop, se projette dans Danton et a Lino Ventura, Gérard Depardieu ou Jean Gabin pour modèles. Les professeurs du Cours Simon dissuadaient Steve de jouer Danton… Pourtant « la circulation de la phrase de Buchner dans les nerfs » de Steve fait bel et bien entendre magistralement Danton à la fin du film.
Diversité et pensée coloniale
Cette question de la carnation au théâtre est d’autant plus névralgique, que la scène est un espace d’exposition de soi pour l’acteur, mais ce ne doit pas être un espace d’exhibition des corps et des cultures. S’arrêter à la couleur de peau de l’acteur, ethniciser son apparence et ne voir de lui qu’une origine bien souvent fantasmée, c’est le mettre en situation d’exhibition au sens colonial du terme.
C’est ainsi que les acteurs enfermés dans une identité décidée pour eux, se retrouvent à devoir jouer des clichés et à se faire les ambassadeurs d’Afrique ou des Caraïbes. Dans Quel dommage que tu ne sois pas plus noire Yasmine Modestine témoigne de cette aberration. « Tu représentes l’Afrique » lui disait au Conservatoire le metteur en scène qui lui avait confié le rôle de Marwood dans Ainsi va le Monde de William Congreve. « Il ne s’agit même plus de jouer, explique-t-elle. Je n’avais jamais été en Afrique, personne n’est africain dans ma famille. Et me voilà projetée hors de moi, hors de mon pays, hors de ma naissance ».[5]
Christine Farenc, elle aussi comédienne métisse antillaise, qui a analysé comment l’argument de la couleur de peau de discriminant devient discriminatoire, explique qu’« être Noir lorsqu’on est acteur en France, c’est porter plus que soi, plus que son talent et sa vocation, ce serait endosser le rôle de l’Autre, ce serait incarner visiblement le rapport inconscient et inconfortable d’un pays à son passé colonial et esclavagiste ».[6]
Aborder la question des acteurs ethnicisés sur les scènes contemporaines en réduisant l’enjeu à la représentation de la diversité est une impasse. C’est le regard que l’on porte sur la différence et ce qu’il recèle qu’il faut interroger comme le rappelle Valérie Goma : « Assez vite en France, la tache sombre fait tabou : elle convoque chez le spectateur un inconscient lourd de culpabilité, où le poids d’un passé colonisateur s’ajoute à la condescendance du riche envers le pauvre, avec le complexe d’une supériorité plus ou moins lointaine. Le Noir, dirait-on, surgit sur nos scènes non comme un être à part entière, indifférencié, mais comme représentant d’une communauté fantomatique. »[7] L’enjeu véritable est éducatif. Apprendre à ne pas regarder la peau comme un signe ethnique d’altérité exogène est le défi à relever, car la Francité n’a pas de couleur, elle a une langue, des accents et une culture en partage.
Il est urgent que la scène contemporaine se pense avant tout comme un espace de représentation du vivre ensemble, une dimension que déploient depuis longtemps les dramaturges afro-descendants de France : ils mettent en scène des personnages qui ne se définissent pas par leur peau, mais sont avant tout des rôles pour des acteurs. Le travail dramatique de Koffi Kwahulé des pièces comme Misterioso-119, Big Shoot, ou encore Blue-S-Cat, répond à ces enjeux. Pas de nom de personnages, juste des voix pour forcer le lecteur à aller à la rencontre du rôle sans éléments préétablis, sans a priori. Le théâtre de Kwahulé ne met pas en scène des Noirs ou des Blancs. Son théâtre convoque l’humanité d’aujourd’hui et les vibrations du monde contemporain. Il construit ses personnages en imposant d’abord une voix qui ne sera pas surdéterminée par un nom, un sexe, une race. C’est la voix qui se dégage de l’ensemble vibratoire de la pièce qui dessine le personnage et cette voix est un corps musical, une vibration mais pas une carnation.
La question de la diversité sur les scènes contemporaines ne relève pas de la seule présence d’acteurs non-blancs sur les plateaux, mais bien plutôt d’une capacité à être à l’écoute de l’imaginaire de celui que l’on assigne à l’enclos de l’altérité au lieu de voir en lui son semblable. La diversité dans le paysage théâtral ne doit pas se jouer que du côté des acteurs, c’est l’ensemble des secteurs d’activité du spectacle vivant qui est concerné : écriture, dramaturgie, mise en scène, scénographie… et pas seulement le champ artistique : n’oublions pas la programmation, la production, la diffusion, la formation… Voilà tout le sens de l’action menée par l’association « Décoloniser les arts » qui 15 ans après le Collectif Egalité reprend le flambeau et s’adresse à l’ensemble des responsables de la culture en France en interpellant les institutions et les élu-e‑s. Au lendemain des attentats de 2015 à Paris, l’exclusion et la discrimination qui se lovent au creux de la culture soulèvent plus que jamais une question politique que pointe la lettre ouverte aux directeurs et directrices de théâtre publiée par l’association.[8]
Penser la peau sur les scènes contemporaines, c’est accepter l’altérité comme une valeur intrinsèque au théâtre et dépasser les apparences épithéliales pour être à l’écoute de celui que l’on croit Autre, pour partager son imaginaire, sa vibration au monde… mais entendre aussi son point de vue sur l’histoire qu’on partage, entendre cette histoire depuis une autre rive. Prendre conscience que nous devons sortir de la postcolonie, c’est ne plus enfermer les imaginaires de l’altérité dans les marges exotiques de la création contemporaine, afin que leur inventivité soit partie prenante de la culture nationale et stimule au contraire sa vitalité de l’intérieur.
Consulter le sommaire du N° 133 d’Alternatives théâtrales : en complément de la version papier, de nombreux textes et entretiens sont consultables en version numérique : Dans le cadre de nos recherches, nous avons recueilli des propos d’artistes, de directeurs de structures et de représentants d’institutions, en France et en Belgique. Ces paroles sont passionnantes, polémiques, souvent émouvantes et très stimulantes. Nous publions en accès libre de nombreux témoignages. Plusieurs personnes ont participé activement à la récolte de ces témoignages : Christian Jade, Laurence Van Goethem, Antoine Laubin, Nancy Delhalle (Alternatives théâtrales), Lisa Guez (doctorante Paris 8) et bien sûr Martial Poirson (professeur Paris 8) et Sylvie Martin-Lahmani (codirectrice éditoriale d’Alternatives théâtrales), qui ont coordonné le numéro et l’enquête. http://www.alternativestheatrales.be/catalogue/revue/133
[1] Dieudonné Niangouna, Le Kung-Fu, Les Solitaires intempestifs, 2014
[2] Ibid., p. 51 – 57
[3] Dieudonné Niangouna, Le Kung-Fu, Les Solitaires intempestifs, 2014, p.19.
[4] Ibid., p. 21.
[5] Yasmine Modestine, Quel dommage que tu ne sois pas plus noire, Max Milo, 2015, p.49.
[6] Christine Farenc, « L’acteur français noir ou le syndrome de Phèdre », in Cultures noires en France : la scène et les images, sous la direction de Sylvie Chalaye, Africultures, n°92 – 93, 2013, p.129
[7] Valérie Goma, « Le noir à la lumière : points de vue de metteurs en scène », in Ombres de la rampe…, sous la direction de Sylvie Chalaye, Théâtre/ Public, n°172, p.67.[8] Décoloniser les arts, extrait de la Lettre ouverte aux directeurs et directrices de théâtre et de festival et aux responsables culturels, 1er février 2016. https://www.facebook.com/decoloniserlesarts/ consulté le16 mars 2016