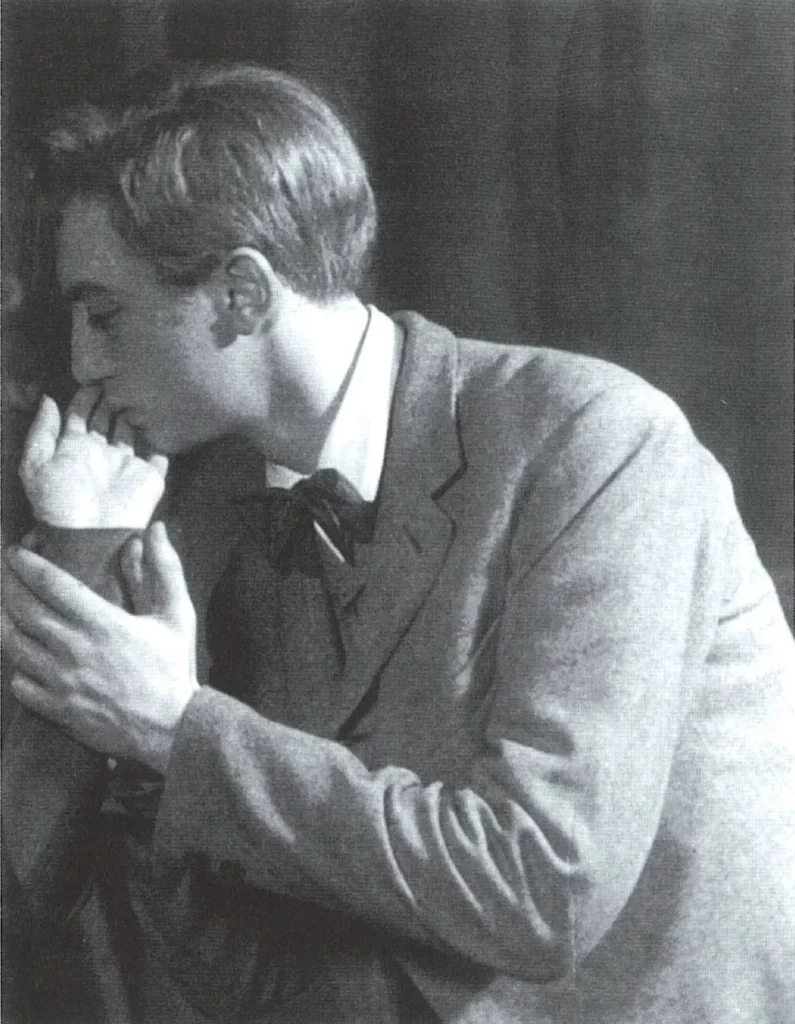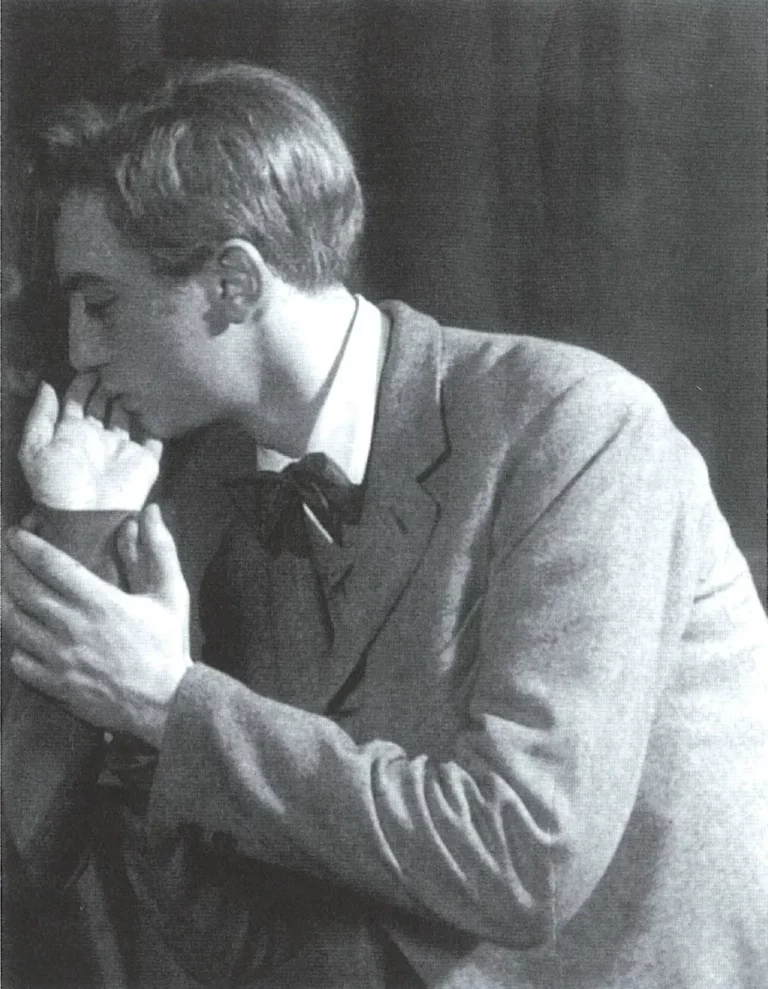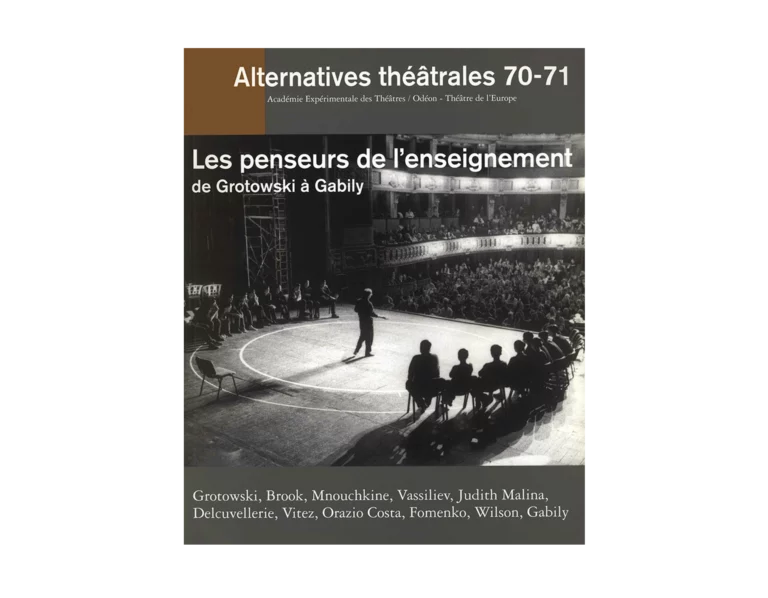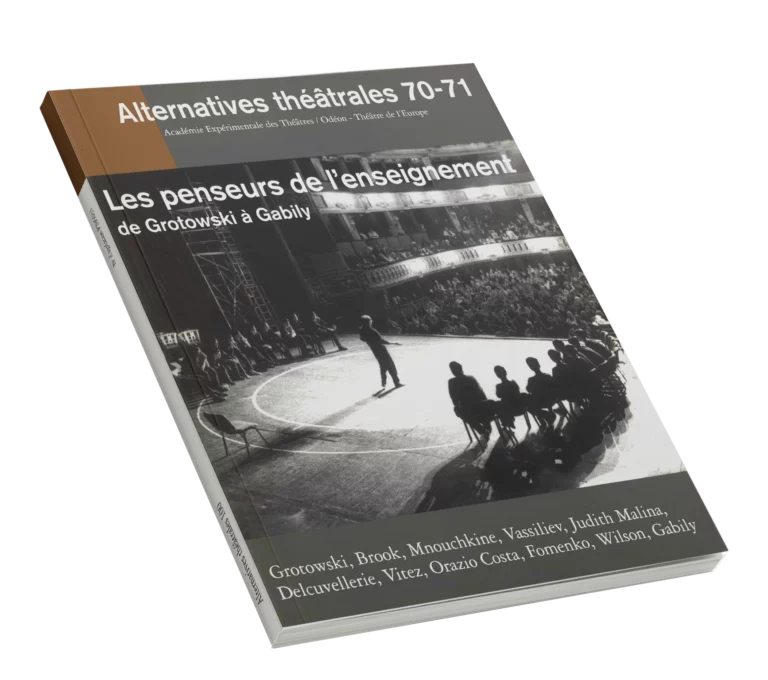PAR MANQUE DE TEMPS, par habitude, ou surtout par une certaine défiance envers mes qualités d’écrivain, j’ai depuis toujours du mal à coucher mes pensées sur le papier. Si ma vie avait été différente je ne serais peut-être pas devenu metteur en scène, mais en attendant je préfère recourir au théâtre pour exprimer l’identité et l’intensité de ce qui me tient à coeur. Pourtant lorsque la Société Théâtrale Italienne m’a invité à rédiger une brève contribution à la mémoire d’Orazio Costa, peu de semaines après sa mort, j’ai brisé d’emblée les freins qui entravaient au fond de moi l’exercice direct de l’écriture et j’ai accepté immédiatement la proposition, en dépit du « risque » accru que cela représente.
Il arrive souvent à un « auteur » de peu d’expérience, comme moi, en dépit de toutes les bonnes intentions et de la volonté sincère d’exprimer la douleur due à la disparition d’une personne avec laquelle nous avions des liens d’affection, pour maintenir vivante sa mémoire, de s’embourber dans la sécheresse des phrases toutes faites. Ce n’est pas pour rien que l’on dit, avec hélas une expression si souvent usée, que la seule réaction possible devant un événement aussi énorme et exceptionnel que la mort est le silence. Pourquoi alors n’ai-je pas hésité un seul instant à répondre à la sollicitation du professeur Tian ?
La première réponse, évidente, est que pour tous ceux qui en Italie aiment le théâtre, comme « spectateur » ou « producteur », rendre hommage à Orazio Costa au lendemain de sa disparition s’imposait comme un acte nécessaire. Je ne suis pas un historien de la scène et, de ce fait, il ne m’incombe pas de rendre compte en détail de ce qu’une bonne partie des protagonistes du théâtre italien de l’après guerre devait à Costa.
Je crois pourtant que l’importance de l’apport de Costa au développement de la culture théâtrale en Italie pendant la seconde moitié du siècle qui vient de s’achever est visible pour tout le monde. Compagnon de route de Silvio d’Amico et élève assistant de Jacques Copeau, Costa est le promoteur et le protagoniste de la « révolution » théâtrale, qui marque à partir de la fin des années trente l’avènement sur les scènes du pays de l’image du « metteur en scène ».
Ce fut un pédagogue, exceptionnellement charismatique, engagé avec une abnégation rare dans les aventures didactiques les plus diverses : de l’enseignement dispensé pendant plusieurs décennies à l’Académie à celui prodigué auprès du Centre Expérimental de Cinématographie, de la création du Centre d’initiation à l’Expression de Florence à l’ouverture de l’École de Théâtre de Bari.
Il fut à plus d’un titre le maître de pratiquement tous les interprètes acclamés sur notre scène (et même au-delà): de Tino Buazzelli à Nino Manfredi, de Paolo Panelli à Glauco Mauri, de Monica Vitti à Rossella Falk, d’Umberto Orsini à Gianmaria Volonté, de Gianrico Tedeschi à Giancarlo Sbragia ou à Gabriele Lavia, pour ne citer que quelques noms tirés du catalogue sans fin de ses élèves. Costa a laissé une trace indélébile dans le panorama du théâtre italien des dernières décennies. Il est probable que des considérations de ce genre seraient déjà suffisantes pour expliquer dans l’absolu le désir, ou, mieux encore, la nécessité de se souvenir du long voyage à travers la scène de Costa. Néanmoins, ceci ne suffira pas à expliquer les vrais motifs qui m’ont poussé à écrire ces lignes.
Quittant le point de vue général pour une perspective plus personnelle, je dois reconnaître que j’appartiens à la grande masse des hommes de théâtre italiens ne pouvant pas nier leur propre obligation de reconnaissance envers ce grand maître. Pendant les deux années scolaires 1951 – 52 et 1952 – 53 j’ai eu Costa comme professeur de récitation à l’Académie et au cours de la même période j’ai suivi aussi ses cours de mise en scène. Très tôt après mon début comme acteur en 195 3 sous la direction de Sguarzina dans TRE QUARTI DI LUNA (Trois quarts de lune) — la mise en scène étant en fait d’Orazio Costa‑, je me suis trouvé confronté en 1954 à une nouvelle épreuve comme acteur, dans une mise en scène de CANDIDA de G. B. Shaw, produite par le Teatro Stabile de Rome.
La rencontre professionnelle suivante inversa les rôles avec mon ancien professeur ; elle remonte à une vingtaine d’années après la mise en scène de Shaw que je viens de mentionner : j’ai demandé à Orazio d’être acteur dans la version TV de ORLANDO FURIOSO. Au-delà des profondes différences de goût et d’orientation culturelle qui nous ont séparés, je ne peux, ni ne veux cacher que Costa a joué un rôle déterminant dans ma formation théâtrale.
Bien que je ne me sois jamais reconnu dans la méthode de Costa, j’ai appris de lui la nécessité de fonder le rapport avec la scène sur des bases éthiques (bien plus que mystiques) et le plaisir d’analyser les questions d’interprétation en les résolvant de temps à autre selon leur spécificité irréductible dans le contexte d’une robuste « quadrature » intellectuelle. Enfin, même si nos esthétiques étaient différentes, j’ai partagé avec Costa la passion de la parole-en-scène.
À l’origine de ma vision du théâtre comme moment de conscience on retrouve également l’idée de Costa d’un théâtre comme « mesure de l’esprit » ; à la base de mon approche empirique de l’expérience de metteur en scène se trouvent les souvenirs de certaines leçons de Costa et de ses suggestions de “décortiquer” logiquement les problèmes du sens. Si mon respect presque maniaque du texte ne s’appuie pas sur le logos, les soins attentifs que je prends pour restituer dans le théâtre la parole ne sont sans doute pas éloignés de la rigueur avec laquelle Costa « lisait en scène » Ibsen ou Molière, Goldoni ou Alfieri ou encore les classiques du théâtre religieux médiéval. C’est par cette même voie ou plutôt à travers la reconnaissance ouverte de tout ce que j’ai appris d’Orazio Costa, que je peux arriver à parler du sens authentique des notes fragmentaires que voici.
En comparaison avec l’aveu sincère de l’influence que Costa a eu sur mon parcours théâtral, une influence que, pour tout dire, je n’ai jamais essayé de contester ou de cacher, il y a de mon côté une perception aiguë de l’ingratitude que j’ai eue vis-à-vis de ce grand homme de théâtre, et malheureusement je n’ai peut-être pas été le seul dans ce cas. Dans ma mise en cause de la société théâtrale italienne, ou au moins d’une de ses parties, je n’entends pas me soustraire à mes responsabilités. Mais en m’efforçant de montrer la plus grande lucidité, je voudrais essayer de rendre un juste hommage à Costa et, dans la mesure du possible, essayer de tirer même de cet événement douloureux qu’est sa disparition un enseignement ou, au moins, un motif de réflexion.
Je crois, à quelques exceptions près, que le théâtre italien, dont je rappelle que je fais partie en premier lieu, s’est montré dans les faits, sans intention malicieuse délibérée, très peu reconnaissant envers Orazio Costa, qui lui a pourtant consacré toute son existence. L’isolement, que nul ne contestera, dans lequel a vécu Costa pendant les dernières années de sa vie, est là pour le démontrer, en nous forçant à prendre position sur ce que sont les moeurs dans notre théâtre. Ce fut sûrement Costa, avec son détachement si particulier et un peu aristocratique, qui a contribué en premier à créer la situation que je viens de dénoncer, mais on est loin d’une justification des agissements de ceux, qui comme moi-même, n’ont pas su ou pas voulu montrer pleinement leur gratitude à un tel maître. Cette dernière observation nous fournit de nouveaux sujets de méditation.
Dans une société théâtrale dominée par une certaine cordialité affectée, les manières sévères et austères de Costa, pouvaient aller parfois jusqu’à la pédanterie, mais elles restaient toujours respectueuses et dictées par un très solide code moral et n’ont jamais été vraiment ni acceptées, ni comprises. Une société théâtrale de ce type peut-elle se donner une « tradition » ? Ou mieux, peut-il exister une vraie culture théâtrale dépourvue de tradition ? Et enfin, Costa n’a-t-il pas peut-être essayé pendant toute sa vie de fonder à sa façon une « tradition » ? Dans ce cas, quels sont les résultats de ses efforts ?
Ces interrogations laissent sans doute celui qui les pose dans une amertume profonde, mais c’est dans cette inquiétude sourde, cette insatisfaction qu’elles provoquent, que résident leur nécessité et leur urgence. C’est également parce qu’il nous a aidés à nous poser de telles questions que nous devons remercier Orazio Costa, ce maître quelque peu distant, mais toujours généreux. Avec une élégance de seigneur et la discrétion qui a caractérisé toute sa vie, il nous a depuis peu abandonnés à jamais, en nous transmettant comme son héritage précieux, bien plus qu’un modèle de théâtre, un exemple de vie.
Texte repris avec l’aimable autorisation de l’ETI, extrait de Etinforma, année V, 11° 1, 2000.