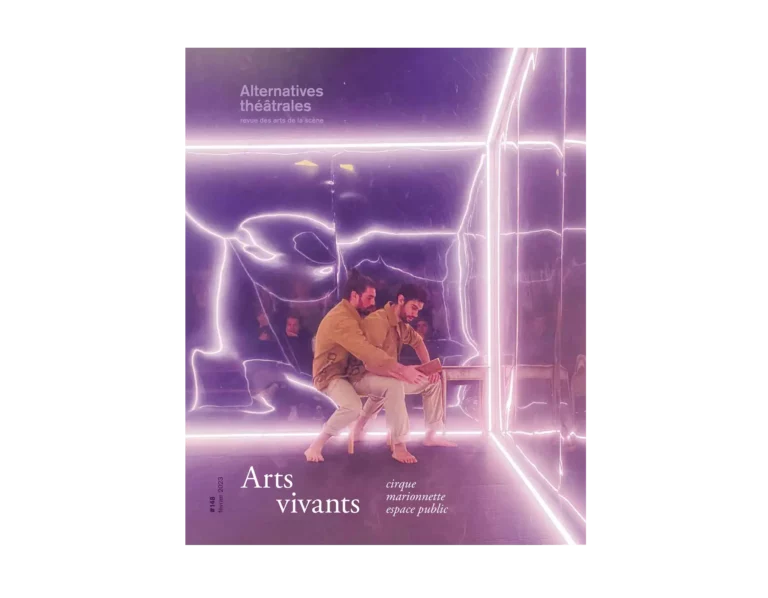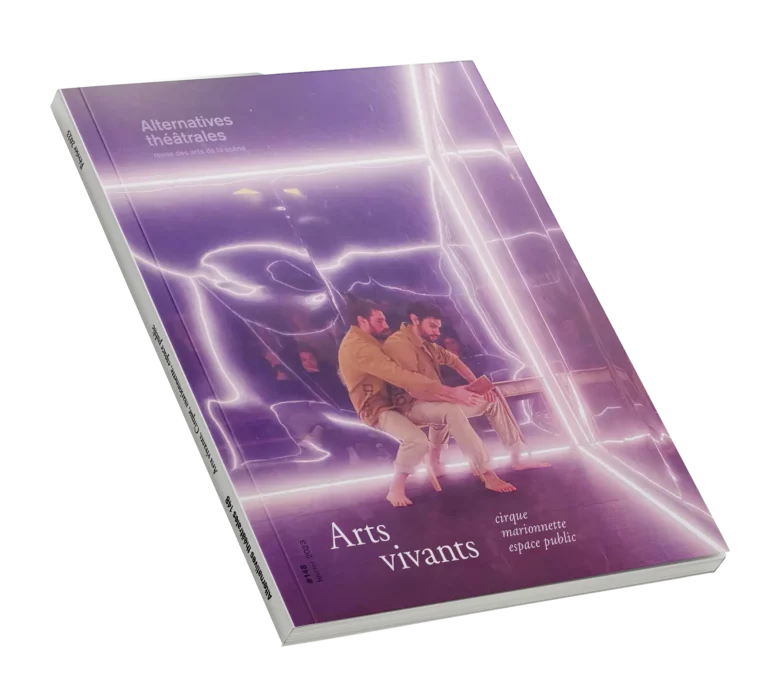En Europe, on relie souvent la genèse des arts de la marionnette à la rue. D’abord art forain, la marionnette a connu de profondes mutations, comme toutes les autres disciplines artistiques du reste, dans le courant du xxe siècle. Mutations esthétiques et techniques, mutations dans la monstration, mutations enfin dans le rapport à l’institution théâtrale s’incarnant dans la conquête d’une légitimité qui a mené la marionnette jusque dans les salles les plus prestigieuses, tel Alain Recoing accueilli à Chaillot par Antoine Vitez.
Cette histoire qui s’est écrite non sans efforts ni déconvenues a provoqué une forme de cassure. D’une part, certains marionnettistes ont souhaité ne pas s’inscrire dans le mouvement vers la salle et vers l’institution, et continuent de pratiquer exclusivement dans la rue. D’autre part, chez les marionnettistes qui ont fait le choix de revendiquer les mêmes conditions pour leur art que celles accordées au théâtre d’acteurs, on sent parfois une réticence à envisager la rue comme un espace de représentation possible. On a le sentiment qu’existe un refus du retour à l’espace public qui relèverait d’un enjeu symbolique, qu’un tel mouvement serait vécu comme une régression, quand bien même des artistes de talent créent pour la rue qui n’est aucunement un espace artistiquement pauvre.
En parallèle, les arts de la rue en tant que secteur artistique se sont développés fortement – depuis les années 1980 pour ce qui est de la France, mais depuis 2021 seulement en Suisse – en affinant des savoir-faire particuliers, des dramaturgies singulières, en revendiquant leur inscription dans l’espace public. Ce qui les caractérise est donc un rapport aux spectateurs, direct, gratuit, libre, et une manière de faire qui s’accompagne de compétences spécifiques. Il n’y a pas d’exclusive esthétique : ils incluent potentiellement toutes les disciplines. Marionnette, mais aussi musique, cirque, théâtre, performance, danse, il n’est aucun art qui ne puisse être englobé.
Pourtant, à l’heure actuelle dans les pays francophones, les « réseaux » de la marionnette et ceux de l’espace public ont perdu l’habitude du dialogue et de la coopération. C’est peut-être un effet de la cassure symbolique mentionnée précédemment. C’est peut-être aussi à relier à des politiques publiques segmentantes, qui fabriquent justement des « secteurs » auxquels les créateurs sont renvoyés.