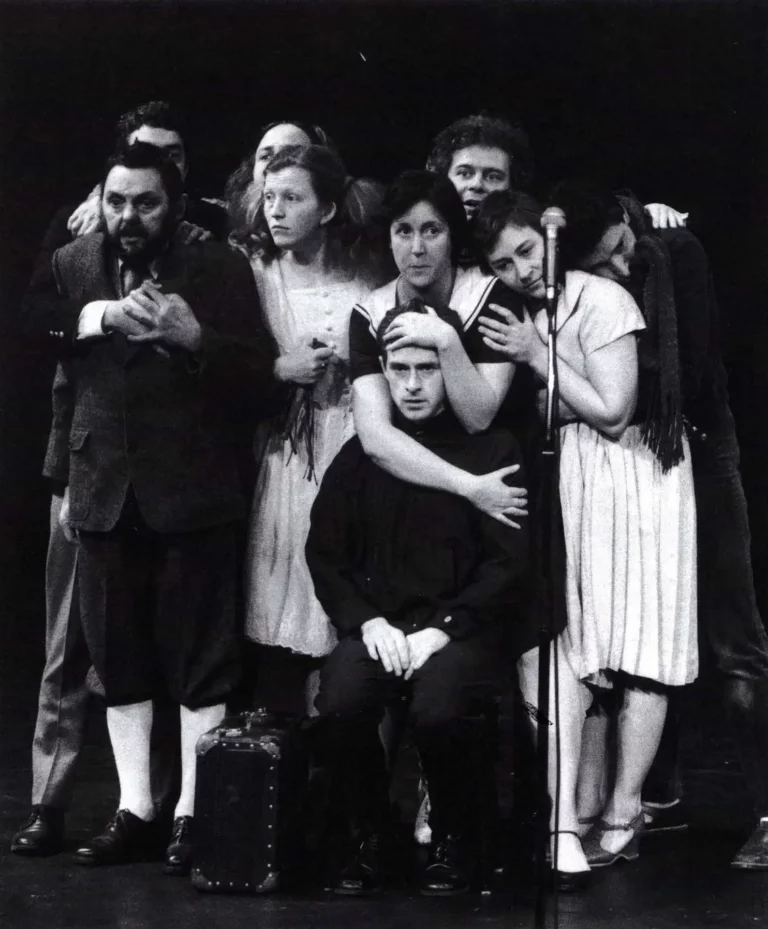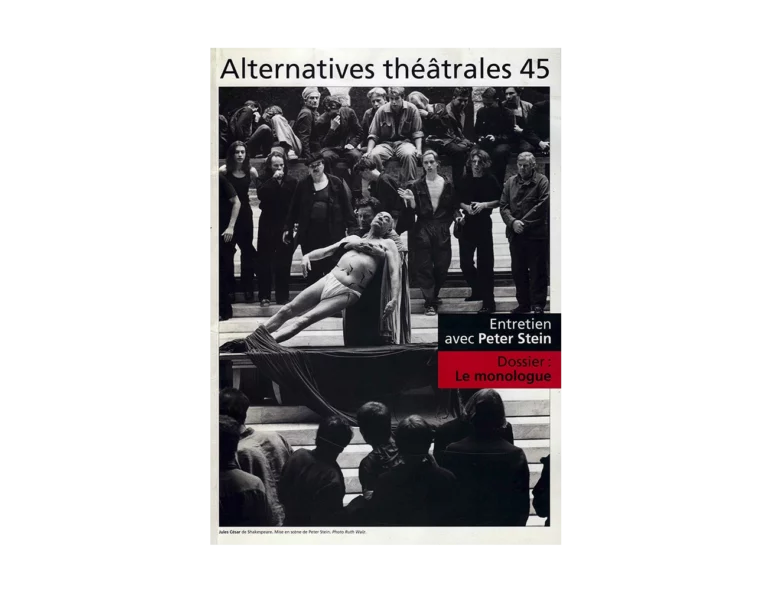J’AI EU la chance de voir L’homme qui de Peter Brook aux Bouffes du Nord l’année dernière. Le point de départ de ce spectacle est, comme on sait, un livre écrit par un médecin s’occupant de maladies mentales. On peut se demander dans quelle mesure le récit d’une expérience aussi intime dans un domaine aussi spécifique peut intéresser un aussi vaste public. C’est qu’il n’y s’agit pas de faire de l’information médicale sur les questions neurologiques, même si celles-ci sont abordées dans le spectacle. À travers le récit de l’expérience intime de ces malades, c’est d’incommunicabilité et d’isolement qu’il y est question. Le vecteur qui relie ici les deux mondes — celui des malades et celui des personnes « saines » — c’est, me semble-t-il, le théâtre lui-même, ou, plus précisément, l’acteur. C’est lui, en tant que représentant du personnage, compatissant dans sa propre chair, qui permet au spectateur de « sentir avec », et, ensuite, de rencontrer l’«autre ». J’ai été frappé, d’autre part, par le déroulement inhabituel de la représentation. Une assemblée de plus ou moins quatre cents personnes bavarde, remue librement, échange toute une série de considérations sans aucun rapport apparent avec le spectacle auquel elle vient assister. Soudain, sans que rien ou presque ne l’annonce, l’acteur entre. Pas de changement brutal d’éclairage, pas de plongée de la salle dans le noir. Il prononce, sur le ton de la confidence, les premiers mots, et le silence se fait. Instantanément. Tout le monde l’attendait, tout était préparé pour son intervention. Il n’est pas nécessaire qu’il élève la voix, la salle est un cercle ; le cercle intime du conteur.
Quelle est l’alternative que le spectacle vivant propose par rapport au support mécanique — cinéma, vidéo — si ce n’est, justement la présence vivante de l’acteur dans le temps et l’espace de la représentation, que jamais une image ne parviendra seule à remplacer ? Le théâtre n’est-il pas le lieu privilégié, dans nos sociétés, où le discours sur l’humain peut se faire intime, sensuel ? Le trouble, l’émotion, qui mobilisent les zones les plus profondes de la sensibilité — l’imaginaire, la mémoire — et peuvent devenir le point de départ d’une interrogation sur le monde, sont étroitement liés à la sensation physique. Il faut retrouver des espaces dont la convivialité permette l’intimité des rapports entre l’acteur, le partenaire et le spectateur. Quand il y a déséquilibre, quelque chose d’essentiel est perdu. La structure élisabéthaine de l’espace des Bouffes du Nord permet ce type de rapport scène-salle.
À y regarder de plus près, il me semble qu’un certain nombre d’entreprises théâtrales, en Communauté Française ces derniers mois, ont cherché quelque chose de comparable. Je pense, entre autres, par exemple à Une chose intime de Philippe Blasband au Grand Parquet, ou à Rien de Lorent Wanson à l’Atelier Sainte Anne. Dans ces deux cas il est beaucoup question de trouble. D’une certaine forme de dévoilement, aussi. De nudité. Le théâtre y est affaire de regard, d’écoute, mais aussi de sensation. L’un et l’autre de ces deux spectacles tentent, chacun à sa manière, un discours théâtral qui part du particulier et ne touche à l’universel qu’à travers la communication de l’expérience individuelle, par le biais d’une émotion directement liée à la proximité des acteurs et des spectateurs. Le travail sur l’intime s’assortit évidemment, dans les deux cas, comme dans les spectacles de Brook, d’une réflexion sur le rapport scène-salle et d’une modification structurelle de l’espace de la représentation. Les solutions proposées tendent à rapprocher l’acteur du spectateur et à briser la frontalité. Il y a bien d’autres exemples de cette gêne que les metteurs en scène éprouvent à nouveau aujourd’hui face aux outils scénographiques avec lesquels ils sont contraints de travailler. On pourrait citer, entre autres, le travail de la Mezza Luna (Eppur Si Muove, …), de Barbara Bua (La force de l’habitude, …), de Marc Liebens (Amphitryon, Oui, …) ou encore, certains travaux du Groupov, ou de Thierry Salmon. La grande majorité des salles auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, sont issues de la vision wagnérienne : frontalité, séparation scène-salle, priorité à l’image, fosse d’orchestre. Elles répondent aussi à des impératifs économiques en termes de jauges. Les solutions proposées pour y échapper vont du refus pur et simple d’utiliser ces structures aux mille et une façons d’en pervertir l’usage. Ce type de choix scénographique représente un véritable risque. La tournée d’un spectacle, est souvent le seul moyen de le rentabiliser. On est à chaque fois contraint, lorsqu’on a fait un autre choix que celui du dispositif frontal, de négocier avec l’organisateur, de convaincre. La question de la jauge est souvent déterminante dans la négociation du prix de vente d’un spectacle. La presse ne réagit pas toujours en profondeur ; le pouvoir subsidiant ne comprend pas toujours ce qu’on lui veut. Il ne s’agit pas de nier la nécessité pour les créateur de prendre en charge la question du public, brûlante aujourd’hui dans nos théâtres, mais plutôt de la poser en termes qualitatifs. Il ne s’agit pas non plus de mettre en question l’efficacité ou la pertinence dans certains cas de la salle dite « à l’italienne », mais bien de prendre acte du fait que les spectacles que j’ai cités, à l’instar de beaucoup d’autres, ne pourraient être représentés sur ce type de plateaux sans être amputés de ce qui fait leur substance.
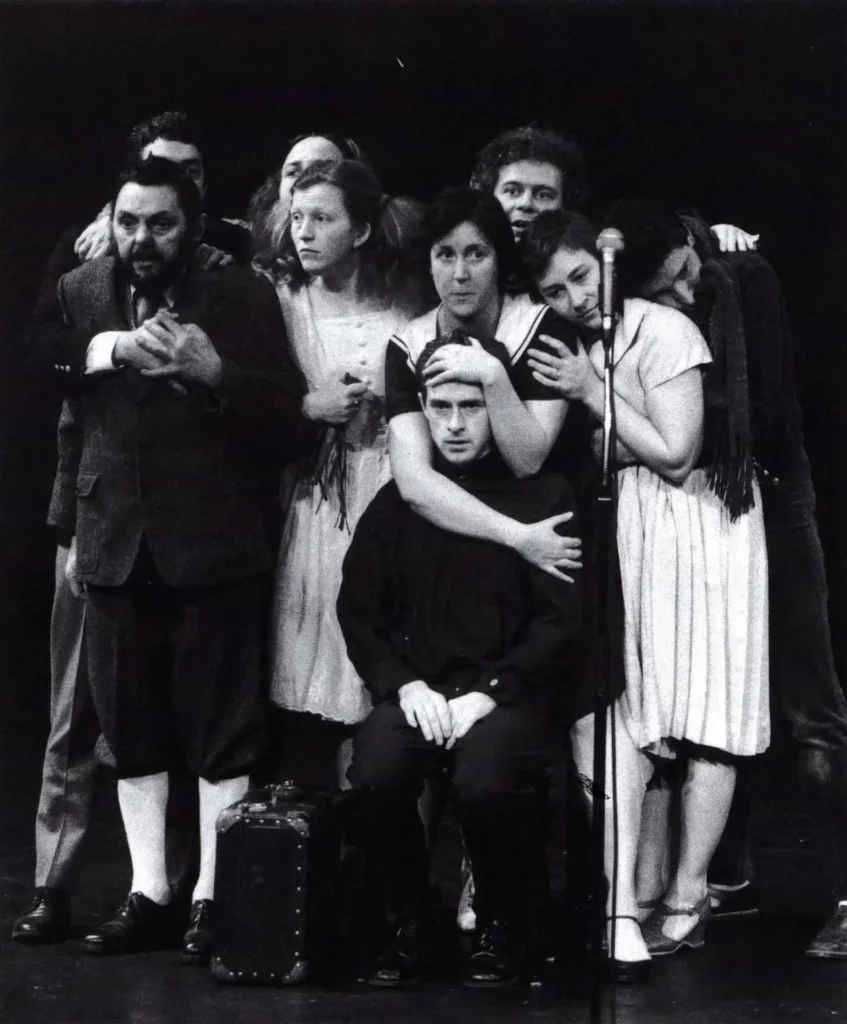
Les spectacles théâtraux ne sont pas seulement des images. Ce qui se passe dans la salle compte autant que ce qu’il y a sur la scène. Il faut rester attentif à ne pas tuer le rapport scène-salle dans la représentation et à ne pas contraindre l’acteur à des performances athlétiques qui empêchent toute forme d’authenticité et forcent la caricature. Il faut tenir compte des exigences du théâtre dans le domaine de l’intime. L’émotion, ça n’est pas très spectaculaire. En fait, ça ne se voit pas. C’est la part invisible, informulable, de l’être. C’est pourtant la matière même de la représentation théâtrale. Question de vibration… Le public contemporain est saturé d’images. Il a besoin de sentir l’acteur ; son double, son représentant. De le sentir charnellement présent au centre d’un cercle où tout communique, de percevoir son mystère. L’exemple de la démarche de Brook est un encouragement pour tous ceux qui croient aux pouvoirs de l’invisible au théâtre et à la convivialité de la représentation.