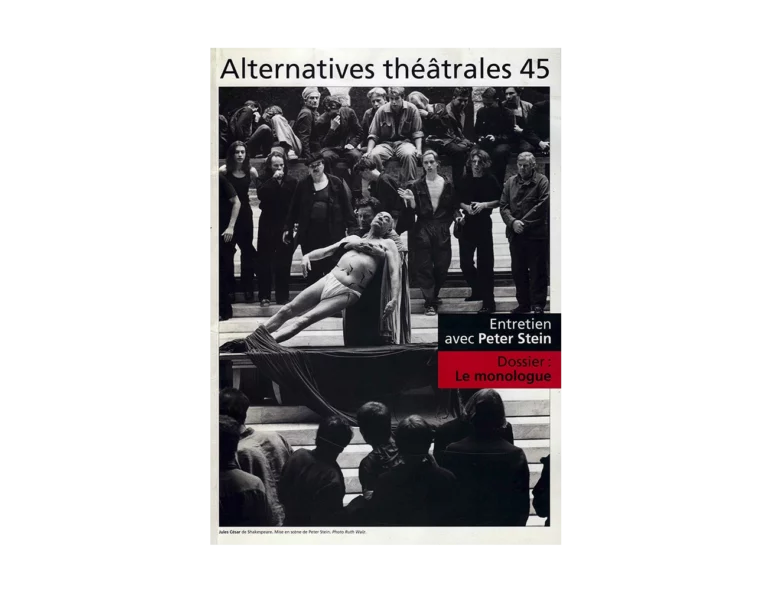Que la masse énorme et infiniment mobile des livres consacrés au spectacle ne fasse jamais oublier la jouissance dont ils scellent la mort ; que nous lisions dans la résurrection provoquée par le savoir, ce jamais plus qui fait de tout spectacle(contrairement au livre) la plus déchirante des fêtes.
Roland Barthes
Il est des artistes dont il convient de parler avec une extrême discrétion, comme si toute parole, tel un corps étranger sous la peau, déclenchait irrémédiablement une irritation, un échauffement et finalement un gonflement du sens loin de la retenue recherchée. Klaus Michaël Grüber est de ceux-là. Son théâtre appelle le silence plutôt que la glose, la suspension du sens plutôt que son approfondissement. Il tétanise, c’est-à-dire séduit et terrorise, nous fige dans la stupeur de l’émotion brute. Parler des spectacles de Grüber, c’est entrer dans l’indicible, dans cette torsion du corps et de l’esprit qu’est la langue quand les mots viennent à manquer. Écrire sur Grüber, ses spectacles et sa pratique, c’est s’attaquer au dévoilement d’un secret, c’est tenter de s’avancer dans l’improbable d’un monde de magie.
Le livre que publient conjointement aujourd’hui les Éditions du Regard, l’Académie expérimentale des Théâtres et le Festival d’Automne fait le pari de cette effraction discrète.
Le titre, référence aux propos de Grüber lui-même : « Il faut que le théâtre passe à travers les larmes », prépare à cette approche, lente et nécessaire, de la révélation d’un au-delà du théâtre, le ravissement d’une intimité.
Six chapitres charpentent cet ouvrage qui s’ouvre comme un album de famille, se lit par bribes, avec le sentiment dès les premières pages qu’il ne nous abandonnera plus, que dans les moments de doute ou de nostalgie nous pourrons le feuilleter pour y retrouver, intacte, la mémoire d’instants fugitifs où le théâtre est une fête silencieuse et intérieure.
« La poétique grübérienne »
Tous les grands thèmes de la poétique grübérienne se retrouvent dès les premières pages du livre. On y parle de fatigue éclairée, du luxe du murmure, d’écho à peine audible, de corps engourdis, de droit à la solitude, d’un théâtre à chaque instant menacé d’oubli ou d’épuisement. Et là « où l’essoufflement guette », analyse Georges Banu, « chaque parole compte ». Car c’est bien la parole que Grüber révèle par le travail qu’il accomplit avec les acteurs, l’espace et la lumière. Et cette parole marque souvent la présence de l’ombre à l’ouvrage dans l’oeuvre, l’ombre comme « une pause de la lumière, un halètement de fatigue », l’ombre aussi comme la part de légende car, poursuit Banu, « seule la légende lui permet d’injecter de la subjectivité et du biographique ».
Et pourtant, impossible de parler d’un « style Grüber » comme le fait remarquer Bernard Dort. Grüber, sculpteur du silence selon la belle formule de Jean-Pierre Léonardini, celui qui ralentit les acteurs, qui invite au voyage immobile est aussicelui qui réconcilie par son trajet L’affaire de la rue de Lourcine et La Walkyrie, Arrabal et Pirandello, Sur la grand’route, un Tchekhov peu connu joué dans une salle de répétition, et le fameux Winterreise d’aprés Hëlderlin dans le stade olympique berlinois de construction nazie. C’est que la démarche de Grüber n’est « ni celle d’un auteur, ni même à proprement parler celle d’un réalisateur [mais] s’apparente ainsi à celle d’un voyageur parti, à travers les mots et les gestes, à la recherche du théâtre » (Dort).
« Jouer avec Grüber »
« Jouer avec Grüber » regroupe des interventions de quelquei-uns des acteurs qui ont croisé un temps le chemin de Grüber : Minetti, bien sûr, mais également Anna Nogara, André Wilms, Udo Samel, André Marcon, Marcel Bozonnet, Jutta Lampe, Ludmila Mikaël, Angela Winkler, Peter Simonischek, Bruno Ganz. À l’ombre dévoilée comme poétique dans le premier chapitre répond ici, curieusement, une parole sur la lumière. Mais il s’agit alors d’une lumière intérieure, celle qui s’apparente à la quête et à la connaissance, comme cette confession qui clôt l’article de Minetti : « Autre chose : Grüber me connaît probablement mieux que je ne me connais moi-même ».
Cette proposition déjoue à elle seule toute possibilité de comprendre le mystère Grüber. La relation qu’il instaure avec les acteurs apparaît ici comme relevant de cette zone où une globalité de l’acteur, inconnue à lui-même, est mise en jeu. André Wilms prolonge ce pari en présentant l’exigence de Grüber comme : « Être autre chose qu’un acteur », sous entendant par là la recherche d’un ailleurs, dans la lumière et dans les mots. Ce qui fait également dire à André Marcon que Grüber n’éclaire pas la matière, ni même l’acteur, mais bien la parole. C’est ce qu’il y a de plus profond, enfoui au fond de l’être qui doit rayonner. Et pour faire advenir cette lueur intime, Grüber cherche avec l’acteur à se débarrasser de toutes les scories qui mutilent un texte ou un acteur, de toute cette peur qui habite et déforme les corps et les voix. Travail de dépeuple ment proche d’un certain idéal poétique oriental qui raréfie le mot et le geste afin d’atteindre non l’essence mais le silence. Un petit dessin de Gilles Aillaud, représentant Angela Winkler dans Antigone, dira comme les mots des interprètes cette recherche du haïku : trois traits et une tragédie muette s’invente sous nos yeux.