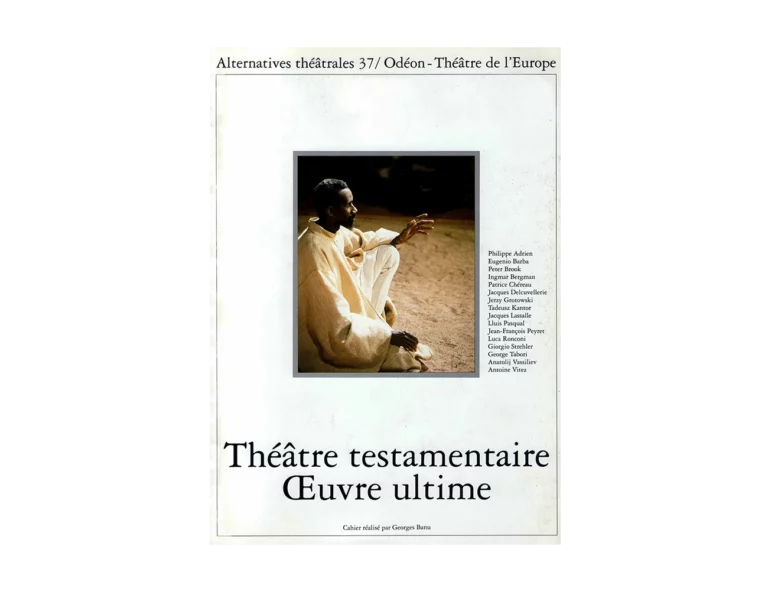LE design et le kitsch sont incontestablement les styles de l’époque, son « aveuglante » esthétique. Lorsque je dis « aveuglante », je veux seulement indiquer que la domination du design et du kitsch est tellement massive et évidente qu’ils ne font tout simplement plus question. Autrement dit l’art semble être définitivement débarrassé de son frayage avec la vérité pour n’être plus qu’ornemental. Mais ce « n’être plus » restrictif est au fond déplacé. Après tout, l’aventure de l’art comme « mise en œuvre de la vérité », son histoire comme processus d’autonomisation qui débute avec le XIXe siècle, est trop courte et pourrait bien aujourd’hui être définitivement arrivée à sa fin. Une fin sans achèvement et sans destination toutefois. Une parenthèse qui se ferme en ayant peut-être laissé échapper l’essentiel. Au demeurant il faudrait remonter un peu plus avant encore et faire commencer ce qu’il est convenu d’appeler le tournant esthétique de l’art avec la naissance de l’esthétique comme discipline de la philosophie vers le milieu du XVIIIe siècle lorsque se posa la question de mettre à l’abri, sinon de sauver, le sensible de ce que O. Marquard a appelé la surtribunalisation du monde par suite de la sécularisation de la culpabilité. C’est sous l’effet de l’historicisme naissant, autre conséquence majeure de la surtribunalisation, et de la révolution de 1789, qu’eut lieu la révolution esthétique du Romantisme et du Classicisme allemand. Schiller, dans la suite de Kant, se donnait alors pour tâche de surmonter les contradictions inhérentes à la vie en société et au progrès « qui a toujours développé le potentiel de liberté en même temps que la réalité de l’oppression » (Rousseau) par l’éducation esthétique de l’homme. Vers 1850, Baudelaire, sous l’effet du chemin de fer et de l’exposition universelle des marchandises, pensa l’esthétique en tant qu’expérience « d’une modernité qui, dans l’expérience-choc du Nouveau ne prend plus ses distances que vis-à-vis d’elle-même, engendrant de la sorte sa propre antiquité et laissant l’historicisme se muer en un esthétisme qui dans l’espace du « musée imaginaire » dispose librement de tout ce qui appartient au passé » (H.R. Jauss). Le troisième tournant étant celui de l’avant-garde ou le modernisme reprenant à son compte les mots d’ordre des avant-gardes politiques appelle à la réalisation immédiate de l’art par le biais de sa révolutionnarisation et donc de sa dissolution dans la vie. Ce mot d’ordre là encore est d’abord celui de l’art comme expérience et il suppose de toute façon de prendre au sérieux le motif de l’art comme chose dupassé tel Hegel, principalement, l’avait pensé. Au reste, il s’agissait chaque fois de sauver l’art de « la belle apparence » et d’en faire un « organon de la philosophie ». En tous les cas, que ce soit comme « mise en œuvre de la vérité » chez Heidegger ou comme énigme de la vérité en tant qu’instance négative permettant de dénoncer la contre-vérité idéologique chez Benjamin ou chez Adorno, l’art a été chargé de suppléer aux « impossibilités spécifiques d’une réflexion consciente (celle de la philosophie) pour rendre présente une vérité qui conduit l’effort de pensée à ses limites » (R. Buhner).
En résumant ainsi, très sommairement, le procès de l’autonomisation de l’art, qui est aussi celui de sa détermination par l’esthétique, je ne fais que souligner mélancoliquement, c’est-à-dire à la manière de Baudelaire ou de Benjamin, les grandes lignes d’une clôture. Clôture de la tradition philosophique, donc des convictions, des assertions, des métaphores de cette tradition. D’autres, peut-être avec raison, tentent le coup de force d’ignorer cette clôture pour relancer la philosophie du côté de Platon, de redéfinir la philosophie comme théorie de la connaissance en la « dé-poétisant » du moins en s’attachant à contrer sa dérive esthétique. Mais « dé-esthétiser » l’art, hormis le fait qu’il faudrait tout de suite alors parler d’autre chose, revient en réalité à défaire sinon à détruire ce qui lie l’art à la vérité, à déprendre par conséquent l’art de la pensée — même si, comme chez Nietzsche, il se donne comme affirmation de l’illusion et du mensonge. Cet art « naïf » qui n’est plus requis de se substituer à la dépense ou au sacré comme chez Bataille, d’ouvrir la langue au suspense du passé et du sentiment comme chez Tchékhov ou Proust, de donner à entendre dans la langue la distance et l’attente de l’hôte ainsi que Kafka le fit avec l’allemand .… cet art donc, qui sans être innocent n’a pourtant pas besoin de se justifier, a déjà triomphé sous l’espèce ornementale et décorative. D’où logiquement aussi le retrait de la sphère du « visible » de ceux qui tentent de maintenir ouverte la question de l’art — geste qui serait, comme par surprise, commandé une ultime fois par la proposition « sentimentale ». Mais, tout au fond, la contradiction à l’œuvre dans la problématique même de l’art avait déjà été éprouvée par Richard Wagner. Son idée tragique du Gesamtkunstwerk incluait à la fois, en effet, le bruit et le spectacle, mais aussi l’invisible et le silence retirés dans le secret de la mélodie infinie. L’intériorité, la subjectivité étant, depuis Beethoven, un lieu littéralement hors de portée. Un espace à l’abri du jugement, du regard et de l’entendement — hors de portée de l’accusation, donc invisible, introuvable, conscient-inconscient en même temps. (Inconscient n’est, bien entendu, pas du tout à entendre ici au sens de Freud, qui précisément construit son concept sur le refoulement de l’accusation …).