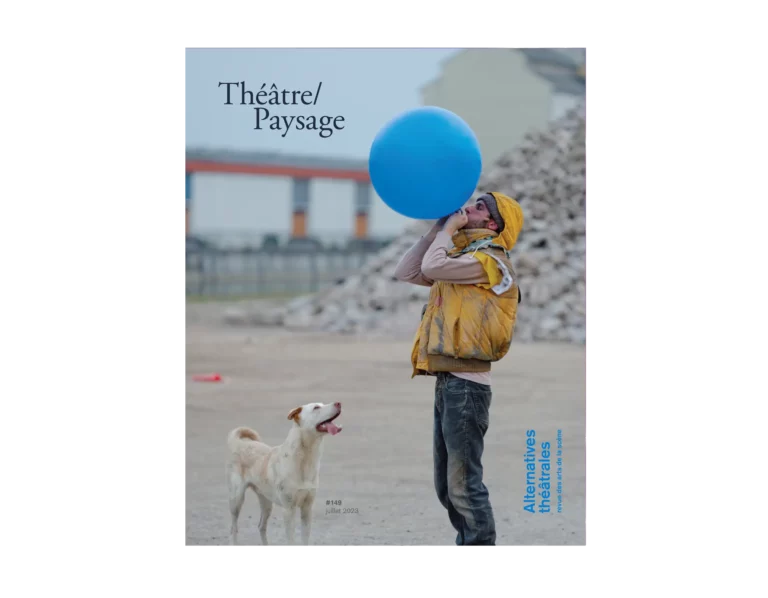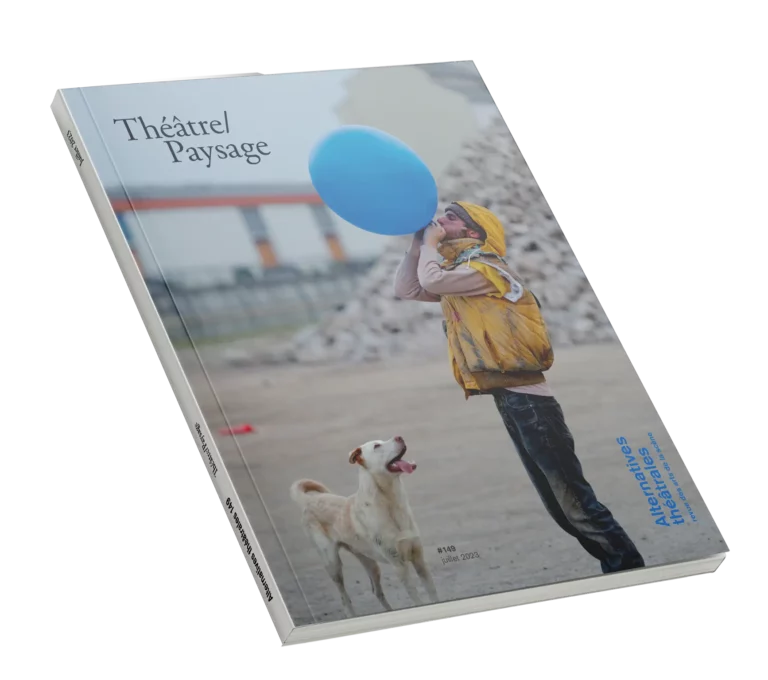Table ronde réalisée le 27 mars à Rennes, avec Mathilde Delahaye, Simon Gauchet et Alexandre Koutchevsky
Vous revendiquez tous les trois, de manière à chaque fois différente, le terme de « théâtre-paysage ». Avant même la question de sa définition, à quelle pratique cela correspond-il pour vous, et comment est venue une telle envie ?
Alexandre Koutchevsky Pour moi, c’est faire avec ce qui existe, prendre les choses telles qu’elles sont et, depuis l’endroit où on va les regarder, essayer de fabriquer du théâtre. J’identifie plusieurs sources à cette envie. D’abord, je me souviens des parents qui disaient « les enfants, allez jouer dehors ! » ; les enfants ont une manière d’utiliser l’espace en lien avec le théâtre. Ensuite, à la fin des années 1990 à Saint-Brieuc, les premiers spectacles sur lesquels je travaille ont lieu partout dans le théâtre (les « Naissances », projet mené par Roland Fichet et le Théâtre de Folle Pensée). Immédiatement, les formes que je vois en dehors de la salle me touchent particulièrement. Et lorsque avec mes ami·e·s auteur·e·s, on fonde Lumière d’août à Rennes en 2004, on se fixe comme objectif de faire entendre ce qu’on écrit, que ce soit dans des théâtres ou ailleurs. On lit en forêt, sur une barque, dans une boucherie, un lavoir, etc. Tout ce qu’on fait dehors me touche si fort que je sens que je ne rentrerai plus dans les boîtes noires. En 2006, j’ai l’occasion de créer une forme courte au théâtre de l’Aire libre qui jouxte l’aéroport de Rennes. Le co-directeur Dominique Chrétien me montre un bunker, que je n’avais jamais vu, sur le parking derrière le théâtre, collé à la piste principale. Ce bunker, insolite morceau de guerre, posé entre une école, un théâtre et un aéroport, devient le site matriciel de mon premier spectacle de théâtre-paysage. J’ai obtenu mon brevet de pilote d’avion deux ans plus tôt, au moment où nous fondons Lumière d’août, et je sais aujourd’hui que la concomitance de ces deux événements est signifiante : la création et le vol sont pour moi l’avènement d’une double autonomie. Si j’ai décidé d’apprendre à piloter, c’est essentiellement pour établir un nouveau rapport au paysage, éprouver un autre regard sur la planète et ses habitants. Le point de vue aérien mobile permet de réinterpréter le monde. La vue de haut, en mettant à jour les voisinages au sol, en révélant les juxtapositions terrestres, excite la curiosité, alerte, interroge. Ainsi, à la suite de cette « révélation » du bunker, je découvre à côté de l’aéroport un centre de rétention administrative en construction, entouré de barbelés, pour étrangers sans-papiers qui jouxte un golf cossu entouré de verdure. Ces deux mondes, invisibles l’un à l’autre, sont séparés par une rangée d’arbres. Ce genre de coalescence va devenir le cœur du théâtre-paysage.
Mathilde Delahaye Moi c’est le contraire ! J’aborde les paysages horizontalement et sensiblement, pour ce qu’ils me font autant que pour ce qu’ils sont géographiquement. Par la perception empirique. Leurs histoires et leurs sens sur un territoire m’intéressent, j’enquête toujours sur les paysages où je joue, mais d’abord c’est l’esprit du lieu qui m’appelle, et leur composition disons terrestre. Toi c’est la carte, moi le territoire ! Pour moi le théâtre-paysage est arrivé un peu par hasard. C’était en 2012, sur une île des Cyclades dans le cadre d’un projet européen autour de la crise grecque. Il faisait chaud, la salle de répétition prêtée par la municipalité était trop petite, alors je suis montée en haut du village ; il y avait un terrain abandonné encerclé par un muret de pierres, deux moulins bleu et blanc, la mer Égée à l’horizon, et au sol, mêlés aux herbes folles, des déchets ménagers : relique de table à repasser, vieux transistor, souvenir d’écran de télévision… J’y ai trouvé la grammaire élémentaire de mon théâtre-paysage : ligne de fuite, du champ, du hors-jeu, de la face et du lointain, ligne courbe, diagonale, traverses, géométrie des volumes, découpe du relief dans le ciel, structure d’horizon, plans, échelle, points de vue, cadre, rythme de l’espace. Les actrices disaient des textes de Raoul Vaneigem contre le vent. Le texte est devenu, à égalité avec les autres phénomènes, une matière organique. Après cette expérience, c’est devenu une obsession – dès que j’ai pu, je suis allée dehors.

Simon Gauchet La question du théâtre-paysage est pour moi moins réflexive que pour vous, parce qu’elle est une pratique parmi d’autres. Lorsque j’étais au lycée, chaque été avec une troupe d’amis on trouvait un lieu et on écrivait la pièce à partir de celui-ci. Cela a fait naître en moi quelque chose d’un processus inversé : ne pas partir d’une pièce pour fabriquer des spectacles mais d’une chose existante, du réel. Plus tard, à l’école du TNB, Nordey a organisé une rencontre avec Alexandre dont j’ai trouvé la démarche très singulière et cela m’a beaucoup marqué. Ensuite il y a eu la première expérience du Radeau utopique : un projet conçu pour un territoire entre Rennes et Saint Malo, sur le canal d’Ille-et-Rance, comme une errance vers l’île d’Utopie. Ce fut une expérience fondatrice : comment créer non seulement avec un paysage mais aussi avec un contexte, avec des habitants – parce que le paysage n’est pas seulement géographique, il est humain, c’est tout ce qui constitue un étant-donné, quelque chose qu’on traverse. Le Radeau utopique consistait en un aller et un retour ; durant l’aller on s’arrêtait dans différentes communes qui nous accueillaient, on avait inventé plusieurs dispositifs pour y recueillir ce que serait une société idéale, l’utopie des territoires qu’on traversait. Comment fabriquer une utopie ? Je me souviens que s’était imposée l’idée de l’échelle communale : une étendue intéressante parce qu’on voit les conséquences de nos actes immédiatement. S’est ainsi dessiné le projet de réinvestir un petit théâtre de patronage abandonné à Bécherel (en Bretagne) et à partir duquel partaient plusieurs sentiers. On s’est demandé comment un lieu pouvait être un « théâtre-paysage ». Avec l’architecte Guénolé Jézequel, nous avons travaillé en compagnie d’une trentaine d’habitants sur la façon dont un théâtre s’invente par et pour un paysage qui soit à la fois humain et géographique. J’ai beaucoup lu à ce moment-là John Brinckerhoff Jackson, auteur notamment de À la découverte du paysage vernaculaire, pour qui tout paysage est la partie visible d’une communauté qui habite à un endroit, soit l’idée selon laquelle tout paysage est complètement fabriqué par ceux qui y habitent, humains ou non humains, et est composé de toutes ces strates. Le Pays, le projet qui a suivi, prolongeait en partie ces réflexions. Il a pris la forme d’une randonnée spectacle de deux jours et une nuit où on mettait en fiction toutes les strates du paysage de massif granitique qui entoure Bécherel. Depuis, avec la paysagiste Léa Müller, chaque projet que l’on mène sur un territoire commence par une exploration géologique des lieux, une exploration de toutes les strates successives qui constituent ces territoires dans lesquels on travaille et qui amènent in fine la question des récits, des histoires manquantes dont ils ont besoin.
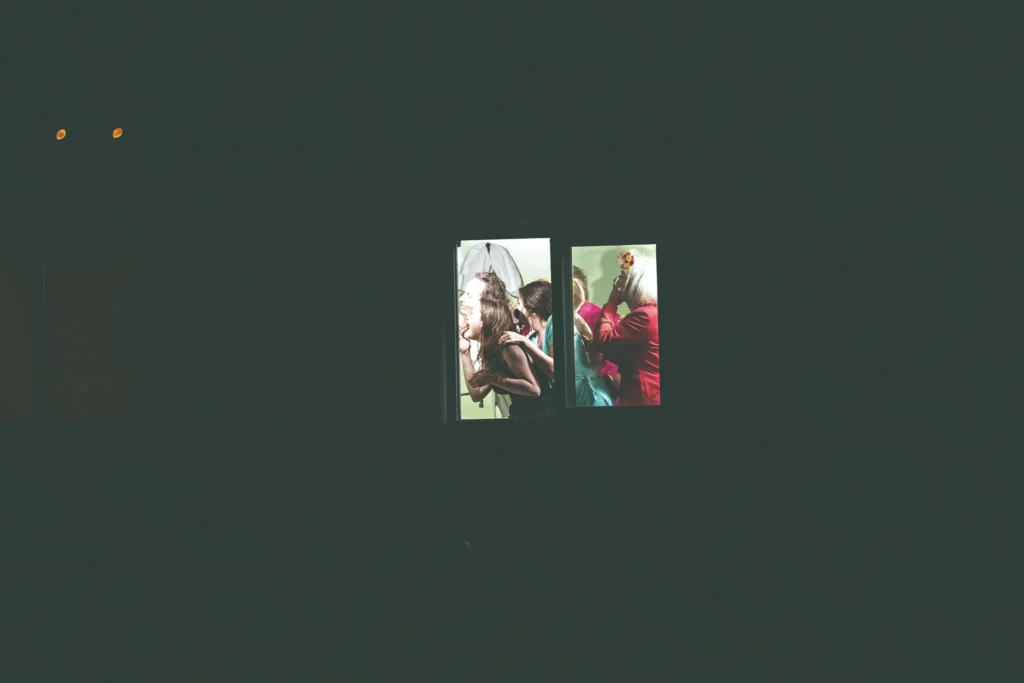
MD Je n’aime pas le mot de paysage, à cause de ce qu’il évoque spontanément, mais c’est un carrefour disciplinaire qui est un formi-dable outil pour penser le théâtre. Il questionne le statut de l’espace de représentation, la com-position picturale, la place de l’humain dans le tableau, le rôle de l’imaginaire du public, en tant que fragment du monde il interroge le lien entre théâtre et réel, etc. Le paysage est une façon subjective d’apprécier l’espace, toujours instruite par une culture visuelle. On reconnaît un paysage, à partir des critères plus ou moins conscients qu’on en a. C’est une image, une représentation qui appelle l’interprétation. C’est déjà une sorte de scène. Les arcanes des enjeux picturaux sont riches pour penser l’art théâtral. Par exemple il n’y a pas de paysage sans cadre. Le cadrage, le hors-champ, le mineur, comment l’infini du hors-cadre active le fini de l’image, etc. Pour moi il y a 1/le lieu comme partenaire sensible et territoire signifiant et 2/ le paysage comme représentation picturale. C’est passionnant de comprendre l’histoire de cette construction dans la peinture, ou mieux encore dans l’art des jardins, ces premières scénographies de l’hétérogène. La scénographie en paysage est une composition picturale qui s’inspire d’une réalité qui est en fait elle-même une représentation. C’est une sorte de boucle. Et toutes les autres questions que pose le paysage font aussi travailler l’objet : on pense évidemment à la question écologique, ou encore à l’enjeu territorial et à celui de la réception, surtout pour nous qui évoluons dans le théâtre public. Au début de mes expériences dehors, j’étais persuadée que le théâtre-paysage était une pratique héritière de l’histoire de la décentralisation : que l’effet le plus important c’était l’inversion du rapport habituel au public (ce n’est pas vous qui venez au théâtre, c’est le théâtre qui s’invite chez vous). Et puis j’ai élargi la réflexion à d’autres enjeux politiques, qui s’arriment plus directement à la dimension esthétique : quelles histoires et quels rapports sensibles au monde s’inventent dans les formes en paysage…