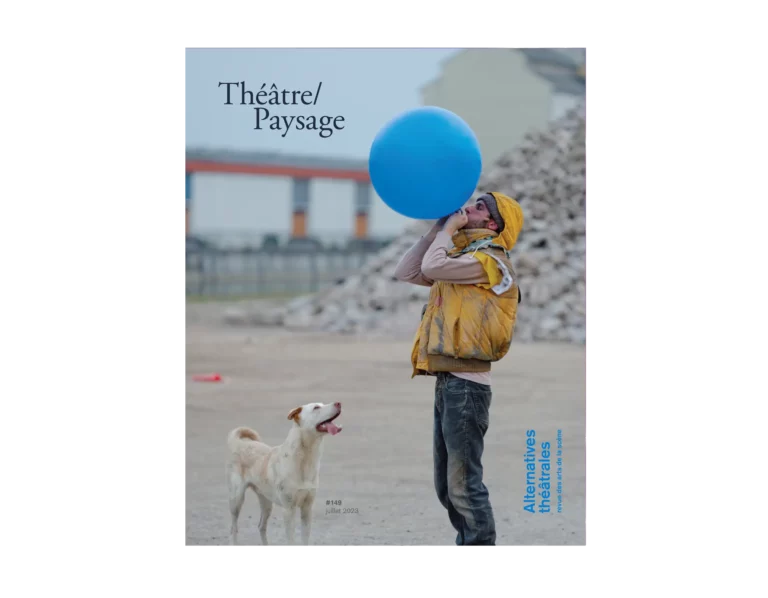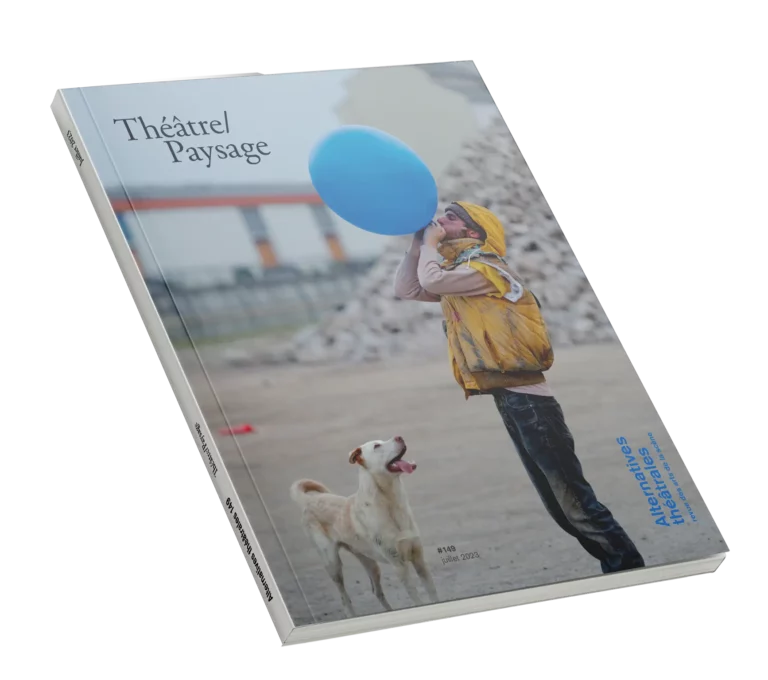Le paysage et le sonore ont tout pour s’entendre. À commencer par un même paradoxe : si tout un chacun sait, par évidence, ce que le paysage et le sonore sont respectivement, les définir de façon absolue relève de la gageure. On pourrait certes opter pour des périphrases du type « le paysage est ce qui se voit, le sonore ce qui s’entend », retrouvant alors la traditionnelle opposition entre la vision et l’audition dite aussi « litanie audiovisuelle » qui, comme l’a montré Jonathan Sterne, reconduit l’affrontement idéologique entre l’esprit et la lettre1. Sauf qu’un paysage s’écoute aussi, que le sonore ne manque pas d’imagination et que les opposer ne suffit pas à les définir. Les assembler non plus : l’expression paysage sonore ne fait que renforcer le mystère et les débats2 sur son acception exacte sont aussi nombreux qu’est fréquent son usage par les praticiens de toute discipline.
Suivons alors cette intuition : si le paysage et le sonore s’entendent si bien, c’est précisément parce qu’ils relèvent, tous deux, d’une fiction. Un spectacle pour s’en convaincre, Des Caravelles et des batailles, créé en 2019 par Elena Doratiotto et Benoît Piret, spectacle qui n’a pourtant pour objet premier ni le paysage ni le sonore mais l’utopie. Ceci explique peut-être cela.
Dire-peindre l’invisible
Inspirée de La Montagne magique de Thomas Mann, la pièce en reprend la situation initiale : l’arrivée d’un jeune homme dans un établissement situé à l’écart du monde où le temps semble avoir une étrange densité, au point qu’il altère, au fil des heures et des jours, le comportement et les pensées de ses habitants. En guise d’intrigue théâtrale donc, un lieu. Ou plutôt l’influence, l’effet de ce lieu sur les êtres qui y déambulent, comme une première inversion du rapport d’occupation entre l’espace et les personnages. Or ce lieu, précisément, n’est pas représenté. Le plateau est nu, la cage de scène drapée de noir avec une ouverture par côté pour ménager les entrées et sorties et orienter l’espace. Seul élément remarquable, une sorte de colonne-totem (« une structure » corrigera l’un des personnages) légèrement décentrée, faite de planches de bois s’élançant vers les cintres et qui sert autant de point de repère pour s’orienter (ou se perdre) que de soutien du plafond, invisible cela va de soi. C’est que le lieu, pour autant qu’il est « tout à fait réel », n’existe que dans et par l’acte d’énonciation de chacun des personnages sur scène. La didascalie inaugurale des Caravelles et des batailles est claire sur ce point : « les choses existent dès lors qu’elles sont nommées ; l’espace se crée par la parole, change constamment et se métamorphose aussi vite3 ». Une des premières scènes du spectacle est à ce titre exemplaire et consiste en une longue description, par l’un des personnages (M. Obertini), de quatre tableaux gigantesques représentant « La grande bataille de Cajamarca ». Le polyptique en question reprend les différents épisodes menant au massacre des Incas et à la capture de leur empereur Atahualpa en 1532 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro. Pointant du doigt tel ou tel endroit du vide devant lui, M. Obertini fait apparaître au fil de ses mots des détails qui peu à peu esquissent des personnages, des lignes de perspectives, des contrastes, des couleurs de sorte que se forme dans l’esprit du spectateur l’idée suivante : l’objet de ce long récit est autant le sujet des peintures que ces « yeux de tableau4 » qui se posent sur l’invisible, pour emprunter la formule d’Anne Cauquelin. Ici se fait le paysage, dans cette rhétorique qui énonce, sans y prendre garde, l’implicite d’un regard contemporain, perspectivé et anthropocentré. M. Obertini le précise lui-même : ce polyptique est « une fenêtre sur l’histoire du monde » de sorte que dire ces tableaux signifie dire le cadre à travers lequel le monde est perçu. Si les mots s’attardent alors sur l’image et sur sa forme, c’est pour faire exister ce qui pourra être entraperçu à travers elle – la fin d’une civilisation, l’émotion d’une rencontre, le doute d’un homme qui aurait, peut-être, pu tout changer. S’explique aussi l’importance de ne pas montrer les tableaux : ne pas les réduire à leur seule surface mais attirer le regard (et l’oreille) sur ce qui, en eux, tient du paysage. Et c’est peut-être lorsque les trois personnages en arrivent au dernier tableau, « La Grande bataille », que ce devenir-paysage du dire est le plus frappant dans la mesure où les visages et les regards des acteurs sont cette fois dirigés vers le quatrième mur, autrement dit vers le public. La description des corps et de leurs formes imprécises rencontre la sensation d’exister de chaque spectateur qui se retrouve, à son insu, à la fois observateur et figurant d’un tableau-paysage. Initiatique, cette scène déroule un véritable mode d’emploi de l’expérience paysagère avec, pour chaque mur/tableau, le récit d’un parcours du regard et sa grammaire : définition d’un cadre et d’une perspective, hiérarchisation des plans, réglage de la distance de l’œil avec tantôt une attention au détail, tantôt l’adoption d’une vue d’ensemble, découpage de strates temporelles dont l’ordre prête parfois à discussion et hypothèses interprétatives. Mode d’emploi qui, à y regarder de plus près, est tout aussi bien celui du sonore.
Entendre-dire le paysage
Quelques scènes plus tard, les habitants du lieu des Caravelles partagent une autre expérience paysagère, toujours guidés par M. Obertini mais augmenté d’un poste de musique qu’il actionne en temps voulu. Il commence :
M. OBERTINI
– On serait au début du xvie siècle.