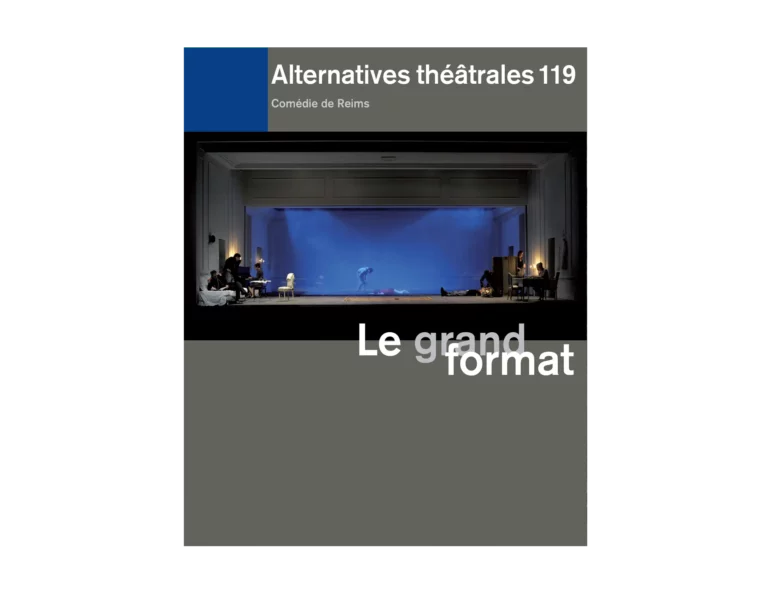Georges Banu : Par le passé, tu n’avais pas succombé à la mode du grand format et tu as fait des spectacles de longueur plus ou moins moyenne. Et tout d’un coup il y a la trilogie Büchner, qui devient grand format. Il va de soi que tu fais la trilogie par amour pour les textes de Büchner, mais l’idée de travailler sur le grand format t’a‑t-elle séduite et en même temps impressionnée ? Tchekhov n’a jamais osé écrire un roman, il est resté tout le temps dans le genre de la nouvelle et comme disait Florence Delaye « je préfère les baisers courts des nouvelles aux baisers longs des romans ». Comment as-tu géré ce projet qui est un peu en dehors de ta pratique habituelle ?
Ludovic Lagarde : En t’écoutant, je me dis qu’on pourrait aussi commencer cette discussion sur les « grands formats » liés à ce qu’on appelle les « grands plateaux ». Comme beaucoup, j’ai commencé mon parcours par des petites formes : c’était trois courtes pièces de Beckett, (trois pièces déjà…), c’était dans un tout petit lieu au théâtre de Belfort, et c’est déjà un très grand format quand tu commences, parce que le rêve est immense. À ce moment-là, tu vois les plus grands plateaux comme des espaces à conquérir incroyables, compliqués, aventureux. Ensuite, tu fais une deuxième mise en scène dans un espace un peu plus grand, tu te rends compte que c’est possible, alors tu te projettes vers d’autres plus grands espaces, et ainsi de suite. Quand tu débutes c’est important. Cela demande évidemment des savoir-faire différents, un rapport à l’espace et à la projection différent, à l’amplification…
G. B.: J’ai vécu ce dont tu parles directement lorsque j’étais avec Vitez à Chaillot. La première année a été compliquée parce qu’il passait des petites salles d’Ivry à la grande salle de Chaillot. Et il n’arrivait pas à bien la gérer.
L. L. : À faire la translation.
G. B.: Oui. C’est seulement la deuxième année qu’il a pris la mesure avec son scénographe de cet espace-là.
L. L. : Quand tu grandis quelque chose d’intime, dans le projet scénographique, dans le travail avec les acteurs, en essayant de ne rien perdre mais en projetant davantage, ça c’est un passage important.
G. B.: Et justement à propos de préserver l’intime, le grand peut intéresser en tant qu’expression d’un geste plastique, d’un geste théâtral très affiché, mais en même temps comme une surdimension qui ne fait pas l’économie du détail.
L. L. : C ’est exactement ce que je cherche, comment arriver petit à petit à grandir la forme tout en ne faisant effectivement aucune économie sur le détail, en essayant de ne rien perdre au passage ni de la naissance intime du jeu ni de la précision du travail avec les acteurs. Je pense à Odile Duboc, aux discussions et séances de travail, à la nécessaire conscience de l’interprète de son inscription dans l’espace. L’amplification des voix et la possibilité de les inscrire dans un espace sonore, m’ont permis de mieux travailler le plan serré et le plan large, le détail dans la fresque, et d’en augmenter la sensation.
G. B.: Qu’e st-ce que cela change de passer de nombreux mois avec une équipe ? La maturation a‑t-elle des incidences ; la maturation lente en quelque sorte… ?
L. L. : Le travail n’était pas si long, environ trois mois. À peu près un mois par pièce. La question scénographique s’est posée de manière cruciale : comme il s’agit de trois pièces et qu’il n’était pas envisageable de changer de décor à chaque fois, il fallait chercher comment mettre en scène chaque pièce et comment les réunir dans une seule scénographie, avec seulement quelques légères modifications. Du coup nous avons travaillé en partant d’improvisations avec les comédiens, en cherchant, et ce pendant dix jours. Dans chacune des pièces, nous nous sommes arrêtés sur les moments qui posaient des problèmes d’espace et de lieu, en particulier les scènes d’extérieur de WOYZZECK et de LÉONCE ET LENA. Le point délicat, c’était de trouver une scénographie avec Antoine Vasseur, dans laquelle la nature, la lisière, la rue pouvaient exister sans dimension épique, en faisant système avec les intérieurs. Nous avons abordé l’espace par le jeu. Puis nous avons fait un filage des trois pièces… un vrai « monstre », étape déterminante, qui nous permit, avec l’équipe de création, de trouver les résolutions.
G. B.: Il y a une différence entre le grand format avec une seule œuvre et les grands formats avec des œuvres plurielles. Vitez met en scène un même auteur, LE SOULIER DE SATIN, Brook met en scène le MAHAHBARRATA, tandis que d’autres metteurs en scène comme Gwenaël Morin mettent en scène une sorte de théâtre où ils déclinent des pièces différentes. Le grand format n’a pas toujours le même statut, ne fonctionne pas toujours de la même manière. Pour toi c’est le deuxième cas… Ce n’est pas une pièce que tu développais en durée mais tu explorais une écriture.
L. L. : Dans les années 60, 70 il y avait des producteurs italiens qui réunissaient des réalisateurs pour faire des moyens-métrages, rassemblés ensuite en un programme. Et moi qui suis un enfant du ciné-club, il m’était resté en mémoire HISTOIRES EXTRAORDINAIRES, d’après les nouvelles d’Edgar Poe, ça commençait avec METZENGERSTEIN, réalisé par Roger Vadim, WILLIAM WILSON par Louis Malle et TOBY DAMMIT par Federico Fellini. Et ce triptyque m’est revenu en mémoire. Et là j’ai eu le déclic, c’est comme ça que j’ai décidé de faire « l’intégrale ». J’ai pensé que je pourrais être en quelque sorte trois metteurs en scène différents et réaliser les trois mises en scène des pièces de Büchner, comme trois projets distincts, dans un même film, enfin l’équivalent au théâtre, et que ça serait intéressant de faire l’intégrale comme ça.
G. B.: Ce que j’ai beaucoup aimé dans la trilogie, c’est qu’il y avait de l’imprégnation, le regard était imprégné par un espace qui variait mais qui se présentait comme une sorte de socle de l’ensemble.
L. L. : Absolument, le grand format produit de la mémoire. Il a cette particularité, parce qu’il est long, de produire une mémoire intrinsèque à la représentation. Finalement quand tu fais des œuvres courtes, cette mémoire n’a pas le temps de se construire, à partir de deux heures et demie, tu commences à avoir une vie commune avec le spectateur. J’avais l’intuition de cela, qu’il fallait que les murs restent, il faut qu’il y ait quelque chose des murs et du sol qui reste, que quelque chose de l’image et des matières persiste dans la durée, pour que cette mémoire puisse se constituer.
G. B.: On est dans la salle et on vieillit ensemble. Les acteurs et les spectateurs vieillissent de sept heures ; tu n’as pas le même sentiment sur une heure et demie. Il y a une forme de partage, de partage du temps, et en même temps une forme de dépense partagée du temps.
L. L. : Ça échappe au temps du divertissement, il y a quelque chose qui est de l’ordre de l’expérience.
G. B.: Le grand format ne te semble-t-il pas parfois être aussi l’expression d’un artiste un peu amoureux de lui-même qui veut tout montrer, qui n’est pas prêt à sacrifier pour écarter ce qui peut être une surcharge ?
L. L. : C’est vrai que si la durée remplace la précision, ça risque de produire une forme de confusion, entretenue par l’idée qu’au bout d’un moment, « ça finira bien par donner quelque chose ». Mais il y a autre chose dont je me suis souvenu, un souvenir très beau à Bobigny, avec trois pièces courtes de William Forsythe. Ça m’avait tellement plu. Trois pièces courtes séparées par de longs entractes. J’avais trouvé cela admirable parce que c’est vrai qu’il y a cette tradition du grand format qui se déploie dans l’épopée, la lenteur, la durée. Là, cette ode à la brièveté qui osait la longue soirée, c’était très beau. Cela créait une concentration qui aide la perception et l’analyse. Je me souviens aussi d’un concert de l’Ensemble Intercontemporain dirigé par Boulez : plusieurs œuvres brèves de Berg et Webern, lovées entre des pauses, dans du silence…