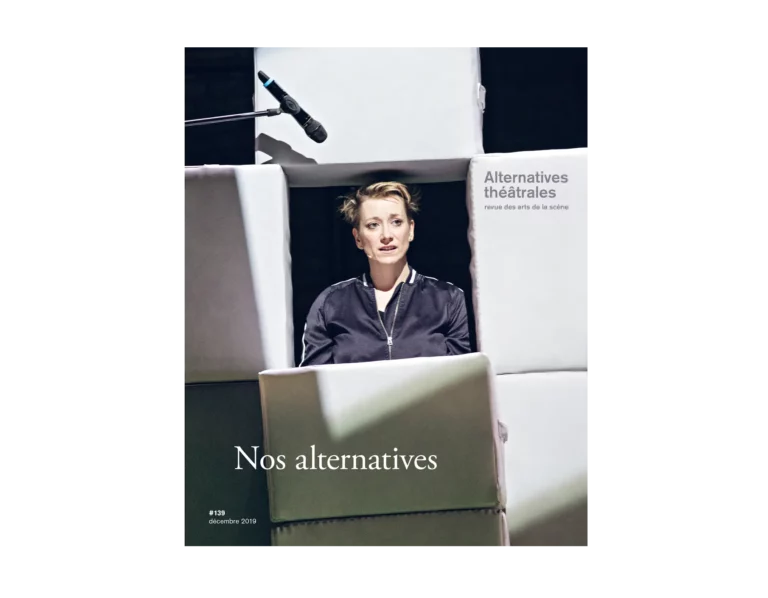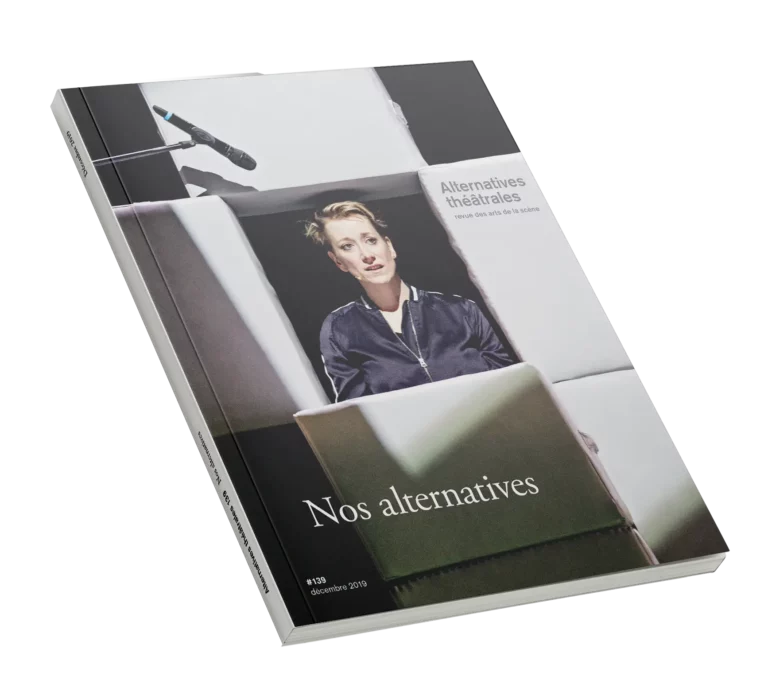Tout acte théâtral se confronte à la question de l’Un et du Multiple, tout acte théâtral appelle à l’exercice, empirique ou programmatique, de la réflexion sur ce rapport qui lui sert d’assise. Il implique la déclinaison de réponses distinctes car il n’y en a pas une seule, définitive et constante. Trois déterminations de nature spécifique interviennent cycliquement : elles sont de nature esthétique, politique et historique. Et leur intervention, avec des focalisations changeantes, affecte la pratique théâtrale, pratique différente de celle propre aux arts fondés sur le geste solitaire d’un créateur ! Le théâtre se fait à plusieurs et l’incidence de ce préalable intervient autrement, mais intervient toujours : impossible d’y échapper ! Il est pertinent de suivre les variations que l’on repère dans le temps afin de restituer en accéléré les données de ce champ de tensions que fut celui du théâtre depuis l’avènement de la mise en scène. Cela a engendré un vrai enchevêtrement des hypothèses, mais cela n’empêche pas de remarquer des priorités significatives. Le regard rétrospectif proposé ici vise à dégager les lignes de force aussi bien que l’impact des déterminations, de l’intérieur ou de l’extérieur du théâtre, qui ont affecté le processus enclenché au croisement des deux derniers siècles, le xixe et le xxe. Il s’agit de dégager, pour reprendre les termes d’Alain Badiou, « l’aspect principal » et « l’aspect secondaire » de cette contradiction du Un et du Multiple qui définit le théâtre. Il y a une succession de priorités sans cesse en mouvement.
Changement de leadership et appétit communautaire
Par sa nature d’art de groupe le théâtre implique la présence d’un leader qui fut long-temps le chef de troupe, il capo comico. Il gérait le travail et le fonctionnement de l’équipe d’acteurs en veillant surtout à la qualité du jeu basé, c’est le propre de l’Occident, sur une tradition incertaine, différente de l’autre, strictement codifiée, de l’Orient. Il agit en gardien de l’Ancien, peu soucieux du Nouveau qui, au fur et à mesure, va s’imposer comme aspiration de la scène à la fin du xixe siècle. La nouvelle figure du metteur en scène va s’instaurer pour répondre à cet appel de transformation. Il détrône l’ancien leader « acteur » pour s’imposer comme leader chargé du renouveau. Il est, pour paraphraser une réplique de Tchékhov, « le nouveau maître ». Cela va entraîner soit des visions totalitaires développées par Gordon Craig au nom du créateur unique chargé de tous les pouvoirs, soit des pratiques plus démocratiques adoptées par Stanislavski qui, avec Némirovitch Dantchenko, va fonder une équipe, le Théâtre d’art, où, dans son studio, il va se consacrer à la formation des jeunes comédiens. Par-delà ces différences, le pacte pour assurer l’avènement du théâtral est scellé et il consacre le metteur en scène comme leader. À travers le temps, chaque metteur en scène exercera ses fonctions de manière plus ou moins sévère selon son identité car Copeau ou Jouvet se distinguent de Reinhardt et Piscator et davantage encore de Meyerhold ! Il y a la fonction commune et les variations individuelles. Mais surgit, par ailleurs, la volonté de constituer des communautés autonomes, des îlots qui se dérobent à « la terrible machine à fabriquer des spectacles » dont parlait Copeau qui, lui, justement, se lance en Bourgogne dans un travail collectif avec des acteurs, professionnels et amateurs, réunis sous le vocable affectueux de Copiaus. D’autres exemples peuvent être évoqués : Marie-Christine Autant-Mathieu les réunit et les commente dans un livre qui leur est consacré1. On peut avancer l’hypothèse que leur émergence s’explique par la réaction polémique à l’égard du « nouveau maître ». Le théâtre de l’entre-deux guerres construit une antinomie explicite des deux termes dissociés qui s’affrontent !
La famille et l’ensemble
Les signes d’une première entente en dépit de ce qui s’était affiché auparavant comme une confrontation irréductible – le metteur en scène et la communauté – interviennent dans les années d’après guerre. Les figures exemplaires de l’époque développent alors le vœu d’une aventure commune, partagée entre le metteur en scène et ses partenaires. Ainsi Jean Vilar, tout en s’assumant en tant que leader, réunit autour de lui les acteurs de la nouvelle génération et fonde son travail sur ce que l’on peut assimiler à une « famille » avec ses liens durables, de parenté et de fidélité. « La famille » rassure et permet au metteur en scène d’envisager son travail à long terme sur la base d’un équilibre propice au travail entre la singularité de son approche et la confiance accordée aux partenaires autour. Cette relation est paternaliste ! Elle implique aussi bien entente que risques de révolte… Peu importe, ce qui était dissocié auparavant s’essaie et parvient à établir désormais une alliance. Si Vilar, pour préciser son projet, utilise la dénomination « Théâtre National Populaire », Brecht, lui, va placer l’accent sur la constitution d’un « ensemble » comme socle de son travail dans l’Allemagne regagnée après l’épreuve de l’exil. « Berliner Ensemble » – une communauté d’artistes réunis dans une ville qui panse ses plaies et leur sert de foyer pour se livrer à l’invention d’un théâtre autre, différent, nouveau. Le terme « ensemble » implique la volonté de se réunir et de se consacrer à une « œuvre commune ».