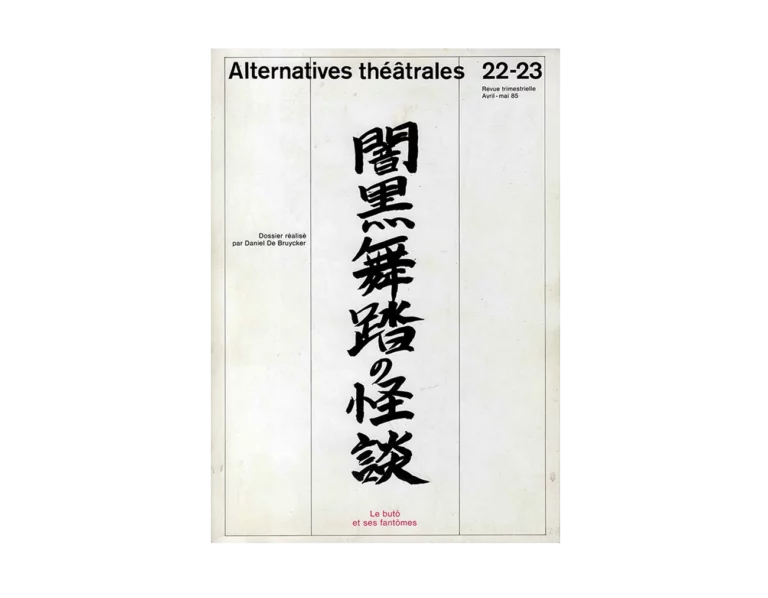Le Japon, écrit Hori Ichiro, est un musée vivant des religions. Les salles sont nombreuses : cultes shamaniques sortis tout droit de l’âge de la pierre (appelés minkan-shinko, ils subsistent en de nombreuses régions du nord du Japon), animisme shinto, bouddhisme chinois, christianisme (les premiers spectacles occidentaux joués au Japon furent des miracles, dés 1550), sans compter des dizaines de syncrétismes peu ou prou ésotériques où resurgissent le taoïsme, le confucianisme, etc. Diversité, mais aussi versatilité : le Japonais moderne pratique généralement deux religions au moins en alternance, shinto pour le baptême, le mariage et la pose de la première pierre de la maison, bouddhisme pour l’enterrement et le culte des défunts — sans se priver pour autant des services du shamane-devin ou de l’exorciste taoïste.1
Les théâtres, tout au long de l’àge classique et du Moyen-Âge, n’ont pas fait autre chose, s’inféodant aux paroisses et accompagnant avec faste cérémonies ou processions sans le moindre scrupule d’orthodoxie : le souffle du sacré est partout présent, le dogme brille par son absence.

Le shinto, simple frisson d’une âme pure face à l’éternelle jeunesse de la nature, est le culte des kami. Religion sans doctrine, sans rite et sans clergé (du moins jusqu’à la surenchère du bouddhisme concurrent), dieux sans corps, sans apparence, sans personne, dieux « discrets » (Lévi-Strauss) faits de vide (mu), ou plus exactement encore de l’atmosphère (kehai) qui imprègne ce vide — dieux abstraits, essences vagabondes de l’espace-temps. « Le kami ne réside pas : sa nature est de venir puis de repartir. Le mot otozoreru, « visiter »2. est la contraction de oto (« son ») et tsure (« apporter »). Les Japonais de jadis ont pu percevoir réellement un son de yùgen3, de mystère ineffable et d’élégance, lors de la visitation du kami. C’est sans aucun doute cela qu’on appelle aujourd’hui ch’i dans les arts martiaux et la méditation, et ce kehai des kami a donné à la culture japonaise sa tonalité de base. » « Le kehai des allées et venues du kami, imprégnant profondément la structure de l’habitat et celle de la maison de thé. la littérature, les arts et les spectacles, a donné cette « esthétique de l’immobilité et du mouvement » si caractèristiquement japonaise. C’est ce que nous appelons ma : le champ magnétique dont émane subtilement le ch’i du kami. »4
Bulles d’être
Au cœur même de la ville (Tokyo, la ville-ville) une tache blanche sur la carte ; pas même une tache, en fait, car on n’a rien gommé là : simplement on n’a pas vu, terra incognita. Derrière ses douves et son rempart, c’est pourtant ce centre vide que tout Tokyo désigne comme sa raison d’ètre. son unique point de fuite : cité interdite, le domaine impérial — un blanc sur la carte de la ville, son àme.
Au cœur du sanctuaire (Ise, sanctuaire des sanctuaires) un tabernacle jamais ouvert au fond d’un trou sombre ; le fidèle, depuis le seuil, n’aperçoit même pas la porte qui le ferme, ni le rideau qui masque la porte. Personne ne vient jusqu’ici ; y viendrait-on, ouvrirait-on le rideau, la porte, le tabernacle, on n’y trouverait encore que du vide, à peine cerclé en un miroir, regard vacant venu d’ailleurs. Ce miroir est pourtant ce que tout le Japon révère par-dessus tout — simple trou de sacré dans la texture du profane, son âme.
La pierre, comme tout objet selon le shinto, a elle aussi son àme : au cœur de la matière, non pas même des trous (ce serait non-matière, soit encore quelque chose) mais des bulles d’absence — du mu, du « ne pas ». Ici l’esprit du kami distillera sa présence, présence sans laquelle la pierre ne serait pas : bulles d’ètre, donc. L’essentiel, au jeu de go, n’est pas la pierre que l’on place ni l’amas qu’elle formera : c’est, au cœur de l’amas, le me, l’«œil », l’intersection laissée vacante qui fait de l’amas une « population ». Ikiru, dit alors le joueur : « ça vit» ; il a gagné.
Kùkan signifie l’espace ; kû est l’air, kan est l’intervalle : non pas donc l’espace-où, mais l’espace-entre, l’air-entre ; et lorsque l’air entre, ça respire, « ça vit ». Kan se dit aussi ma et signifie alors le premier temple qu’érigeaient les Japonais : quatre poteaux rejoints par une corde, le shimenawa, la « corde qui désigne ». Désigne quoi ? Peut-être une pierre, peut-être rien, l’essentiel n’est pas là mais bien autour : cet emballage qui désigne, qui dit « ça vit» ; ici l’esprit du kami distillera sa présence.
Tsutsumu

Ainsi aussi de tout le reste et de l’art surtout, cet artisanat de l’âme. Un art en japonais se dit dô, une « voie » : l’important n’est pas ce que l’on fait — plier un carré de papier, danser, verser le thé — mais de se trouver entièrement en l’acte de faire. L’archer zen manque souvent la cible, mais peu importe : la vraie cible est en son propre cœur, en cette absorption dans l’acte qui vide le cœur et y crée un appel d’air. Bulle d’absence, bulle d’être.