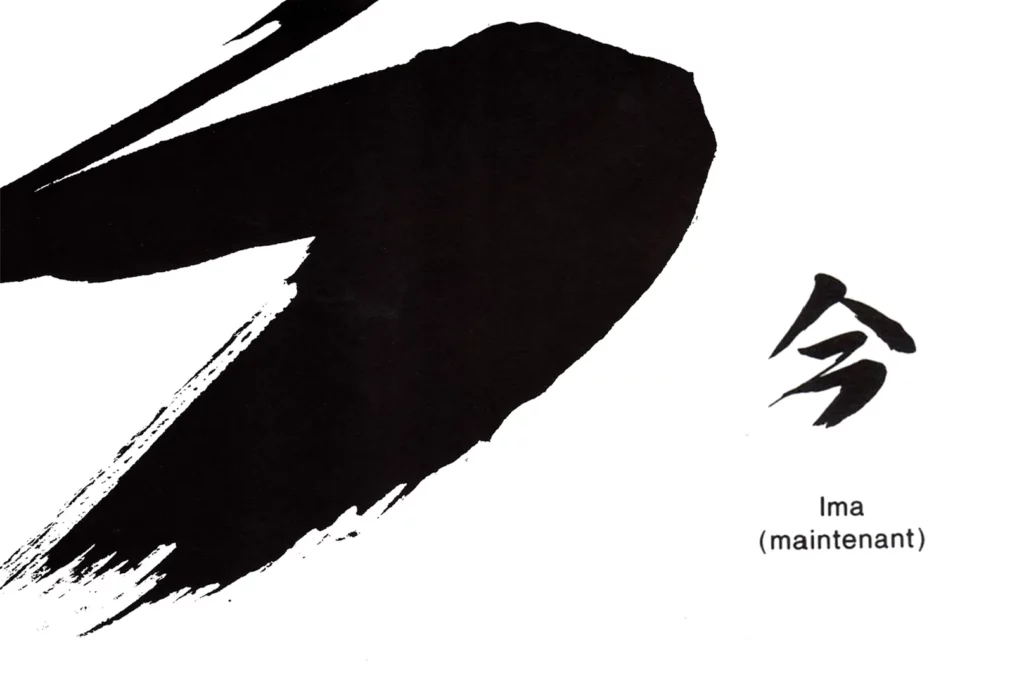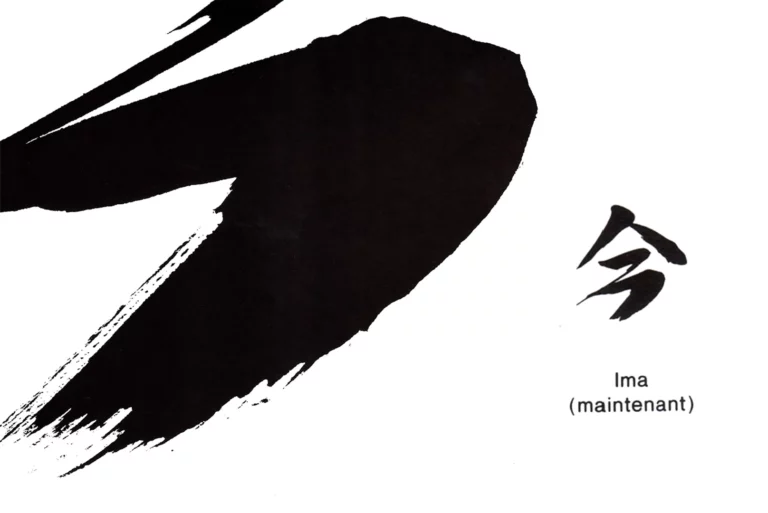C’est par sa nouveauté (ou par l’usure progressive de celle-ci) qu’un art est d’avant-garde, puis cesse de l’être. Loin de faire exception à ce schéma universel, le Japon — et tout particulièrement son théâtre — illustre ce phénomène avec plus d’évidence encore que bien d’autres pays. A la fin du siècle dernier, le shimpa1, le théâtre naturaliste créé en réaction à la stylisation du kabuki, est d’avant-garde ; de mème le shingeki2 lorsqu’il apparaît au début du XXe siècle, en opposition au shimpa à son tour codifié et banalisé. Après 1945, le shingeki cessant lui-même d’être un théâtre réaliste (en ce sens que le réalisme y devient un simple procédé, un mode dramatique admis et normalisé), on voit une fois de plus émerger face à lui un nouveau type de théâtre. C’est ce dernier qu’on appelle aujourd’hui encore le théâtre d’avant-garde au Japon — ou plus exactement les théâtres, l’avant-garde étant précisément ce qui n’est pas encore inféodé à une pratique unique sous une appellation contrôlée. A défaut d’un tel nom générique (comme pour le kabuki, le shimpa ou le shingeki), on peut néanmoins trouver à tous ces théâtres des tenants et aboutissants communs, que j’évoquerai dans l’ordre où ils sont apparus, tentant au passage d’en repérer les sources.
Un premier point commun est la « japonéité » de cette avant-garde, en net contraste avec le shingeki des débuts, d’inspiration purement occidentale3, et rejoignant ainsi le shimpa, qui dans son cadre naturaliste se voulait un théâtre japonais. Remis en honneur dans l’après-guerre, ce caractère est surtout manifeste dans l’imagerie empruntée par tous ces théâtres à l’œuvre graphique de Yoko‑o Tadanori, dont le travail d’illustrateur exerce aujourd’hui encore une influence énorme sur tout l’aspect visuel des productions de l’avant-garde théâtrale japonaise. Par un procédé cher à toutes les avant-gardes — mettre le démodé au goût du jour -, les premiers travaux de Yoko‑o recouraient à une iconographie d’un « mauvais goût » frappant, faisant délibérément usage d’un langage jusque là négligé par les « arts » et puisant essentiellement dans l’art populaire des années 1910 à 1930 : couleurs vives et fraiches, « ligne claire » dans le dessin, mises en pages réminiscentes des affiches de théâtre, menus et journaux de l’époque, usage abondant de vieilles photographies (d’enfants surtout), représentation répétée d’émotions violentes traitées de manière volontairement naïve, du rire aux larmes, et usage fréquent de symboles commerciaux (le chien de la marque Victor) — tout ceci évoquait, sur un mode apparemment puéril (mais fort sophistiqué en fait), un passé sinon meilleur, du moins plus innocent.
A la façon d’une version japonaise du pop art américain (d’où en partie son succès immédiat) mais sans l’ironie cynique d’un Warhol, Yoko‑o proposait à la génération d’après-guerre, qui allait rapidement l’adopter, un style différent, commode et entièrement neuf pour elle : toute cette iconographie, ignorée sinon méprisée, était restée invisible jusqu’à ce que Yoko‑o la réinvente4. Ce qui était hier encore trivial et agaçant devenait soudain, conformément au principe, le dernier cri, et de cette mini-révolution dans les arts graphiques les traces sont encore manifestes aujourd’hui, vingt ans plus tard et alors que Yoko‑o lui-même a essayé plusieurs autres manières depuis.
À propos de ce style apparu presque simultanément sur plusieurs fronts — il s’agit donc d’un Zeitgeist aussi — on a pu se demander qui avait influencé qui et si Yoko‑o le fondateur n’avait pas été lui-même inspiré par l’un ou l’autre dramaturge. Le cas n’est pas sans évoquer les débuts du cubisme en France, né de même dans plusieurs ateliers à la même époque, malgré quoi c’est à un non-peintre, Apollinaire, qu’on en attribue généralement la première formulation. L’influence fut manifestement réciproque entre Yoko‑o et le premier grand avant-gardiste du Japon d’après-guerre : le danseur Hijikata Tatsumi, dont le travail peut faire figure de berceau pour tout le mouvement théâtral d’avant-garde. Au fil des années ’50 et ’60, Hijikata présenta une série de spectacles comme le Japon n’en avait jamais vu : sous le nom de « danses », c’étaient en même temps des pièces sans paroles5 remarquables pour leur durée, leur illogisme apparent, leur ennui voulu et leurs coq-à-l’âne.
C’est maintenant encore un théâtre pauvre, ses danseurs tantôt en haillons, tantôt munis d’accessoires vestimentaires japonais en un Curieux assortiment — charlottes et autres fanfreluches des années ’10 aussi bien que parapluies à la mode du siècle dernier. Plus encore que la fin du monde, c’est la fin du Japon qu’évoquait Hijikata en déversant sur la scène ce bric-à-brac délibérément poignant:un champ de bataille peuplé d’infirmes convulsifs, brandissant les emblèmes pathétiques d’une civilisation disparue. Or ce n’étaient pas les œuvres d’art du Japon que l’on brandissait là, mais bien les ustensiles d’hier et la panoplie de l’ancienne culture populaire :pour autant que Hijikata ait subi quelque influence venue du théâtre, elle émanait des attractions de foire, du théâtre Yose6 et des revues de music-hall — les divertissements banals et vulgaires du Japon d’avant-guerre.
Si Yoko‑o connaissait Hijikata et son travail et a réalisé pour lui affiches et décors à ses débuts7, il semble qu’ils se soient inspirés mutuellement quant au style et à l’iconographie, l’influence de Yoko‑o devenant par contre prédominante pour les dramaturges et metteurs en scène apparus par la suite — et sans aucun doute pour Terayama Shûji8, dont le Tenjô-sajiki gekijô9 a dominé la scène d’avant-garde au début des années ’60. Terayama, resté un des meilleurs poètes modernes du Japon, évoque dans ses pièces un univers assez proche de Hijikata, pour qui il a d’ailleurs écrit, et intégrant toute l’iconographie de Yoko‑o, qui signe les affiches et parfois les décors de ses premiers spectacles. En ce monde déjà délabré mais très comme-il-faut10, on retrouve le chien de la Victor et les publicités pour des marques de cigarettes d’avant-guerre ; le cirque itinérant est bien en vue, tout comme quelques dérisoires fanfreluches empruntées à l’Occident (boas de plumes, miroirs dorés) et les vestiges pas moins pathétiques d’un Japon révolu :kimonos rayés à la mode campagnarde, manteaux du siècle dernier, chapeaux à la Sherlock Holmes, etc. Le thème ne varie guère :un jeune garçon est menacé par une femme d’âge mûr (souvent sa mère); ils sera sauvé (parfois) par une fille de son âge ou un rien plus âgée, qui souvent le dépucelle ; parfois aussi il a pour ami un homme d’âge mûr, de sexualité indéterminée. Avec ce canevas11, Terayama nous plonge délibérément en plein mélodrame, mais quelle qu’en soit la signification psychologique pour lui (et elle doit être considérable pour que ce thème réapparaisse si régulièrement), Terayama n’encourage pas le spectateur à la prendre au premier degré :tout comme Yoko‑o suggère un recul face aux clichés populaires qu’il introduit dans son iconographie, le dramaturge nous invite à observer sans passion les effets appuyés que son théâtre emprunte au mélodrame populaire d’avant-guerre. L’intention est ironique et résulte en un humour enfantin, teinté de joyeuse anarchie.
Joyeuse ou non, l’anarchie est souvent le but avoué de l’avant-garde japonaise, cette tendance étant à son comble avec le Zero jikken group12 de Kato Yoshihiro, une jeune troupe mixte dont les manifestations occasionnelles, généralement spontanées et recourant souvent à la nudité complète, si rare au Japon13, consistent pour l’essentiel en danses orgiaques à relents sado-masochistes. Quelque chose d’un Japon « primitif » se profile peut-être bien ici, mais on y retrouve également les années ’30 — dans le tabi14 entre autres — ainsi que l’aspect « champ de décombres»- implicite dans le travail de tous ces théâtres.
Franchement anarchique, le Jôkyô gekijô15 de Kara Jüro fut longtemps la troupe-clé de l’avant-garde japonaise. Des influences diverses (le mélodrame populaire et les revues du yose, la bande dessinée et le cinéma de série B, le kabuki rural) s’intégrent ici en une expérience théâtrale souvent intense. On y retrouve l’aspect « terrain vague » et l’imagerie de Yoko‑o, qui a créé des affiches pour ce théâtre également, mais non le narcissisme occasionnel de Terayama : encore que souvent masqué par le badinage du dialogue et la démesure des effets de scène, le discours de Kara est généralement politique, au moins à mots couverts.