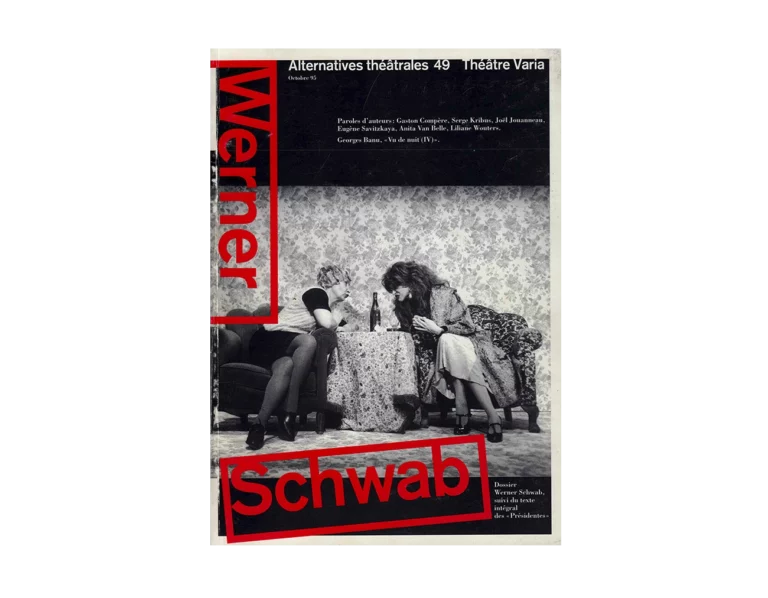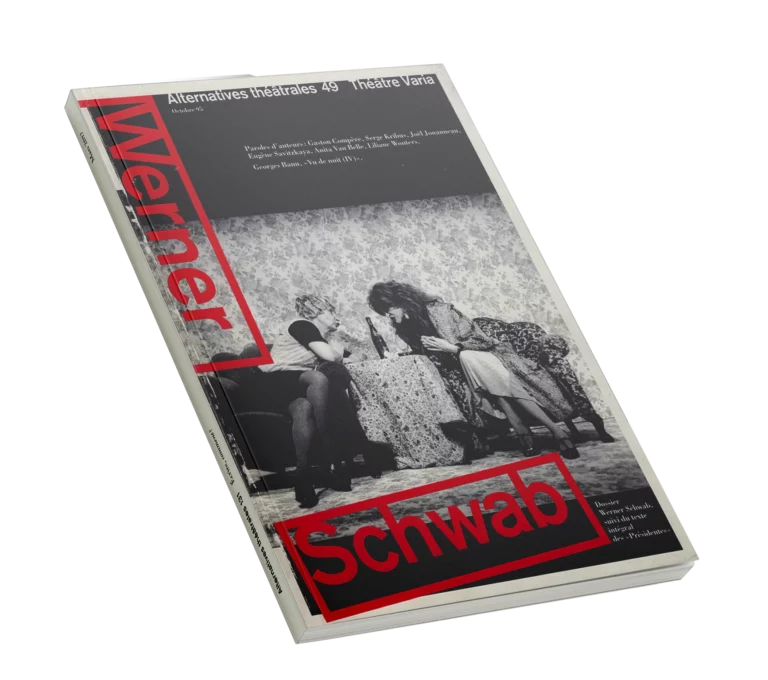ARLOC, la première pièce de Serge Kribus, tient à la fois du conte philosophique et du roman d’apprentissage. Le jeune homme qui donne son nom au titre de la pièce, est originaire d’Ecclatambour, un pays imaginaire, ravagé par la guerre, la violence et la mort. Respectant les dernières volontés de son grand-père, et grâce à la complicité d’un employé de l’aéroport, il s’exile dans les bagages d’un couple de touristes. Commenceront alors, à Bruxelles, les péripéties d’un voyage initiatique dans le quotidien moyen de l’Europe occidentale. C’est donc avec un regard où la naïveté se mêle à l’étonnement critique et à l’interrogation distanciée qu’Arloc, comme ses lointains ancêtres du XVIIIe siècle – Usbek, Micromégas ou Candide – confronte notre culture à celle, fictive, de son pays d’origine.
Au début était le conte
Si dialoguée qu’elle soit dans sa polyphonie foisonnante, ARLOC s’apparente malgré tout aux dramaturgies du récit par cette mission dont le protagoniste a été investi à travers le dernier souffle de son grand-père Herschlick – Henri en yiddish – de raconter au monde ce qui se passe à Ecclatambour, et de témoigner aussi de la culture et des mythologies de ce pays. D’où la belle récurrence poétique, au fil de la pièce, d’une version singulière de la genèse du monde, où la rhétorique biblique le dispute confusément à l’art naïf du griot : « Il y a bien longtemps flottait dans l’air un immense tambour complètement rond, à la peau belle et tendue… Le vent poussait sans cesse le tambour vers le soleil… [et puis] BOUM… La peau du tambour explosa et vola en morceaux, le soleil lui même eut peur du choc ; un court moment, il écarta ses rayons ; les éclats de peau étaient bien retombés sur le tambour, mais ils étaient devenus des hommes. Voilà comment nous sommes nés d’un son » (AHLOC, Actes Sud Papiers, p.11 – 12).
Comme dans l’épopée, ce mythe fondateur dont Arloc est désormais le dépositaire et le porte-parole sera repris dans la pièce comme un leitmotiv, avec toutes les variantes et les libertés d’interprétation qu’autorise la transmission orale. Il s’enrichira de quelques épisodes ultérieurs, paraboles tantôt limpides tantôt sibyllines concernant la genèse des oiseaux mais aussi l’origine du langage, de la danse, de la peur, du sommeil. Autant de motifs qui, par petites touches, rappellent le style faussement naïf des grandes utopies philosophiques de Jean-Jacques Rousseau sur l’origine des langues ou celle de l’inégalité parmi les hommes.
Ces questions philosophiques majeures de l’origine et de la genèse semblent d’ailleurs à ce point préoccuper l’auteur d’ARLOC qu’on les retrouve sous une autre forme dans une autre pièce à ce jour inédite, CAGOUL, dont le héros éponyme est encore plus imaginaire que le jeune exilé d’Ecclatambour puisqu’il s’agit d’un « songe », être volatile et invisible qui tient tout à la fois du bon petit génie aérien et du lutin justicier et redresseur de torts. Le jour de son anniversaire – il a trois cents ans ! –, il est témoin d’une scène de racket et de passage à tabac dans un terrain vague et vole au secours de la victime, le petit Albert, un gamin abandonné dans un home d’enfants. C’est à lui que Cagoul raconte, pour le distraire, une nouvelle interprétation tout aussi fantaisiste des origines du monde et des songes : « Au début, il n’y avait rien, enfin rien, presque rien. De la rage, de l’orage, du vent et du soufre. Les songes étaient assis au bord des nuits ou allongés le long des jours… Un jour, un songe s’est penché. Un peu trop. Il est tombé, s’est dissout. .. Après la fameuse chute, la rage avait saisi l’orage, l’orage le soufre, et le soufre le vent, et tout a commencé à bouillir, à bouger. Les songes en avaient le souffle coupé. Ils se penchaient à corps perdu pour regarder, mais comme ils se penchaient eux aussi ils sont tombés, par dizaines, par centaines, pat· milliers. Alors la terre a gonflé, et l’air et l’eau, tout bougeait, les houes, les métaux, les erreurs, les essais, les chimies… »