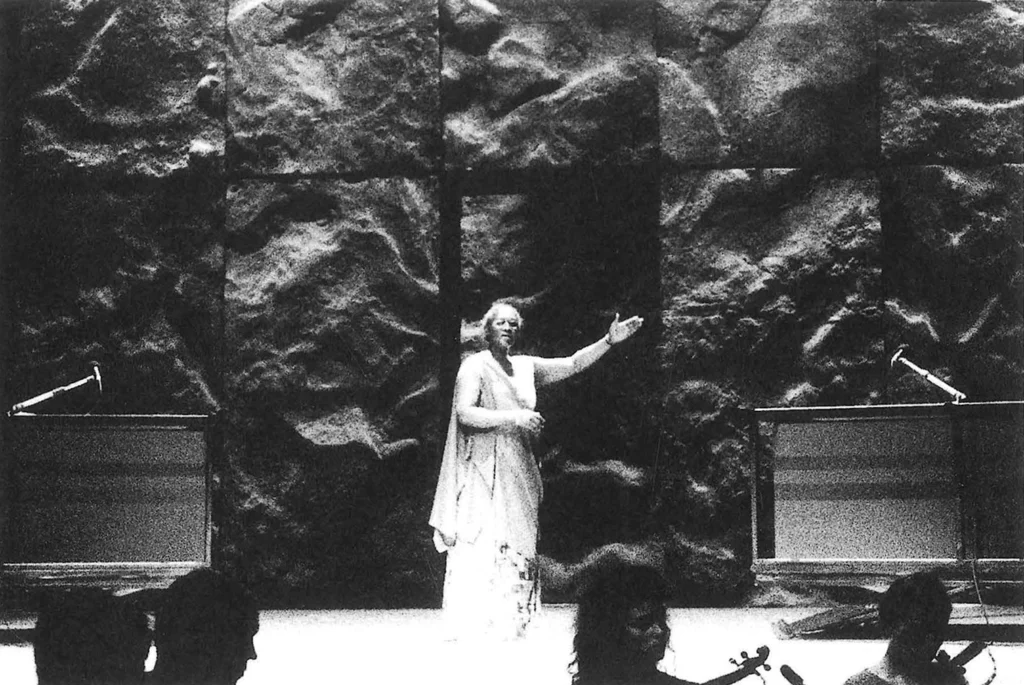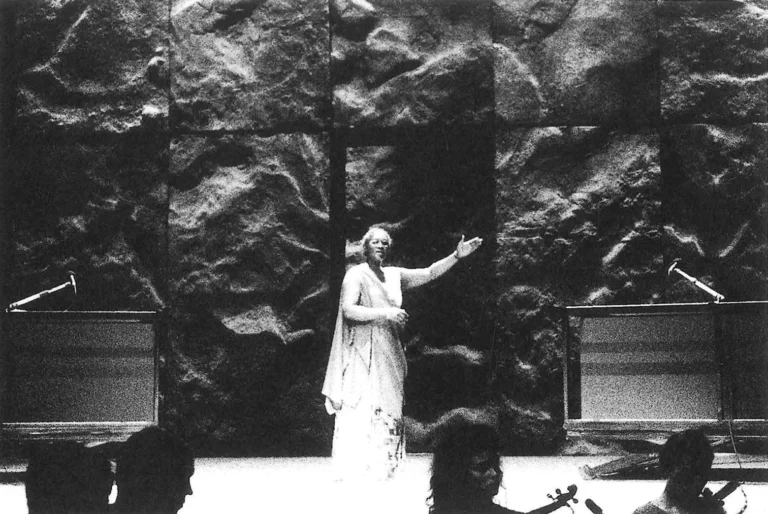MARIE-FRANCE COLLARD : Notre grande indignation au sujet de ce que les télévisions et les médias ont raconté sur ce génocide s’est conjuguée au désir de revenir à un théâtre engagé et à la volonté de parler du monde dans sa globalité en intégrant les pays du sud …
Jean-Marie Piemme : Comment et à quel prix un génocide est-il possible ? Comment les mécanismes de ce génocide peuvent-ils se dire au théâtre ? Qu’est-ce qui arrive à des hommes les uns par rapport aux autres dans un certain temps donné ? Comment une certaine mécanique sociale forme ou déforme des individus ? Ce qui m’intéressait, outre, c’était, comme auteur de venir de l’extérieur et de rejoindre ce groupe et ses interrogations. En effet, dans un moment où le théâtre ne semble plus penser beaucoup, le Groupov accorde une importance extrême au processus du sens, de la signification, à la démarche de l’analyse et de la critique, à la fonction intelligible du théâtre.
Nancy Delhalle : Comment proposer au théâtre aujourd’hui une perspective qui soit une alternative à la dénonciation récurrente du « mal » qui habiterait l’homme contemporain’ Comment par l’écriture et la mise en scène se détourner de la démonstration d’une « métaphysique du mal », produit d’une saisie fataliste du monde ?
Jacques Delcuvellerie : Le mot « engagé » fait aujourd’hui désuet. Pendant des années, le Groupov n’a plus su depuis quel point de vue on pouvait représenter le monde et au terme du triptyque-vérité1, il nous semble avoir retrouvé la possibilité d’avoir un point de vue sur la réalité contemporaine. Nous croyons aujourd’hui pouvoir de nouveau parler de vérité et de mensonge. Et notre indignation, notre révolte générée par les discours sur le Rwanda avait à voir avec la vérité ; car elle jaillissait devant le mensonge. La présentation du génocide dans les médias, la perception générale des gens d’abord largement indifférente, cela nous semblait du mensonge. Non seulement on avait tué un million de personnes dans une espèce d’indifférence voire pour certaines puissances, dans une attitude « pousse au crime », mais de surcroît, ces mores mentaient …
Notre travail sur le Rwanda s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation plus ancienne concernant la place du Sud dans la réalité contemporaine (Marie-France Collard a réalisé plusieurs films notamment sur l’exploitation dans le textile … ). On a vu les images de quelques enfants aux yeux pleins de mouches et au ventre ballonné, mais prend-on réellement conscience que, quotidiennement, en cerce fin du vingtième siècle, 40 000 enfants — ce devrait être la première information dans tous les journaux — meurent ou sont atteints pour la vie de séquelles de maladies à cause du sous-développement alors que les lois du sous-développement, les mécanismes qui produisent le sous-développement
sont connus ?
M.-F. C.: Nous cherchons aussi à contrer ces images d’enfants larmoyants, présentées comme une fatalité qui appartient à l’Afrique, comme s’il était presque naturel que l’Afrique soie ainsi. Cela fait partie d’un ensemble d’images d’Épinal sous-tendues par une forme de racisme. Or, d’un coup, les images que l’on recevait du Rwanda à ce moment ne correspondaient plus à ce que l’on attendait. La mésinformation venait aussi d’une ignorance complète de la parc des journalistes, de ceux qui devaient rendre compte de ce qui se passait. Dès lors, ils ont fait appel à une série de clichés, de choses apprises comme la mise en avant de l’ « ethnisme » : des tribus rivales qui se battent, des guerres anciennes et ancestrales qui resurgissent. Ces explications stéréotypées, dont on se contente souvent dès qu’il s’agit des pays du sud, permettent de ne pas s’interroger sur les responsabilités.
J. D.: Le déclencheur de notre travail a surcout été l’ « opération turquoise » : les forces de l’O.N.U., représentant soi-disant la communauté mondiale, se sont complètement désengagées au moment même où le massacre commençait. Et quand elles sont réintervenues, on a présenté cela comme une opération humanitaire alors que c’est une opération strictement politique …
Mais plus profondément, le génocide du Rwanda — un million de mores en crois mois — nous semble révélateur de la malfaisance du système dans lequel nous nous sentons si bien, paraît-il. La richesse de l’Occident en quatre siècles s’est très largement bâtie sur l’exploitation des colonies, où nous avons exporté notre religion et notre culture. Le Rwanda est le dernier pays conquis et colonisé en Afrique : il est, d’une manière vraiment hégémonique, chrétien, avec différences variantes. Un siècle après notre arrivée une catégorie de gens en massacre ’ d’autres et la version présentée est la suivante : dès que le colonisateur s’en va regardez le résultat. Comme si cela ’ existait avant et comme si la colonisation n’avait pas modifié les structures et les esprits de telle sorte qu’un tel événement ait lieu.
N. D.: Que peut par rapport à l’intensité d’une celle tragédie, la parole théâtrale qui touche un public limité et demeure marginale ? Ne serait-on pas tenté de la substituer à un journalisme déficient ? Quelle peut être son action sur le public ?
J. D.: Les gens qui vont au théâtre sont effectivement sociologiquement très situés. Mais ce sont eux qui tiennent les discours : dans les écoles, dans les médias, dans les universités, endroits de communication et de décision. Aussi s’adresser à eux n’est-il pas vain : ils pourront se faire l’écho de l’autre façon de voir les choses et de réfléchir que peut offrir un événement artistique. En outre, si dans l’immédiat, le spectacle a peu d’impact, il peut espérer agir plus en profondeur et sur une plus longue durée comme le font par exemple les pièces de Brecht.
N.D.: Comment dépasser soit le témoignage, soit la dénonciation ? Comment solliciter la pensée, générer une vision critique des événements ? Beaucoup de spectacles cherchant, officiellement du moins, à susciter une prise de conscience confrontent le public à l’atrocité de manière à la fois brutale et frontale. La conséquence en est souvent la fermeture, mécanisme de défense de l’esprit agressé, ou la compassion. Deux attitudes qui ne transforment rien, même pas la conscience !