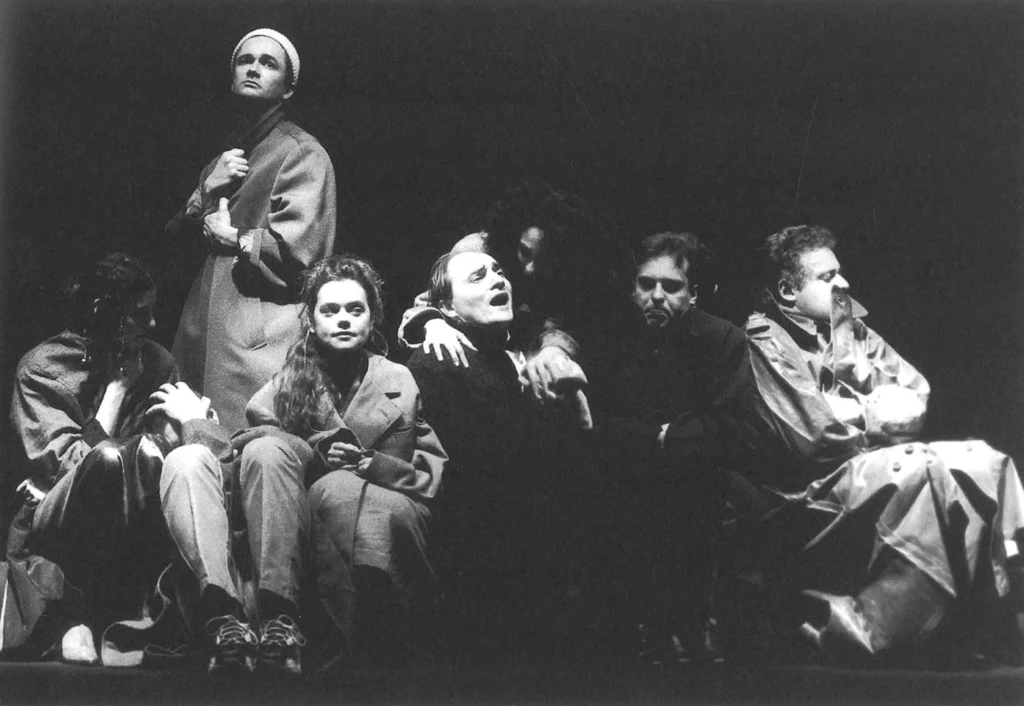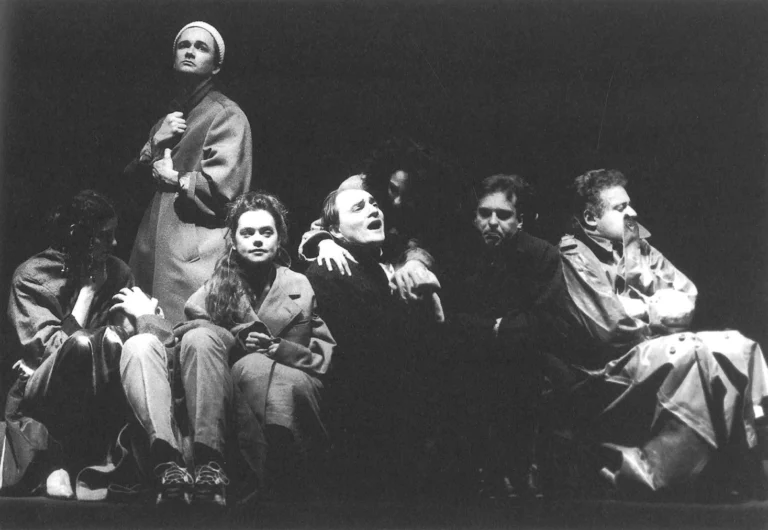DÈS LE TITRE, NÉO, TROIS PANNEAUX D’APOCALYPSE1, Jean-Pierre Sarrazac brouille les pistes, propose une néo-pièce qui exhibe sa nouveauté et donne simultanément des références historiques et picturales. Il tend des panneaux. Dans la présentation de la pièce, un peu plus loin, il annonce un triptyque. Ces « supports de bois d’un tableau » offerts au regard annoncent prophétiquement l’apocalypse et rappellent en même temps le Nouveau testament. Double grand écart, déjà, que ces ponts jetés entre la peinture et le théâtre, entre un passé indéterminé et un futur incertain. L’apocalypse est toujours pour demain, toujours à réannoncer, à moins qu’elle ne soit, enfin, pour maintenant (apocalypse now ), en dépit des images du passé qu’elle suscite. Si cela ne suffisait pas à nos attentes, Sarrazac annonce un « genre », la comédie ; de tels classements ne sont pas dans les habitudes des écritures contemporaines, à moins qu’une apocalypse « comique » soit plus facilement concevable en ce moment, surtout si elle fait tableau.
Autant de pièges et de panneaux sont les premiers indices d’une impureté avouée, d’une hybridation recherchée. Sarrazac théoricien s’est souvent déclaré en faveur du rhapsode, poète du rapetassage, du « rapailleur » comme disait joliment !‘écrivain québécois Gaston Miron. Il a rappelé sa méfiance par rapport à l’idéal du « bel animal » aristotélicien et s’est passionné pour les écritures travaillant le geste du dé-lieur. Les formes dramatiques accueillant le récit, le théâtre investi par le roman, l’épique se souvenant du dramatique, la parabole et l’écriture du détour, sont quelques-unes des pistes qu’il explore et qu’il a commentées, notamment dans L’AVENIR DU DRAME2. Il serait dommage et un peu vain de chercher dans NÉO l’application de règles d’une poétique contemporaine et de nous en tenir à un projet scolastique. D’autant que cette comédie fait flèche de tout bois, et que, travaillant les différents genres, liant et déliant panneaux et morceaux, multipliar{t les écarts, Sarrazac propose au lecteur une fable relativement attendue (l’apocalypse à l’Est vue par des Français) qu’il rend inquiétante en la creusant de l’intérieur et en mettant perpétuellement en danger son projet de comédie.
Au centre de la fable, l’installation à Moscou de Cantoulat, un grand cuisinier français que la pièce ne montre jamais. Il y ouvre un restaurant gastronomique spécialisé, notamment, dans la cuisine du sud-ouest. Comme le dit avec enthousiasme et naïveté un de ses assistants, citant son maître, « je fais entrer la grande cuisine française dans la ville de Moscou, exactement comme Ulysse aux origines de notre civilisation a fait pénétrer son cheval dans Troie. » Cette métaphore s’avère d’emblée plus complexe puisqu’il serait plus juste de parler d’une série de matriochkas, en l’occurrence de projets s’emboîtant les uns dans les autres à l’insu du cuisinier. Tous contribuent à l’échec du désir initial. Une société capitaliste internationale dénature l’envie originelle du pur amateur de cuisine. Pour celle-ci, il s’agit évidemment moins de faire connaître la gastronomie française que de gagner de l’argent au plus vite. Pour Kovacs, un des collaborateurs lointains du cuisinier, l’entrée dans l’expédition est l’occasion d’écouler dans les ex-pays communistes des boîtes de foie gras ou de vendre des caisses de vaisselle fine. De la plus petite ambition (intime) à la machination la plus complexe (la multinationale), une série de désirs vibrionnants et contradictoires dénature l’envie sincère de réussite culinaire de Cantoulat. L’argent, la drogue, le sexe, la réussite personnelle s’imbriquent. Un défilé de dessous chics se greffe sur le banquet, un strip-tease sur le défilé, une orgie sur le strip-tease. L’enfer est dans le sous-sol, les cuisines brûlent avec le cuisinier (un comble!). La semoule dans la cuisine française fait scandale. Un peu de français surnage encore sur beaucoup d’anglais et un zeste de russe. Cette structure proliférante est forcément cancéreuse ; l’action initiale semblait simple, elle éclate en une série de micro-événements qui échappent en fait à tous les personnages, à commencer par Cantoulat. Aucun désir pur n’est possible, tout projet porte en lui son parasite secret, bien décidé à profiter des circonstances. L’étonnant personnage de Kovacs, éternel vendeur de sa personne, les résume tous à lui seul ; il
est prêt à sauter sur les occasions de se lancer dans un nouveau coup, en dépit ou à cause de son incompétence primitive : la loi du « business » le lui dicte.