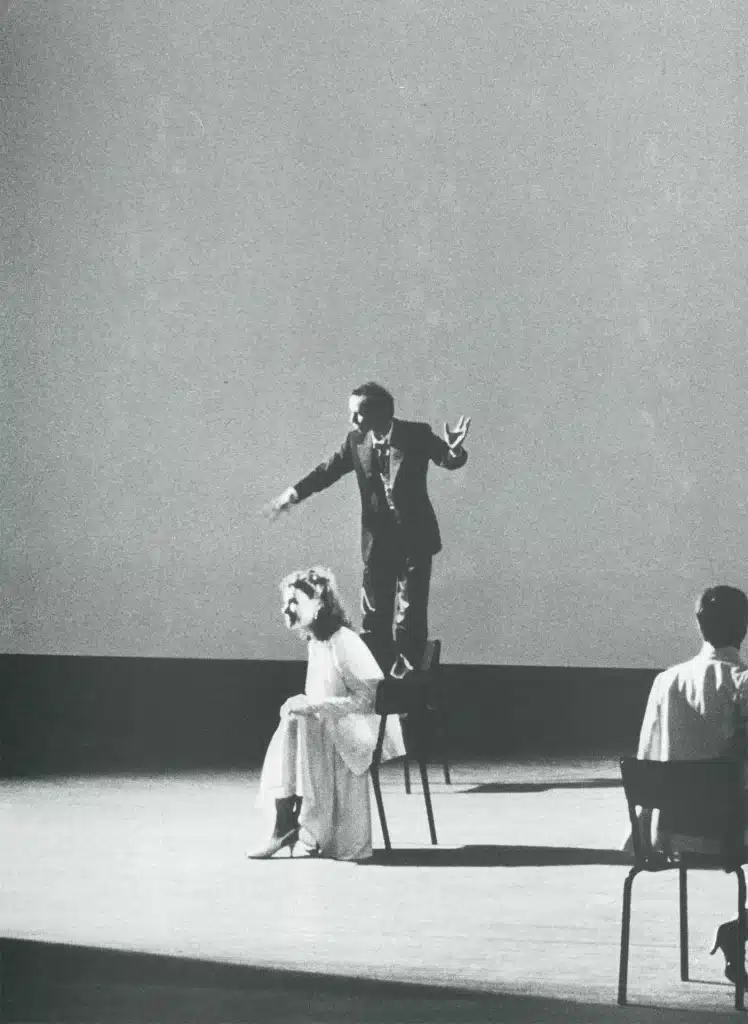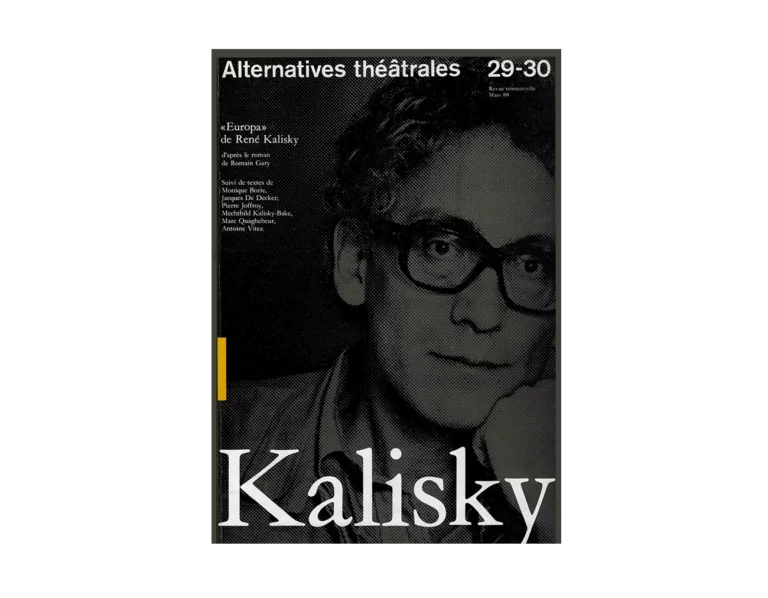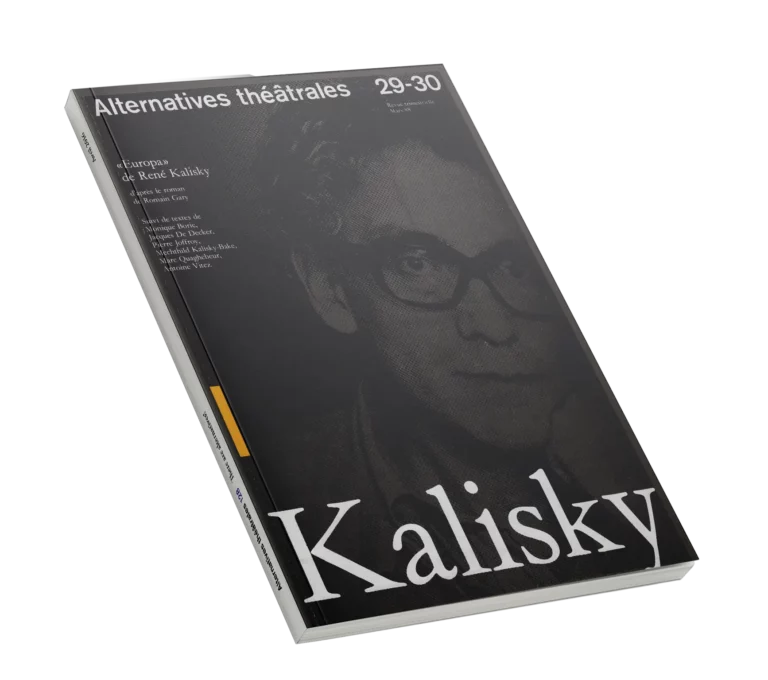Dès le départ, l’œuvre de René Kalisky a brassé diverses matières textuelles1 qu’elle remodelait librement dans une vision qui n’est qu’à elle. Elle le faisait avec une extrême liberté et n’hésitait pas à reprendre parfois certains fragments qu’elle transformait à loisir dans le déroulement de son agencement en spirales. Cette pratique, que l’on connaît depuis toujours en littérature mais qui a connu une sorte de coup d’arrêt (dans l’aveu) avec le romantisme de l’exaltation du moi et de l’authenticité à tout prix, retrouve au contraire droit de cité chez le dramaturge belge.
Pour ce contemporain de la Bible, de Shakespeare et de Brecht, qui ne craint pas d’assembler sur le plateau ce que les temps et les lieux séparent, l’emmêlement dynamique des fragments de texte qui le constituent est une impérieuse nécessité que l’auteur actualise avec aisance, souvent même avec brio. Autodidacte sans complexe et adversaire farouche de la distanciation, Kalisky joue donc non seulement de l’assemblage apparemment hétérodoxe de ses différentes lectures pour faire circuler une impertinence du sens assez peu commune par les temps qui courent, mais fonde également son inlassable dynamique créatrice dans un processus de dévoration réciproque et de malaxage d’éléments textuels jugés hétéroclites par les divers types de caste intellectuelle qui hantent son époque.
A cet égard, il n’y a rien d’extraordinaire dans le refoulement systématique dont fait l’objet son seul récit, L’IMPOSSIBLE ROYAUME…
Un triptyque de l’Europe en agonie
Ecrite pour l’essentiel2 à La Hulpe en septembre 1972 après le choc de la lecture du roman de Gary3 intitulé EUROPA, la pièce du même nom révèle. évidemment ce processus d’intertextualité vibratile. La pièce, qui déploie des éléments thématiques originaux que l’on retrouve disséminés par exemple dans L’IMPOSSIBLE ROYAUME ou dans CHARLES LE TÉMÉRAIRE4 est conçue et réalisée par l’auteur à une époque charnière de son parcours dramaturgique. Elle est en effet composée après le bloc des quatre premières pièces publiées chez Gallimard5 et avant la rédaction de DAVE AU BORD DE MER et de LA PASSION SELON PIER PAOLO PASOLINI, textes que Stock publiera avec une postface théorique consacrée aux notions de surjeu et de surtexte (dont ces deux pièces jouent jusqu’aux limites du possible).
Sans atteindre à cette scintillation et à cette démultiplication infinies, EUROPA bénéficie par contre de tous les acquis des travaux antérieurs, et notamment du resserrement scénique qui caractérise LE PIQUE-NIQUE DE CLARETTA. Elle fait en outre bloc avec les deux pièces qui la précèdent au point de constituer un triptyque : tout formel au plan dramaturgique, et ensemble symbolique au niveau politique. JIM LE TÉMÉRAIRE ne traite-t-il pas du nazisme, et LE PIQUE-NIQUE DE CLARETTA du fascisme tandis qu’EUROPA met en jeu l’humanisme ? Ces forces se sont déchirées durant l’entre-deux-guerres au point de rendre l’Europe exsangue et de lui ôter son rôle historique central — mieux, de laisser à tout jamais un goût de cendre sur les valeurs de sa civilisation et sur le sens que celle-ci a prétendu incarner6. Aussi n’est-ce pas un hasard si le motif musical qui rythme et amplifie chacune des pièces du dramaturge7 est cette fois constitué par des extraits de Mozart. Quelle synthèse pouvait mieux convenir à la problématique que ces partitions légères du plus enchanteur des musiciens du vieil empire autrichien et que leur contrepoint dant(h)esque, les marches militaires allemandes ?
Avec EUROPA, Kalisky situe d’autant mieux sa recherche de ce côté-là du miroir qu’un des pivots de la pièce, Jean Danthès, est un homme d’une vaste culture, hanté par l’idée de l’Europe, mais écœuré par la réduction de celle-ci aux seules données du mercantilisme triomphant de l’après-guerre. Face à cela, il y a le « pire, le fascisme ou le stalinisme, avec leurs offres de bonheurs inouïs, en échange de (n)otre âme », et « au mieux la culture, l’art »8. Ces hauts-lieux de l’Europe, l’ambassadeur de France près le Quirinal sait pourtant qu’ils ne pourront « coexister avec la souffrance d’un milliard d’êtres humains pour lesquels le mot même de culture est une insulte et une provocation ».
La mise à mal de l’humanisme issu de la Renaissance
Cette culture qu’incarne le locataire du palais Farnese s’est trouvée globalement mise à mal par le déchaînement des totalitarismes qu’elle engendra probablement. La dignité individuelle dont elle est synonyme n’en est pas sortie indemne, et particulièrement lorsqu’elle s’est trouvée confrontée à la question de la survie. Jarde, le psychiatre de Danthès, lui rappelle d’ailleurs que « c’est l’idée (qu’il a) pu perdre toute dignité en certaines circonstances, qui (lui) est intolérable ». Aussi la pièce insiste-t-elle longuement, et insidieusement, sur le passage de Danthès dans un camp nazi où il portait le matricule 6. 734. Sorti vivant de Dachau, la culpabilité du héros n’en est que plus forte. N’est-il pas probable que seuls sont morts « ceux qui ont résisté jusqu’au bout » tandis que « les autres ont dû renoncer à tout amour-propre, subir toutes les humiliations » ? Contraint de ramper pour vivre, voire pour accomplir ses fonctions naturelles, c’est toute la structure spirituelle du monde où Danthès vécut jusqu’alors qui « se révèl(a) soudain artificiel(le)» <. Jusqu’où allèrent d’ailleurs les choses ? A travers le personnage retors de Nitrati, la pièce se plaît à agiter le spectre d’un autre détenu, Bürgel, qui serait sur le point de faire des révélations, pénibles pour l’ambassadem de France, et dramatiques pour la conception de la culture dont il est le parangon. Il y a tout d’abord la libido que ne suffit pas à canaliser la lecture des philosophes antiques : Danthès n’aurait eu le « choix qu’entre l’homosexualité ou la masturbation ». Il y a ensuite les privilèges de classe même au sein de l’horreur absolue.
Au cours de la pièce, le héros se voit non seulement reprocher d’avoir lu « Platon dans le silence de la nuit pendant que dans la pièce voisine les prisonniers de la classe inférieure empuantissaient l’air de leur transpiration et ronflaient vulgairement» ; il est même interpellé en tant que bourgeois qui a conservé dans les camps une « parcelle de pouvoir à travers ses réflexes quotidiens d’ordre ou de propreté.
Nitrati affirme en effet que « le pouvoir ne fût-ce qu’une parcelle de pouvoir, c’est la promesse de s’en sortir » …
Tant il est vrai qu’«on souffre moins, (… ), lorsqu’on peut asservir les autres », et que la culture du futur ambassadeur lui « prescrivait de survivre » — « la certitude d’être quelqu’un » exigeant toujours des victimes…