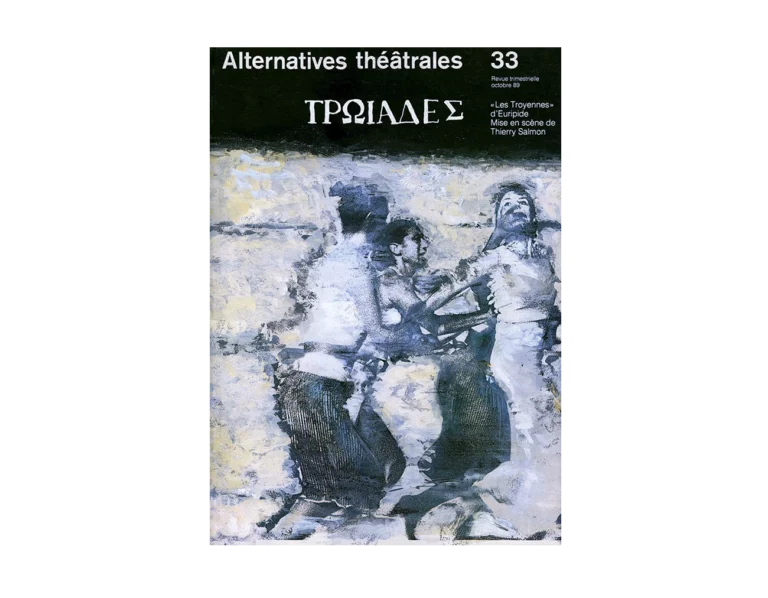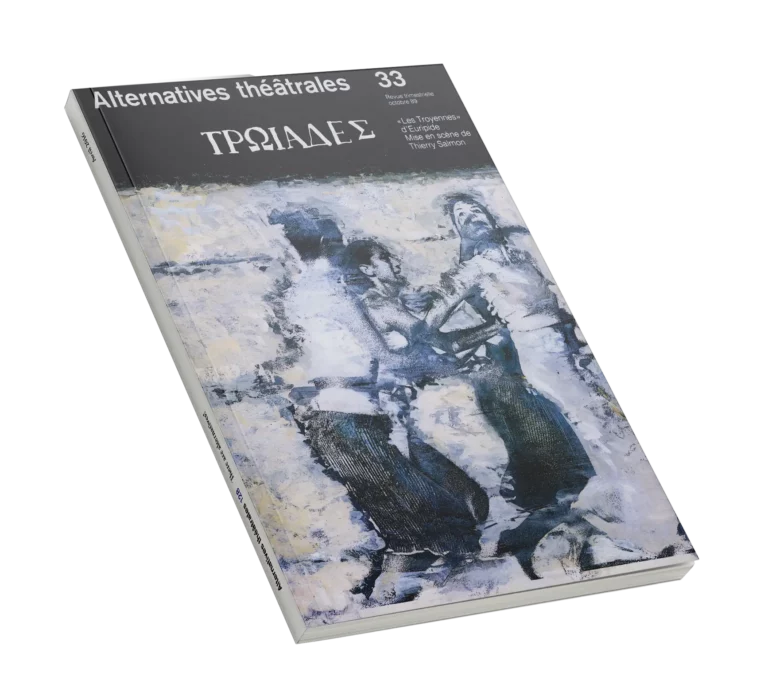Elles touchaient la fin et le savaient. mais la demeure du savoir était dévastée par ce qu’elles savaient. Leur savoir logeait dans leur chair, qui les torturait d’une façon intolérable — les hurlements ! — dansleurs cheveux, leurs dents, leurs ongles, dans leur moelle et leurs os.
Christa Wolf, extrait de « Cassandre »
(traduction d’Alain Lance, éd. Alinéa) 1985
En juillet 1986, Thierry Salmon préparait dans une carrière non loin de Santarcange!o (Rimini) les Premesse aile Troiane. Le fil conducteur du travail était Cassandre de Christa Wolf, et l’hypothèse suggérée celle d’un univers féminin capable d’aviver et de nourrir les grands thèmes d’une altérité menacée et violentée par l’histoire. J’avais été fascinée dans ce travail d’une part par l’ampleur de l’espace narratif, qui empruntait plus de l’épique que du tragique, et d’autre part par l’attention quasi minimaliste accordée aux gestes quotidiens de la complicité, tantôt joyeuse, tantôt douloureuse entre ces femmes.
Dans cette carrière complètement nue jaillissaient les images d’une nouvelle exploration de la tragédie, éclairées par une extraordinaire attention portée à l’univers féminin au théâtre.
Les travaux successifs de Salmon m’ont confirmé sa capacité très personnelle de peupler la scène théâtrale d’actions qui comme des images de veillée, construisent un pont entre mémoire et interprétation, entre l’univers de l’acteur et l’histoire du personnage. Certainement nous sommes là face à un style, mais avec en plus la suggestion d’une méthode.
La même année, en septembre, j’ai découvert grâce à Franco Quadri, la réalité artistique des Orestiadi di Gibellina : une entreprise qui dépasse de loin le seul cadre des festivals d’été. Le drame représenté à cette occasion : La tragédie de Didon reine de Carthage de Marlowe, réunissait dans la réalisation de Chérif les traits barbares d’un archaïsme archétypique avec le mythe de la continuité historique qui se réalisait par l’implacable voyage d’Enée depuis Troie jusqu’aux rivages du Latium. Devant les murs d’une Carthage que le sable du désert préservait de toute tentation classique, les passions des hommes donnaient corps à la tragédie des peuples. Les habitants de Gibellina guidaient notre vision de la tragédie parmi les ruines comme ils avaient guidé auparavant avec une juste fierté notre parcours dans les quartiers en reconstruction.
Quand à Gibellina on a commencé à parler du projet Les Troyennes et que Salmon m’en a proposé la responsabilité dramaturgique, à mesure que les étapes de son développement à travers l’Europe se définissaient, s’est éveillée en moi, en même temps qu’un sentiment d’incrédulité, la conscience d’une nécessité.
Chaque élément du projet était fascinant, et apparaissait comme la vérification définitive d’hypothèses et de pratiques suggérées par ailleurs. Il me semblait que nous sortions du domaine des interprétation shabituelles et des exécutions convenues pour entrer dans le vif d’un processus de travail où jour après jour la fatigue quotidienne libère la matière même des désirs mis en jeu. Chacun des maillons du projet dépassait le seul plaisir de sa propre existence pour poursuivre un idéal d’unité. C’est peut-être là une manière de vivre aujourd’hui la fonction du tragique. Chacune des articulations de cette fonction éclairait et enrichissait l’unité de l’ensemble.
Fermant les yeux, je revois ces images. Le mont Ida sous la lumière changeante. Les pentes où s’ouvraient les cavernes. Le Scamandre et ses rives. Pour nous, l’univers c’était cela, aucun paysage ne saurait être plus beau. Les saisons. Les odeurs des arbres. Et notre existence sans entraves, une joie neuve pour chaque jour nouveau. La forteresse ne venait pas jusqu’à nous. Ils ne pouvaient pas combattre l’ennemi et nous en même temps. Ils nous laissaient tranquilles, nous prenaient les fruits que nous cueillions, les étoffes que nous tissions. Nous mêmes vivions pauvrement. Nous chantions beaucoup, je m’en souviens. (…) A celles qui avaient besoin d’une ferme espérance, nous n’imposions pas notre conviction que nous étions perdus. Mais notre gaieté, dont le fond garda toujours une couleur sombre, n’avait rien de forcé.
Nous ne cessions d’apprendre. Chacune faisait profiter l’autre de son savoir particulier. J’appris à faire des pots, des vases.
J’inventai un motif noir et rouge dont Je les ornai. Nous nous racontions nos rêves. beaucoup s’étonnaient de tout ce qu’ils pouvaient révéler. Mais souvent, à vrai dire la plupart du temps. nous parlions de ceux qui viendraient après nous. Comment ils seraient. S’ils se souviendraient de nous.
S’il rattraperaient ce que nous avions manqué, s’ils amélioreraient ce que nous avions mal fait. Nous nous torturions le cerveau pour trouver le moyen de leur laisser un message, mais nous ne possédions pas l’écriture. Nous gravions des animaux. des êtres humains, nos propres silhouettes, dans des cavités rocheuses dont nous obstruâmes l’entrée avant l’arrivée des Grecs. Nous laissions les empreintes de nos mains les unes à côté des autres dans l’argile tendre. Nous appelions cela, en riant, nous rendre éternelles. Cela donna heu à une fête des attouchements, au cours de laquelle, comme spontanément, nous touchâmes l’autre, les autres, et apprîmes à nous connaître mutuellement.
Nous étions fragiles. Comme notre temps était compté, nous ne pouvions le gaspiller dans l’accessoire. C’est pourquoi nous allions, en jouant comme si nous disposions de tout le temps du monde, vers l’essentiel, vers nous.Christa Wolf, extrait de « Cassandre » (traduction d’Alain Lance, éd. Alinéa) 1985
Tout d’abord il y avait le défi artistique et humain, les échos qui s’élèvent des ruine de Gibellina et se répercutent dans cette tragédie de la destruction, le thème de la mémoire et de la transformation lié à la figure féminine. Et puis la tradition retrouvée dans les formes musicales, dans les chants. Enfin, constant, le thème de la poésie comme purification.
Il y avait aussi certains éléments plus directement liés à la pratique théâtrale. Le rêve d’un groupe tellement composite et en même temps monolithique, à une époque où l’on n’aime guère mêler spectacle et vie de groupe ; et dans ce microcosme, l’usage du grec ancien, d’une langue incompréhensible pour les spectateurs et inconnue des actrices. De telles expériences avaient déjà été faites dans ce sens au théâtre, mais ici outre la volonté d’établir une koinè pour un groupe aux traditions et aux langages divers, au-delà de la citation interne et du défi qu’offrait le matériau linguistique, il restait le fait que nous étions confrontés à un texte dans toute son intégrité : non seulement la langue de la tragédie, mais le verbe même de cette tragédie dans la structure intacte de la fable.