En avril dernier, l’Opéra de Lille a obtenu la certification internationale ISO 20121 qui atteste de ses bonnes pratiques en matière de développement durable : parmi ces pratiques certifiées figurent certes les dons de costumes et de décors déclassés, l’utilisation de matériaux réutilisables, le remplacement du parc des projecteurs par des LED, mais aussi l’engagement de la maison en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelles, ses actions artistiques et culturelles, sa politique tarifaire ou encore son ancrage territorial. La variété de ces indicateurs est révélatrice du caractère transversal de la réflexion écologique aujourd’hui.
Dans ce qu’il nomme écosophie,
le philosophe Félix Guattari distingue trois écologies :
Environnementale (les rapports de l’être humain à son environnement), sociale (les relations entre les êtres au sein d’une société) et mentale (la production de la subjectivité humaine). C’est dans la continuité de cette pensée globale que nous dresserons un état des lieux de cette question à l’opéra : comment un territoire réel ou symbolique peut-il se reconstituer autour d’une maison d’opéra ? Quels liens peuvent se tisser entre l’institution et ses publics ? La réflexion sur la crise écologique que nous traversons peut-elle produire de nouvelles formes et générer de nouveaux récits ?
Ces questions, nous avons choisi de les poser à trois maisons – l’Opéra national de Lorraine, l’Opéra de Lille, l’Opera Ballet Vlaanderen – et à leurs directeur.trice.s respectif.ive.s – Matthieu Dussouillez, Caroline Sonrier, Jan Vandenhouwe. Bien qu’ayant des histoires et des tailles différentes, ces trois institutions ont en commun une volonté d’ouverture qui transparaît à travers leurs programmations et leurs politiques culturelles. Elles s’inscrivent en faux contre toute conception qui réduirait l’art lyrique à un art exclusivement patrimonial ou muséal. Elles sont tournées vers l’avenir, vers l’expérimentation et les devenirs de l’opéra comme spectacle vivant et forme d’expression contemporaine en réinvention permanente.
Comment un territoire peut-il se reconstituer autour d’un opéra ?
Programmation et territoire
Pour Jan Vandenhouwe qui a pris les rênes de l’institution flamande en 2019, on ne programme pas une saison d’opéra hors-sol. Le geste de programmation résonne sur un territoire : « L’espace dans lequel nous nous situons raconte déjà une histoire à laquelle nous devons réagir. » Sa première saison à la tête de l’Opera Ballet Vlaanderen s’est ouverte par Don Carlos, une œuvre dont l’argument est lié à l’histoire politique des Flandres, et présentait, entre autres, le rare opéra de Schreker Der Schmied von Gent (Le Forgeron de Gand).
Ce lien avec le territoire intéresse également Matthieu Dussouillez. Lorsqu’il a pensé son projet artistique pour l’Opéra national de Lorraine dont il a pris la direction en 2019, il s’est intéressé à l’Art nouveau. Ce mouvement artistique, qui – au début du 20e siècle – a imprimé sa marque à l’architecture nancéienne, est l’une des sources d’inspiration de sa programmation opératique et symphonique. Cette saison s’est ouverte par la création française de Görge le rêveur, un opéra oublié, composé par Zemlinsky dans les années 1900. Il importe de distinguer cette résonance avec le territoire de tout localisme qui comporterait un risque de repli sur soi : « Depuis ses origines, l’opéra est un art européen, précise Matthieu Dussouillez. Il est difficile de l’imaginer sans cette dynamique transnationale. La réflexion autour de la crise écologique doit nous amener à davantage d’ouverture culturelle, à plus de curiosité envers les autres, et non l’inverse. » Ainsi, les trois spectacles cités dépassent le territoire ou le courant artistique qui les inspirent : Der Schmied von Gent confronte la Belgique à son passé colonial, Don Carlos et Görge interrogent, chacun à leur façon, une forme d’idéalisme politique en posant cette question : comment la nouvelle génération peut-elle créer une alternative à l’ancien monde ?
S’ancrer dans une région
S’appuyant sur le réseau des institutions culturelles de la région Hauts-de-France, l’Opéra de Lille coproduit hors-les-murs une programmation de spectacles de danse et de formes proches du théâtre musical. Cette saison étaient notamment prévus une adaptation d’Orphée et Eurydice au Théâtre municipal de Tourcoing, Dark Red d’Anne Teresa De Keersmaeker au Louvre-Lens et OVTR (On Va Tout Rendre) de Gaëlle Bourges au Vivat, Armentières.
En outre, l’Opéra affirme depuis 2015 sa présence à l’échelle régionale à travers Finoreille, un programme d’ateliers de pratique vocale à destination des enfants de 8 à 12 ans, menés chaque semaine dans 19 villes de la région. La saison passée, ces ateliers ont abouti aux Noces, variations, un spectacle joué à l’Opéra de Lille avec 300 enfants issus de la métropole et de la région. Cette adaptation des Noces de Figaro réalisée par le compositeur Arthur Lavandier et la metteuse en scène Maëlle Dequiedt aurait dû être reprise en mars 2021 au théâtre municipal de Denain – une ville du réseau Finoreille – pour une date qui revêtait une portée symbolique : située dans le bassin minier valenciennois, Denain compte parmi les villes les plus pauvres de France. Malheureusement, le Covid en a décidé autrement.
Selon Caroline Sonrier, la certification 20121 récemment obtenue permet d’unifier divers aspects de l’institution – par exemple, la saison in situ et les actions menées sur le territoire – autour d’une même finalité artistique, sociale, économique et environnementale : « Dès que l’on sort de la communication de saison, nous avons du mal à intéresser les médias et le public aux actions que nous menons dans la région. Cette certification nous permet de faire évoluer l’image que le public se fait de l’Opéra de Lille : un opéra, ce n’est pas juste une machine à produire des spectacles. C’est une institution implantée sur un territoire et qui a une responsabilité vis-à-vis de ses habitants. »

Investir la ville
Dès sa deuxième saison à Nancy, Matthieu Dussouillez a mis en place le Nancy Opera Xperience (NOX), un laboratoire de création lyrique, dont l’un des buts est de faire travailler des artistes en étroite connexion avec la ville et le territoire : « Je souhaite créer un lien entre l’Opéra et le lieu où vivent les gens pour qu’ils se sentent concernés par nos créations. » Une réflexion qui n’est pas sans rappeler une idée développée dans Le Spectacle et le vivant, le livre blanc récemment publié par Sophie Lanoote et Nathalie Moine. Dans cette contribution à la transition écologique et sociale, les deux autrices proposent de remplacer le terme passif de « public » par celui « d’habitants », qui met l’accent sur la relation complexe et active qui unit un citoyen au théâtre situé sur son territoire. Cette saison, la première création du NOX – Êtes-vous amoureux ? – avait pour particularité de se baser sur des témoignages de Nancéien.ne.s, recueillis au cours de résidences longues – entre l’été 2019 et l’hiver 2020 – par la réalisatrice sonore Chloé Kobuta et le compositeur Paul Brody : « La réalisation de ce projet, explique Matthieu Dussouillez, a pris la forme de douze courts-métrages mis en scène par Kevin Barz. Le tournage a permis de réinvestir des lieux de la ville et de la métropole : une laverie, un cinéma, une piscine, une brasserie ou la piste du Bowling situé dans le centre commercial des Nations. Des lieux périphériques, désaffectés ou désertés à cause du Covid. » Cet intense mois de tournage était l’occasion de tisser d’autres liens entre l’Opéra et les habitants de la métropole : « Des équipes de médiation étaient dépêchées pour expliquer le projet aux passants dont la curiosité était piquée lorsqu’ils voyaient des équipes de l’Opéra investir leur quartier. » À l’image de ces habitants d’une cité du Haut-du-Lièvre, qui, un après-midi, ont découvert au pied de leur immeuble un piano à queue en flammes pour les besoins de la cause. Pour Matthieu Dussouillez cette présence dans la cité contribue à redessiner un territoire symbolique et partagé : « Par exemple, autour du NOX, l’Opéra a mené un projet chorégraphique avec les détenues de la Maison d’arrêt pour femmes : un tel lieu est souvent perçu comme situé au-delà de l’enceinte de la ville, comme s’il en était exclu. Il était important pour nous de le réinscrire symboliquement dans notre espace commun. »
Avant d’être directeur artistique de l’Opera Ballet Vlaanderen, Jan Vandenhouwe occupait le poste de directeur de la dramaturgie à la Ruhrtriennale. De ces années dans la Ruhr, il a gardé le goût d’investir – par le spectacle vivant – les vastes friches industrielles désaffectées qui font l’identité de ce festival prestigieux : « L’un des défis qui nous attend pour les années à venir est la rénovation de l’Opéra de Gand, l’une des salles de l’Opera Ballet Vlaanderen. La fermeture de la salle entre 2024 et 2028 nous oblige à repenser notre présence dans la ville. Il n’est pas nécessaire de construire une salle éphémère : je préfère travailler avec nos partenaires municipaux pour trouver des lieux que nous pourrions investir, peut-être des espaces industriels auxquels nous pourrions donner une nouvelle fonction en y créant des spectacles. »

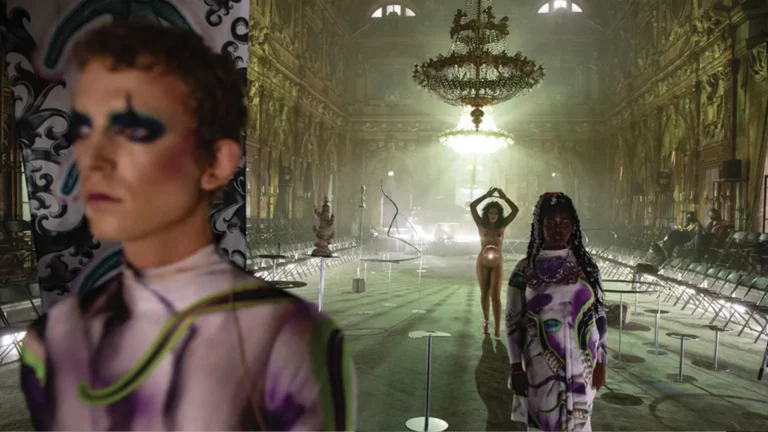



![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)

