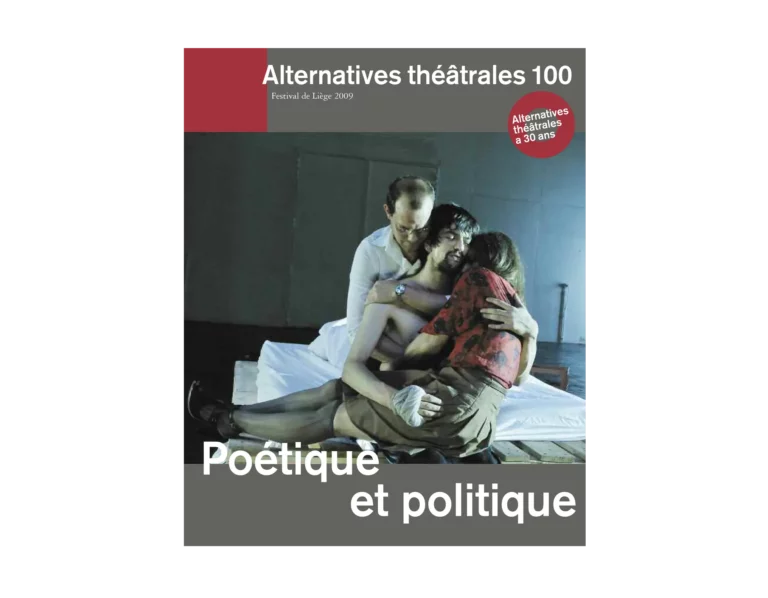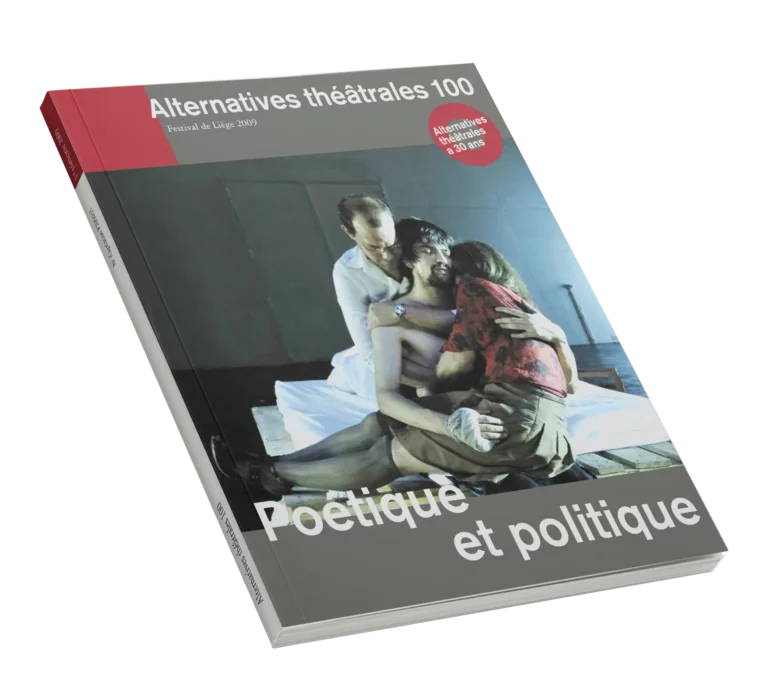DEPUIS ses origines grecques antiques jusqu’à une période relativement récente – fin du XIXe début du XXe siècle –, et si l’on excepte les ridiculisations comiques et grotesques de l’esclave, de l’artisan ou du valet, la représentation du travail sur la scène occidentale, comme celle du sexe et de la mort, semble frappée d’un tabou dont les enjeux, à la différence des deux autres, ne font l’objet d’une interrogation que depuis très peu de temps : le théâtre de Brecht dans les années 30 – 50, peut-être, et les théâtres “militants” de l’avant et après 68.
Faut-il rattacher l’effroi qui le rend « obscène » – littéralement : indigne de figurer sur la scène, ou qui doit demeurer hors-scène – à son étymologie latine de « tripalium », instrument de torture composé de trois pals ou trois pieux sur lequel on empalait les suppliciés ? On comprendrait dans ce cas que la douleur, la souffrance et le sacrifice liés à cette horrifique origine métaphorique aient pu dissuader les poètes, et avec eux toute une société, durant des siècles, de représenter une telle damnation. Il faut bien dire que dans les sociétés oligarchiques et aristocratiques qui se succèdent de l’Antiquité à l’Ancien Régime, le travail reste une activité vulgaire, puisque la part d’effort et de sacrifice incombant au peuple. Il produit la richesse dont jouissent les élites, mais doit demeurer occulte et honteux.
Il faudra donc attendre la période pré-révolutionnaire et le drame bourgeois (LA BROUETTE DU VINAIGRIER de L. S. Mercier en 1774), puis la révolution industrielle et le drame naturaliste (LES TISSERANDS de G. Hauptmann en 1892) pour que progressivement, presque timide- ment, le travail d’abord artisanal et marchand, puis industriel et ouvrier, accède enfin, en deux temps, et non sans audace, au droit à la représentation scénique.
Une dramaturgie du jetable
C’est Michel Vinaver, le premier, qui dans les années 70, fort de son expérience de cadre supérieur puis de PDG au sein de la société Gillette Europe, osa situer quelques-unes de ses premières pièces – PAR-DESSUS BORD, immédiatement suivie de LA DEMANDE D’EMPLOI – dans le contexte déterminant de l’entreprise. L’Entreprise, avec lui, devenait une sorte de protagoniste thématique, comme naguère la critique avait pu le suggérer du Peuple chez Victor Hugo ou de l’Argent dans la Comédie humaine de Balzac. Avec ces deux premières pièces, rapidement suivies de LES TRAVAUX ET LES JOURS, À LA RENVERSE, L’ORDINAIRE, LES VOISINS et L’ÉMISSION DE TÉLÉVISION, se révélaient à la dramaturgie contemporaine les images concrètes et les mécanismes de la concurrence de la faillite, de la restructuration, des licenciements économiques et collectifs, du chômage, du désœuvrement, de la demande d’emploi. Lui-même impliqué dans l’évolution d’une consommation de plus en plus aliénée au jetable (les rasoirs, les briquets, les stylos…), Michel Vinaver découvrait ainsi, avec les yeux d’un observateur aigu voire d’un visionnaire, que l’homme lui-même, à travers la « réification » (ou si l’on préfère la « chosification ») dont il fait l’objet dans le mode de production capitaliste, subirait bientôt à son tour les conséquences cruelles de cette logique du jetable qui aujourd’hui, de restructuration en licenciement, le disqualifie et le pousse brutalement vers la sortie, jusqu’à l’exclusion définitive.
Vinaver et après
Avec cette invention d’une dramaturgie de l’entreprise qui déclinait toutes sortes de situations
et de produits – du papier toilette au cuivre chilien en passant par les moulins à café –, et toutes sortes d’approches et de tonalités, de la choralité symphonique la plus épique à l’intimité presque confidentielle d’un « théâtre de chambre », Vinaver ouvrait une voie que toutes les dramaturgies du monde allaient bientôt adopter pour la déployer à leur tour dans d’autres sensibilités culturelles et générationnelles. Avec TOP DOGS du Suisse Urs Widmer, puis avec A.D.A. : L’ARGENT DES AUTRES de l’Américain Jerry Sterner, Daniel Benoin interrogeait les thérapies de reconversion et de recyclage des cadres supérieurs, puis les OPA lancées par les liquidateurs de Wall Street sur les entreprises familiales les plus fragiles des États éloignés de NewYork. À l’autre bout de la chaîne, dans OHNE, le jeune auteur belge Dominique Wittorsky pousse quant à lui jusqu’à l’absurde la vaine répétitivité des visites d’un travailleur immigré à l’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi). Et dans L’ENTRETIEN, Philippe Malone dissèque au féminin la rhétorique de l’entretien d’embauche comme « poste frontière de l’entreprise ». On pourrait multiplier les exemples de ces écritures nouvelles post-vinavériennes, qui toutes articulent avec une grande acuité critique les rouages économiques et intimes de nos vie quotidiennes. D’autres esthétiques plus chorales, plus musicales et plus burlesques, comme celle de Christoph Marthaler, ont également interrogé jusqu’à l’absurde la logique de la spécialisation, du recyclage et de la restructuration dans des spectacles comme LES SPÉCIALISTES, STUNDE NULL (L’Heure Zéro) ou plus récemment GROUNDINGS, un spectacle apocalyptique et « réjouissant » inspiré de la faillite de la compagnie Swissair, emblématique fleuron de la qualité de service à l’helvétique.
Économie politique
La dramaturgie fondatrice de Vinaver peut être mise en perspective par des discours et des esthétiques scéniques plus récents comme ceux de Joël Pommerat et Falk Richter. Le premier, dans AU MONDE, mettait en scène une famille d’industriels et de financiers à l’heure de la passation générationnelle avec toutes les dérives psychodramatiques, exprimées ou secrètes, qu’un tel rituel peut entraîner avec lui. Puis dans LES MARCHANDS, dernier volet d’une trilogie à laquelle appartient également D’UNE SEULE MAIN, Pommerat nous livre à propos de l’attachement de toute une humble population à son usine – une usine chimique, pourtant, à forte coloration « Seveso » – une remarquable leçon d’économie politique, comme on n’ose plus en exprimer depuis Marx, Engels et Brecht, sur la nature même du travail comme vente partielle ou totale de son corps et de son « temps de vie », et pour que cela soit encore plus concret, c’est, contre toute attente, une prostituée qui l’exprime au nom de tous les ouvriers salariés.
De l’économie politique, il en est aussi question chez Falk Richter, dans UNTER EIS (Sous la glace) dont le titre évoque également une forte image de la mythologie marxiste, celle des « eaux glacées du calcul égoïste », inscrite en bonne place dans LE MANIFESTE COMMUNISTE. À l’heure des techniques sophistiquées d’engineering et de management, et à l’échelle de la mondialisation, UNTER EIS décrit avec férocité l’univers des consultants, « arroseurs, arrosés » à leur tour victimes des logiques de l’âge et du jetable. Dépossédés de leur identité par l’anonymat interchangeable des halls d’aéroport et des chambres d’hôtel pour hommes d’affaires, ils sont à leur tour, comme jadis la classe ouvrière, victimes d’une irréparable « aliénation ». Et le théâtre nous aide à comprendre l’enjeu d’un tel processus : le personnage en tant qu’individu s’y dissout dans l’anonymat indifférencié d’un personnage abstrait – l’entreprise dans son évolution la plus incernable : multinationale et mondialisée.
Ce texte légèrement remanié a paru une première fois dans le journal du Théâtre National du Nord (Lille) Scènes de vie, avril 2008. É