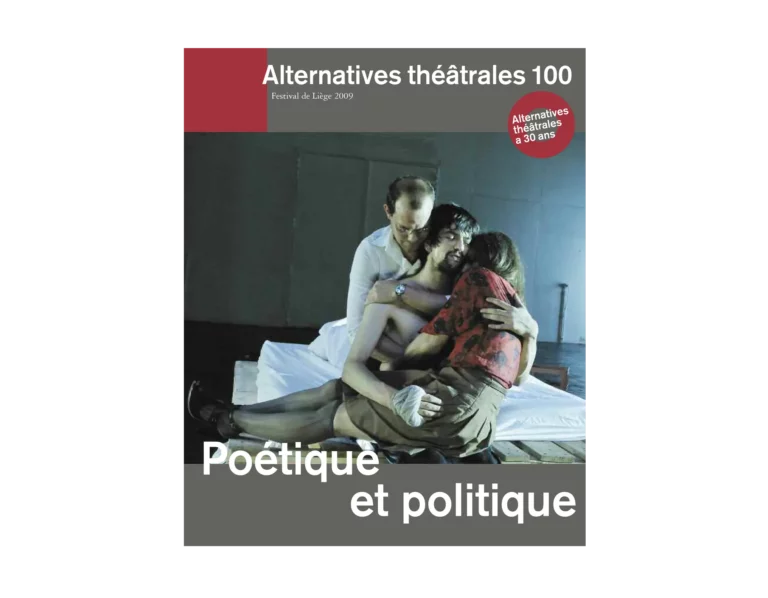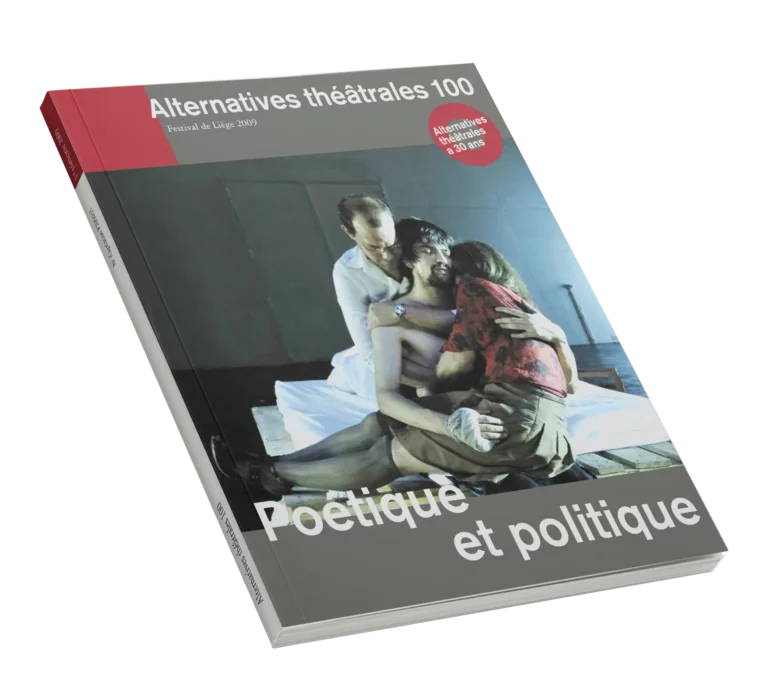JE TREMBLE (1)
Noir, ça commence dans le noir. On entend des pas. Arrive un homme en costume gris et crâne rasé. Il est le Monsieur Loyal d’un étrange cabaret. Il s’appelle Le présentateur dans le texte imprimé et il prévient d’emblée :
«Nous voilà au commencement de cette soirée, intitulée « Je tremble », soirée au cours de laquelle il est peu probable que vous soyez amenés à trembler vraiment ce titre étant en réalité un titre comme ça – presque un titre par hasard. »1 Il dit aussi qu’à la fin de la soirée, au tout dernier instant, il mourra. Il se doit de nous avertir car il mourra devant nous, devant nos yeux.
Des raisons de trembler
Quand on demande à Joël Pommerat si ce titre est le fruit du hasard, il répond simplement que les titres ne sont pas signifiants, et aussi : « C’est beau le tremblement. Mais moi, je ne tremble pas. » Il ajoute que c’est vraiment, comme le dit le personnage, un titre par hasard.
Mais qu’est-ce qui vacille dans le théâtre de Joël Pommerat ? Qu’est-ce qui vacille dans ce théâtre apparemment immobile ? Je crois que ça a à voir avec les « frissons de la pensée. 2 »
« Ce soir, c’est la fête. Nous allons trembler, de joie, et pleurer, de rire, ensemble mes amis…»3, annonce Le présentateur – qui n’a pas peur de se contredire. Dans la vie, il y a bien des raisons de trembler. Pour certains penseurs de l’âme, ça s’explique scientifiquement. Selon Descartes : « Les tremblements ont deux diverses causes : l’une est qu’il vient quelquefois trop peu d’esprits du cerveau dans les nerfs et l’autre qu’il y en vient quelquefois trop pour pouvoir fermer bien justement les petits passages des muscles, qui […] doivent être fermés pour déterminer les mouvements des membres. »4 Il précise qu’on peut trembler de tristesse, de peur et de froid, mais aussi de colère et d’ivresse : les passions et le vin feraient parfois aller tant d’esprits dans le cerveau qu’ils ne peuvent être conduits de là dans les muscles…
Pour définir le tremblement, Kierkegaard s’appuie sur le cas d’Abraham, le Père de la foi. Dieu lui a dit de prendre son fils unique, Isaac, et d’aller au pays de Moriah pour l’offrir en holocauste. Malgré l’absurdité de l’injonction, Abraham se conforme à cette Loi de Dieu. N’ayant plus, en guise de certitude, qu’une effrayante angoisse… Il est prêt à tuer son fils aimé – et c’est ce qui lui permettra de le recouvrer. C’est dans ce rapport intime avec le divin que l’individu est saisi par la crainte et le tremblement.
Devant Dieu ou parce qu’il boit trop de vin, l’homme tremble. Pour des motifs mécaniques et / ou spirituels, l’homme tremble, vacille, titube, hésite, tombe et parfois se relève. Il en va de même sur les scènes de Pommerat où les personnages peuvent tomber mort ou d’épuisement, s’écrouler, un temps. Et se relever parfois. Des sortes de vague à l’âme affectent leurs corps et leurs esprits. Ils peuvent être saisis de convulsions. Mais plus souvent, ils tremblent au-dedans et ça ne se voit pas. Ainsi, la jeune femme en tee-shirt qui relate l’effroyable histoire de sa mère ( scène 5, page 11 ), ne bronche pas : sa mère est entrée à l’usine, hantée par l’idée de porter le malheur et la souffrance des ouvriers, habitée par cette pensée jusqu’à se faire rogner dans sa chair, couper les doigts, les mains, et finir par ressembler aux machines coupantes qui l’ont mutilée. Pour dire ce récit d’une violence inouïe, la comédienne prête une voix sans émotion, un corps presque immobile ; seules ses mains dont les paumes sont tournées vers le ciel, donnent l’illusion de la prière. Dans la scène suivante, sa mère dit qu’elle s’est trompée, qu’il y aura toujours du malheur et qu’elle n’y peut rien. Elle en a fini avec son idéologie christique, mais entre- temps, elle a abandonné son enfant. Vertige de l’horreur et comble de l’absurde sont présentés ici en toute simplicité. La fille sanglote et titube.
Pommerat a décidément le sens du sacrifice. C’est frappant dans LES MARCHANDS où une mère tue son unique enfant pour sauver l’usine menacée de fermeture. Ses parents morts lui ont soufflé de le faire. Dans JE TREMBLE, L’homme qui n’existait pas (Scène 7,
p. 16) sacrifie L’homme le plus riche du monde. L’homme qui n’existait pas était un chef d’entreprise efficace jusqu’au jour où il s’est rendu compte que tout fonctionnait bien sans lui. Conscient de son inutilité, victime d’un « vide sans fond que rien ne peut combler »5 , il se sent devenir « rien ». Curieusement, un autre homme extrêmement riche et puissant, éprouve le besoin de le rencontrer et de lui offrir un fusil (ce dernier offre des cadeaux pour se sentir exister). En dette maintenant, L’homme qui n’existait pas appuie sur la gâchette… Sur scène, le noir envahit l’espace et accompagne sa disparition. On ne voit que son visage éclairé par un halo de lumière.
Mais quel est ce monde où l’on tue si facilement ? Pour Joël Pommerat, il n’y a rien de tragique ou de mystique là-dedans. Il y a le monde tel qu’il s’offre à son regard : « J’aime avoir un regard sur les choses, un regard en dehors, un regard qui nous sort du sentimentalisme, une représentation débarrassée de la croyance. Je cherche une position anthropologique6 , je cherche à restituer ce que je vois, sans jugements ni préjugés – ni trop d’irrespect…»
Il y a des hauts, il y a des bas
Sa vision du monde n’est ni borgne ni désenchantée. Il est donc inutile de raconter des histoires à dormir debout : « Moi, j’ai une âme de scientifique. Mais pour décrire le monde, par faiblesse ou par ambition artistique, j’ai choisi d’aller vers la création. Je crois qu’il est bien plus positif et optimiste de le montrer tel qu’il est. Je pense qu’on sous-estime l’importance des détermi- nismes. Beaucoup de gens ont besoin de penser qu’ils
ont un pouvoir de création sur leur existence alors que majoritairement ils ne l’ont pas. » Si cet état des choses est tragique pour la plupart d’entre eux, lui compris, ça ne le rend pas pessimiste d’en avoir conscience : il sait que le tragique recèle ses parts de beauté, de merveilleux et de grâce. Dans le tragique, il y a l’idée des sommets et des gouffres, la notion de très grande amplitude. Ce qu’il résume en toute simplicité : « Comme on dit, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. »
Dans la quatrième scène, une fille très maigre, sans âge, vêtue d’un petit short rose et perchée sur de gigantesques talons, tâche de tenir debout. Comme droguée, elle arrive à peine à parler : « Il y a ceux qui veulent s’en sortir et puis les autres et c’est tout. Mon Dieu, j’aimerais tellement y arriver. »
Mais elle n’y arrive vraiment pas. Elle s’écroule. Comme abattue, à terre, La Femme très mal en point demande comment s’en sortir si tout l’argent que les plus audacieux rapportent à la société sert à encourager les pauvres dans leur pauvreté… Comble de la cruauté, de l’ironie, du paradoxe ? Joël Pommerat aime jouer avec les superlatifs et pousser les situations à leur comble, au-delà de la doxa.
On la retrouve plus tard dans une autre tranche de vie (Scène 9, p. 26). Elle est toujours dans un état de grande faiblesse, de grande maigreur, d’immense fragilité. « Son état est encore plus pathétique. Elle ne tient plus son équilibre », précise la didascalie. Sa famille la regarde apparaître. Elle s’approche d’eux, et ils en ont peur. Ils disent qu’ils se sont battus pour un monde meilleur, qu’elle les opprime. La fille maigre chancelle. Les parents n’en reviennent pas qu’elle ait pu en arriver là. La femme très mal en point attrape les bras de sa mère et les place autour de sa taille, lui prend ses mains pour se caresser le visage. Elle tombe et enfin, ils l’aident à se relever.
Sur les plateaux de Pommerat, il y a des hauts, il y a des bas, comme pour les chevaliers de la foi kierkegaardiens – la comparaison est osée… Certains personnages « pommerassiens » « chancellent un instant et ce flageolement montre qu’ils sont des étrangers en ce monde…», « ils sont des danseurs qui possèdent de l’élévation »7. D’ailleurs certains morts, après s’être fait hara-kiri sous nos yeux, se relèvent bien vivants.
Il y a des chutes qui finissent dans l’effroi et d’autres qui font rire.
L’humour de Joël Pommerat
Il est clair que Pommerat n’use guère des chutes et autres ressorts habituels du comique pour nous faire rire ou sourire. Selon lui, dans JE TREMBLE, il n’y a pas une page sans humour. S’il ne craint pas de parler de la gravité des choses, de la violence, il choisit pour toucher au mieux la réalité, de mélanger la gravité, le sérieux avec la dérision, le dérisoire… Tout particulièrement dans JE TREMBLE. C’est d’ailleurs annoncé dans le prologue de la pièce : « Dans un lieu qui pourrait s’appeler cabaret ou théâtre, où le sérieux et la légèreté, la gravité et la dérision pour un soir ne s’opposeraient plus, quelques spécimens de l’humanité viennent se raconter ou se chercher une vérité sous la conduite d’un présentateur plutôt déconcertant. »
Le chapitre « Légèreté » des LEÇONS AMÉRICAINES de Calvino, permet de préciser le concept chez Pommerat et suggérer qu’il y a une légèreté du pensif et une légèreté du frivole… Et encore que la mélancolie est la tristesse devenue légère.
Mais la légèreté ne suffit pas encore à caractériser son humour, dont le sens est aussi à chercher auprès d’auteurs comme Bernhard ou Benjamin. Pour eux, l’humour
et la mélancolie ne sont jamais loin de l’humour noir, il peut naître de l’inconscient et du monde onirique, et l’Histoire peut trouver refuge dans l’humour. L’humour a ses racines dans l’ancienne doctrine des humeurs ( humores ), dont la mélancolie fait partie, et qui peut conduire au scepticisme comme attitude philosophique8. Selon Freud, l’humour peut triompher de l’échec, grâce à sa capacité de transformation d’un sentiment de déplaisir en plaisir. C’est grâce à lui qu’il nous est permis d’assister, malgré tout, au tragique du monde. Dans JE TREMBLE (scène 11, p. 35), on apprend que Le présentateur a tué et égorgé des petits enfants. Les personnages féminins, deux Femmes enceintes, sont fascinés par cet homme qui dit qu’il a fait sa peine, qu’il n’est plus le même. Les deux femmes enceintes lui parlent d’une seule voix et tombent à l’unisson dans ses bras. Elles s’y sentent tellement en sécurité… La scène est désopilante – pas de quoi rire à gorge déployée – et tendre à la fois.
Signe d’utopie artistique selon Pommerat, L’homme brutal a changé. C’est qu’on peut se transformer dans le théâtre de Joël Pommerat9 ; on peut aussi s’y aimer et l’amour figure parmi les moyens de la métamorphose. On peut s’aimer à deux – Le présentateur amoureux depuis plusieurs mois d’une femme qui avait plusieurs fois son âge –; on peut s’aimer à trois – les deux femmes enceintes dans les bras du tueur adouci ; on s’aime aussi à plusieurs – mêlée d’amour familial. Mais on n’aime jamais vraiment comme il faut… – scènes sus-citées.
Le théâtre de Pommerat nous touche au cœur en montrant des pans d’humanité. Si dans la vie, on dit souvent qu’il faut regarder la vérité en face, en art, selon Pommerat, on peut approcher toutes les vérités, et toutes les montrer. La vérité est plurielle : elle est dans le pile et dans la face. Sur scène, elle est à cour et à jardin, derrière le rideau pailleté d’un cabaret… La vérité n’a pas de face. On peut l’attraper de biais, ou bien n’en présenter que des détails, qui seront ensuite dilatés, ou « floutés ». Pour exemple, la scène pour le moins bizarre de la femme coupée en morceaux : deux personnes lui coupent bras et jambes, puis la tête, avant qu’on entende les applau- dissements. Ce tableau fait penser à un numéro de music-hall, mais joué à l’abri d’un voile qui en accentue l’étrangeté et rend la scène improbable. Joël Pommerat aime jouer avec les effets de grossissement du réel, d’amplification des détails. Il pense que la beauté est dans les choses compliquées, et que la vie, l’humanité, se donnent à voir dans ses moments les plus forts. Il dit qu’il ne faut avoir peur de rien, en art, qu’il n’y a rien à cacher ni à enjoliver. Dans JE TREMBLE, il prend tout particulièrement le risque d’être dans l’indétermination, le flou, l’incertitude des choses. Dans le doute.