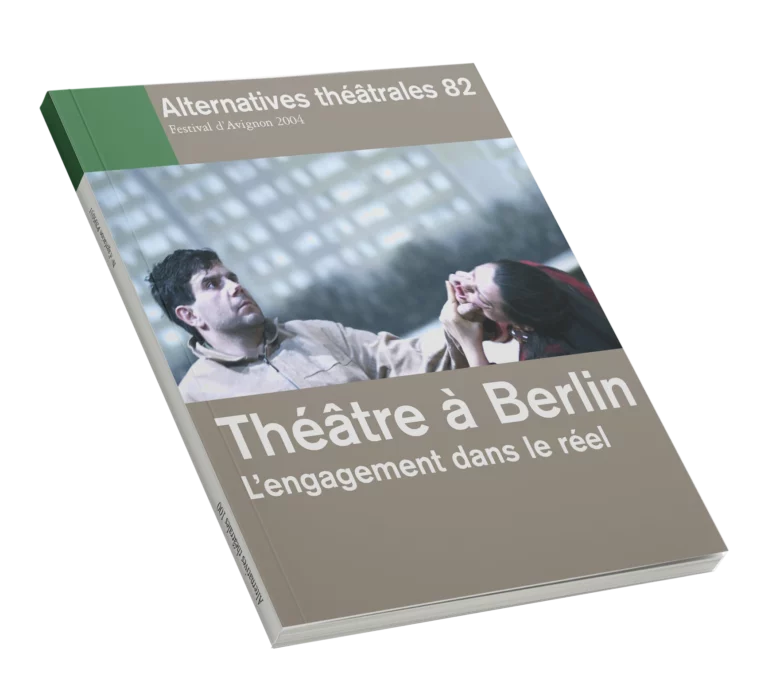En 1999, lorsque Thomas Ostermeier prend la direction de la Schaubühne de Berlin avec ses « compagnons de lutte » Jens Hillje, Sasha Waltz et Jochen Sandig, c’est avec un texte-manifestequ’il va à la rencontre du public. Chose étrange, que l’on n’avait vue depuis longtemps : de jeunes artistes, qui à travers et par-delà leur activité théâtrale s’imposent des questions plus larges, à l’échelle de la société, qui dévoilent les orientations de leur travail, qui s’appuient pour cela sur de nouveaux auteurs et cherchent une confrontation véritablement actuelle avec la réalité. La Schaubühne, dont la renommée de « modèle du théâtre ouest-allemand » avait été entamée dans les années 90, a depuis essayé de renouer non seulement avec l’idéal que l’on croyait dépassé du collectif artistique, mais également de cultiver l’idée du débat public. Ce faisant, elle s’inscrit dans la tradition du « théâtre engagé » et multiplie les activités de l’ensemble : ce ne sont pas les seules productions artistiques, qu’elles concernent la danse ou le théâtre, qui se trouvent au centre des préoccupations. Il faut au contraire considérer le profil de ce théâtre comme un phénomène global dans le paysage théâtral et la culture berlinoise, phénomène qui ne peut sans doute se concevoir sans la structure typiquement allemande de l’ensemble (la troupe permanente) tant comme une chance que dans ses crises.
Le théâtre allemand semble être à bien des égards un modèle, en affirmant son attachement à cette expérience de l’ensemble et en conservant une emprise directe sur la réalité politique et sociale. Mais c’est ce même théâtre qui connaît de manière récurrente des situations de crise économique, structurelle et artistique. Il est actuellement confronté à la question de sa fonction dans l’espace social, comme cela n’avait sans doute pas été le cas depuis longtemps. Cette fonction, les artistes sont régulièrement amenés à la redéfinir concrètement. Dans un contexte où semblent faire défaut les grandes conceptions globalisatrices, un positionnement clair reviendrait à une prise de parti manifeste : mais pour ou contre quoi, dans quel but et selon quelles valeurs ? Seul le recul face à l’événementiel permet l’analyse et par là même la tentative de parvenir à une certaine forme d’objectivité. Mais démêler l’écheveau de la réalité opaque est une tâche toujours plus complexe lorsque le socle des valeurs communes à une société semble tendre à s’amincir. Lorsqu’il ne peut plus donner forme à des vérités sur le monde, l’art théâtral doit alors tenter de traduire de manière nouvelle le questionnement de celui-ci.
Le théâtre, qui a désormais abandonné l’illusion de pouvoir dire le monde objectivement, devient le lieu de l’expérience concrète et physique d’une réalité sociale et d’une réflexion sur les conditions de notre devenir. Mais quelle démarche artistique, quel récit, quelles formes d’écritures scéniques et de jeu peuvent aujourd’hui exprimer un véritable ancrage dans le réel ? Quelles visions socioculturelles ou politiques marquent aujourd’hui le discours des artistes, qui s’articule à travers les spectacles mais également en dehors de la scène même ?
Par-delà la diversité des formes et des parcours individuels des artistes interrogés sur ce sujet, il s’agit ici de questions adressées au théâtre qui sont celles de ceux qui le font, mais aussi de son public. Le théâtre de langue allemande peut – au vu de son histoire et de son fonctionnement structurel – être considéré comme une sorte de « dinosaure » de cette tradition du « théâtre engagé », et fait ici l’objet d’un questionnement dans ce sens : dans quelles conditions de production, dans quelles structures, différentes dans certains aspects de celles qui constituent d’autres paysages théâtraux, ce travail dans et sur la communauté a‑t-il lieu ? Quelles variations esthétiques, quelles exigences intellectuelles peut-on en dégager ? Bref : quelle place le théâtre peut-il et veut-il affirmer dans la vie culturelle et sociale ? Et comment se présente aujourd’hui la réalité d’une société traversée de radicales mutations sociales et politiques telles que l’Allemagne les vit depuis le début du processus d’une réunification – loin d’être achevée – de deux États et de deux traditions artistiques différentes ? Le sociologue Wolfgang Engler essaie dans l’entretien retranscrit ici d’en esquisser un tableau socioculturel.
Dans la perception nationale et internationale de la scène théâtrale allemande, Berlin prend une place toujours plus importante. Nikolaus Merck nous propose une traversée de la capitale allemande qui se bat, malgré son attraction pour les étrangers, avec de multiples problèmes, économiques et politiques, qui risquent d’étouffer le développement d’une véritable « métropole ». La concurrence entre les nombreux théâtres et opéras, menacés eux-aussi par le grave endettement de la ville et du Land de Berlin, responsable, dans cet état fédéral qu’est l’Allemagne, du financement public, oblige les scènes à se démarquer le plus possible les unes des autres. En effet, elles attirent de plus en plus les jeunes artistes à succès (médiatique) profitant d’un très grand public. Mais le paysage théâtral allemand reste décentralisé de par son histoire et ses structures, et les impulsions artistiques surgissent de partout. Ainsi, les jeunes talents dont Peter Michalzik essaie dans son article de cristalliser quelques tendances et quelques dénominateurs communs travaillent souvent dans d’autres villes allemandes.Et même si le théâtre allemand reste toujours très marqué par les metteurs en scène et leurs lectures radicales de textes dramatiques – classiques aussi bien que contemporains –, l’auteur vivant y a connu une « présence » renforcée depuis quelques années. Emmanuel Béhague explore dans son essai comment certaines voix contemporaines essaient de retrouver une dimension politique de l’écriture théâtrale et sous quelles formes celle-ci se manifeste aujourd’hui.
L’orientation thématique de nos réflexions repose donc sur la question des contenus et des formes par lesquels le théâtre se confronte au présent. Le théâtre de Thomas Ostermeier, artiste associé au Festival d’Avignon en 2004, y apporte des réponses spécifiques. Avec son « atelier des générations », comme l’appelle ici l’auteur Mathias Greffrath, il développe dès son début à la Baracke du Deutsches Theater la vision d’un « nouveau réalisme » qui traduirait une « attitude qui appelle au changement, née d’une douleur et d’une blessure ». Ainsi, Ostermeier semble se préserver un certain optimisme par rapport à la pertinence et aux possibilités sociopolitiques du théâtre dans notre société. S’inscrivant dans la tradition allemande d’un « réalisme engagé », il a développé au courant de sa carrière extrêmement rapide un théâtre d’acteurs dont le physique et la maîtrise acrobatique du corps constituent le fondement esthétique.
Le travail de Thomas Ostermeier contraste cependant avec celui d’autres artistes, s’y oppose, tout en le complétant. Il est aussi à appréhender dans le contexte berlinois, en particulier dans la confrontation – bien évidemment enflée par les médias – avec la Volksbühne de Frank Castorf. Indéniablement, les mises en scène de Frank Castorf font partie des réalisations théâtrales les plus importantes – en Allemagne comme en Europe – et cela depuis bien longtemps. Qui s’exprime sur le théâtre allemand, et en particulier sur son rapport à la société, ne peut éviter une réflexion sur les démarches complexes de Castorf. Refusant toute forme de réalisme, il se met cependant constamment à la recherche de la réalité dans le théâtre. Lui aussi s’ancre à sa manière dans le système institutionnel du théâtre allemand et de l’ensemble qui lui offre, dit-il, « la possibilité particulière d’un mode de production satisfaisant » et d’un « travail libre ».
Son approche assurément « autonome » de textes dramatiques ou de prose, la complexité des signes théâtraux et cinématographiques dans ses mises en scène et le jeu outré de ses acteurs ont créé un langage esthétique original. Il va de pair avec un discours intellectuel et artistique nourri par la personnalité de Frank Castorf lui-même, par son dramaturge Carl Hegemann et traduit à travers d’innombrables manifestations de tout genre qui ont fait de la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz un vivier culturel à Berlin.
Pourtant, le statut-culte désormais acquis de ce théâtre ne s’explique pas seulement par le travail de Castorf. Ces dernières années, René Pollesch, auteur et metteur en scène, est parvenu à se gagner son propre public par un théâtre novateur d’un point de vue formel et pertinent dans son contenu. Il est auteur-metteur en scène de ces projets théâtraux qui, de manière plus pessimiste que Thomas Ostermeier, invitent à mettre en cause ce qui semble être « normal » dans une société profondément et globalement capitaliste, jusque dans les comportements les plus individuels.
Longtemps, le langage théâtral d’un autre maître de la mise en scène allemande a constitué le contre-point à ce théâtre extatique et « criard » à l’intérieur dela Volksbühne même. Ces quatre dernières années, Christoph Marthaler s’est battu à la tête du Schauspielhaus de Zurich pour un théâtre délibérément fondé dans la réalité, tout en catapultant le spectateur hors de sa notion habituelle du temps. Ses collages chorégraphiques et musicaux ciblent pourtant des attitudes humaines d’une précision éblouissante et parviennent à cerner des questions fondamentales concernant le fonctionnement de notre société contemporaine. Ainsi, devenu une des principales références pour le paysage théâtral allemand, le théâtre de Marthaler pose également la même question : Comment le théâtre allemand se conçoit-il lui-même dans l’espace social et urbain qui lui sert de contexte, quelle fonction revendique-t-il ou refuse-t-il au contraire ? Les metteurs en scène, auteurs, sociologues et critiques présentés et sollicités ici – des voix allemandes mais aussi françaises – se livrent tousà un débat sur cette question et tentent parfois des réponses différentes, liées à leurs démarches esthétiques diverses, voire contradictoires. Ils esquissent ainsi un large tableau de ce que pourrait être le théâtre allemand contemporain.