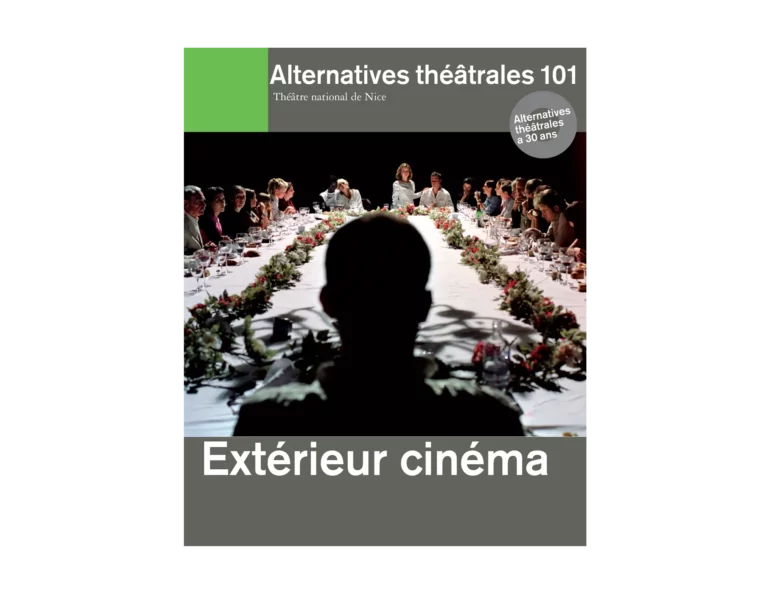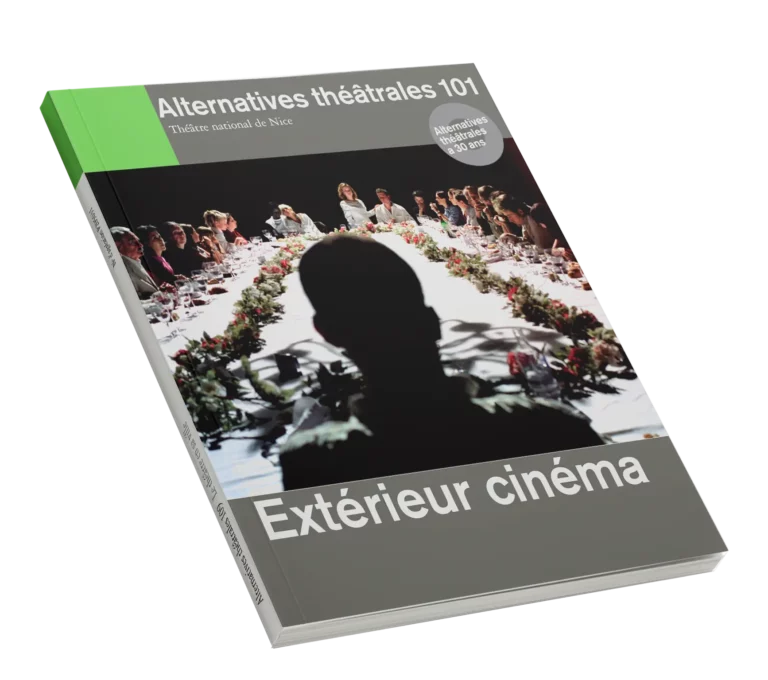Durant sa période néerlandaise, lorsqu’il était directeur artistique du groupe de théâtre « Hollandia », Johan Simons travaillait principalement les pièces du répertoire, les tragédies classiques mais aussi les drames paysans récents d’Achternbusch et de Kroetz. Cela ne l’empêchait pas de temps à autre d’adapter, pour ses réalisations théâtrales, des scénarii de films. Ce fut le cas pour Théorème de Pier Paolo Pasolini ou les damnés de Visconti.
Ces dernières années Simons travaille de plus en plus souvent à parti d’un matériau romanesque ou cinématographique. Il a réalisé une version théâtrale du Décalogue de Krzysztof Kieslovski pour le Kammerspiele de Munich et le NT Gent (Nederlands Toneel Gent). Il mettra bientôt en scène en Allemagne, du même cinéaste, Bleu blanc rouge. Récemment, il a présenté au NT Gent, Double Indemnity, réalisé à partir du film de Billy Wilder.
Geert Sels : Avez-vous un rapport personnel avec les films dont vous choisissez le scénario pour l’adapter au théâtre ?
Johan Simons : Mon choix pour les scénarii de films n’est pas guidé par des raisons personnelles. Je suis plutôt motivé par la dimension politique ou la pertinence des thèmes développés. J’avais auparavant un sentiment d’amour-haine pour les rapports de pouvoir tels que Visconti les présente dans les Damnés. Je n’ai pas beaucoup de rapports avec ce monde-là.. C’est un thème magnifique, sans plus : comment de grands industriels tentent de mettre en sûreté leur capital familial, même s’ils doivent, pour cela, renier leurs idéaux politiques.
G. S. : Voyez-vous ces films plusieurs fois ? faites-vous un travail particulier de transcription du scénario à la scène ?
J. S. : Ces films ne me sont pas absolument indispensables, ni ne me poursuivent durant des années, sauf peut-être les damnés que j’ai vus à plusieurs reprises. Ce n’est pas le cas pour Kieslowski ; j’avais vu ces films au début des années 1990 sous forme de séries à la télévision néerlandaise, et il ne me venait pas à l’esprit que je pouvais en faire quelque chose. C’est le dramaturge du Kammerspiele de Munich qui a attiré mon attention sur cette œuvre et, en la revoyant, j’ai trouvé qu’elle contenait beaucoup de choses intéressantes à traiter par le théâtre.
Il y a un grand travail d’adaptation à réaliser pour porter ce genre de scénario au théâtre. On peut le faire de différentes manières. Chez Visconti, on trouvait la langue trop faible pour accompagner de grandes images scénographiques. C’était une langue trop plate, trop naturaliste. Nous lui avons donc ajouté une couche supplémentaire, plus littéraire, tirée de L’homme sans qualités de Robert Musil. Dans la version théâtrale, la langue joue donc un rôle plus important que dans le film.
Pour le Décalogue, Kieslowski a réalisé un script très développé où les mouvements de caméras sont décrits en détails. Nous avons utilisé ces indications dans une partie narrative. La version de Munich se décompose en scènes jouées et scènes racontées. Pour Bleu blanc rouge., nous allons agir autrement. Là, nous prendrons comme point de départ uniquement le texte du film mais nous allons tenter de le compléter par le langage des images.
G. S. : Les films retenus sont parfois des films culte d’une époque. Etes-vous sensible à la mythologie du film retenu ? A‑t-elle un rapport avec la société et la culture de votre pays ? Travaillez-vous sur le rapport à l’imaginaire collectif dont sont chargés la plupart de ces films ?
J. S. : Je suis bien conscient de la mythologie qui se dégage de pareils films. Cela peut sembler prétentieux de dire : je vais faire un Kieslowski. Mais ça ne m’impressionne pas. Je ramène le film à son actualité et à une certaine réalité sociale. Ce qui est intéressant par exemple, c’est que Kieslowski met en doute la validité des dix commandements (excepté le cinquième : Tu ne tueras point). Il s’agit aussi d’un grand cycle à l’intérieur duquel, par le mouvement qui traverse l’ensemble, on apprend, chemin faisant, à connaître les habitants d’un édifice unique. C’est assez rare dans le répertoire théâtral de pouvoir suivre des récits dans l’ampleur de leur continuité.
C’est intéressant de pouvoir jouer avec cet imaginaire collectif. Je le fais avec plaisir. Il y a des histoires qui sont si fortes, si terriblement reconnaissables ; elles pourraient se passer en ce moment même chez notre voisin.