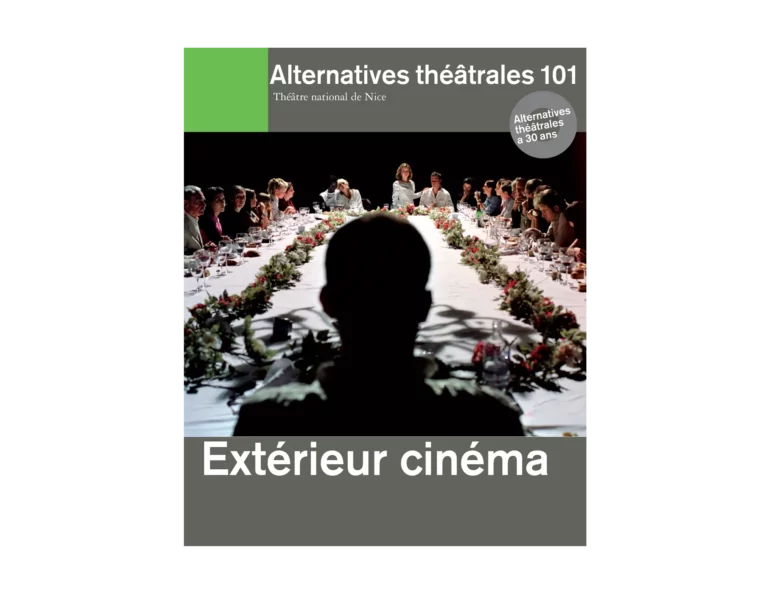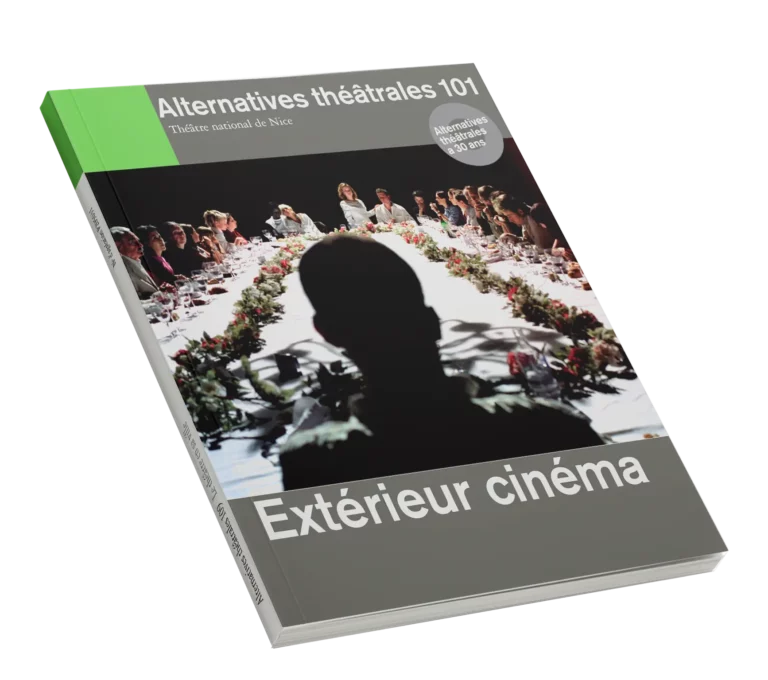LIEBE KANNIBALEN GODARD de Thomas Jonigk (2006) et DER OKKULTE CHARME DER BOURGEOISIE BEI DER ERZEUGUNG VON REICHTUM de René Pollesch (2005) s’appuient toutes deux sur des films des années 1960 – 1970 à fort contenu idéologique. La première pièce reprend assez fidèlement le scénario du film WEEKEND, qui a initié la rupture de Godard avec le public en 1967. Pollesch adopte quant à lui une position très libre : ses œuvres sont de véritables patchworks de références, ce qui relativise celles-ci. Peut-on alors opposer LIEBE KANNIBALEN GODARD, qui se situerait dans la continuité de la Nouvelle Vague et des messages des années 1960, au CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE, qui romprait avec les anciennes avant-gardes de manière tant postmoderne que postdramatique ? Les choses ne sont évidemment pas aussi simples, ni surtout aussi formelles.
Il est vrai que Jonigk semble entreprendre une simple réactualisation de WEEKEND tant les affinités sont grandes. L’auteur reprend tout d’abord les éléments clés du scénario, qui retrace le départ en weekend d’un jeune couple parisien aisé, où chacun désire la mort du partenaire pour en tirer un bénéfice financier. Corinne et Roland – tels restent leurs noms – se frayent leur route sans tenir compte des accidents et des morts qu’ils provoquent plus ou moins délibérément, éliminent la mère qui refusait de céder sa part d’héritage et tombent aux mains de cannibales justiciers. L’auteur continue à dénoncer le matérialisme exacerbé, l’instru- mentalisation i.e. l’objectivation des autres et l’impasse de notre civilisation.
Il transpose par ailleurs les procédés esthétiques de Godard au théâtre, transposition bien venue puisque Godard reconnaissait en Brecht un de ses maîtres. Il adopte ainsi une structure en stations, un ton désinvolte nourri par des ruptures impromptues, insère des interludes surréalistes et multiplie les titres intermédiaires ou les clins d’œil à l’actualité : la guérilla évoquée par Godard cède la place au terrorisme, Bush et Blair succèdent à Mao et Johnson, Godard n’apparaît plus sous les traits de l’Ange exterminateur1 mais joue son propre personnage… La course à l’Enfer que retracent tant la pièce que le film reste donc éminemment métathéâtrale et grotesque.
Jonigk reprend ce faisant les connotations positives attachées au cannibalisme dans WEEKEND : le cannibalisme comme métaphore de la fondation d’un ordre social, par l’ingestion du père ( Kronos ), en l’occurrence la tentative de fonder une nouvelle société en détruisant l’ancienne. Il instaure une inversion de valeurs radicale en restaurant dans le cannibalisme une forme de justice et d’ordre paradoxal sanctionnant l’inhumanité de Roland et Corinne2.
Quoique le motif ait été plus fréquent dans la littérature des années 19603, il reste un thème qui marque notre imaginaire4. L’effet de la pièce se distingue néanmoins radicalement de celui de WEEKEND. Jonigk accentue les caricatures à outrance, introduit dès le prologue du cuisinier l’idéologie des anthropophages, alourdissant et le grotesque et le message de libération sociopolitique. Il est d’une certaine manière lourd de clarté, alors que Godard prend soin d’être allusif, que ses films sont hantés par « l’invisible des forces sous-jacentes »5.
En effet, Godard croit en l’anarchie, au désordre ( y compris filmique ) comme facteur de renouveau du sens et de l’action ; il conçoit le film comme pouvoir doux en quelque sorte, non structuré et libérateur de pensée. Jonigk a écrit une pièce beaucoup plus dogmatique qui oppose l’anéantissement de l’homme dans des objets à l’appareil d’une pensée combattante morbide.
Une telle lourdeur a partie liée d’abord avec l’impossibilité de choquer aujourd’hui, à un pessimisme mûri par les quarante ans de décalage. En encadrant toute la pièce par le cannibalisme, celui-ci apparaît davantage comme un destin. Face au matérialisme qui atteint sans cesse de nouveaux climax, il est naturel qu’on puisse de moins en moins se dérober à l’alternative qui lui est opposée.
Mais l’entreprise qui consiste à éliminer l’humanité, à l’anéantir sans que plus aucun totem ne soit possible après cette mort du père, c’est-à-dire plus aucune culture, cette entreprise signe une fin tellement absolue qu’elle échappe au jeu et s’inscrit dans le désespoir au-delà du cynisme. La substitution du dogmatisme anthropophage au totalitarisme matérialiste se fait par défaut, parce qu’il n’existe plus d’observateur externe, de critique constructive, ainsi que le dit Luhmann6 ( BEOBACH- TUNGEN DER MODERNE ). Preuve en est la clôture totale de la pensée qui mène le cannibalisme jusqu’en ses plus extrêmes conséquences, à savoir l’endocannibalisme. Il est probable en effet que les cannibales n’arrivent pas à vaincre l’humanité entière, si bien que le choix de Corinne et du chef se résume à « manger » ou « être mangé » ! Corinne et lui mangent ainsi à la fin un met accommodé des restes du touriste, du mari de Corinne et du bras du chef. Jonigk accroît encore l’horreur de la solution paradoxale qui consiste à sauver l’humanité – « die Menschlichkeit » – en anéantissant l’humanité – « die Menschheit ». Il ne reste plus aucun horizon de libération. L’endocannibalisme marque la fin du politique.