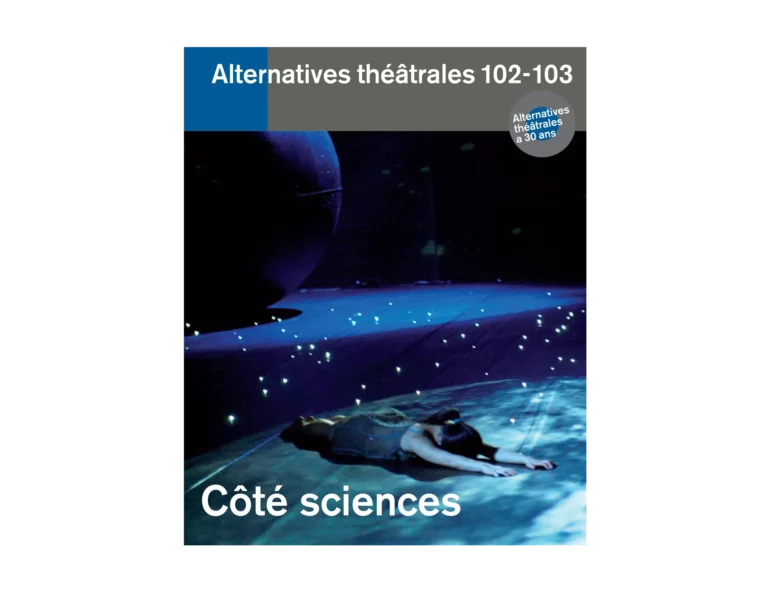J’AI LONGTEMPS CRU, en préparant cet entretien, que parler à Jeanne Balibar de science serait plonger dans la relation toujours complexe et intime qu’une fille entretient avec sa mère. Cela n’avait-il pas commencé comme cela d’ailleurs ? Cela n’avait-il pas commencé parce que Jean-François cherchait à joindre Françoise Balibar en vue de son nouveau projet autour de la fille de Galilée ? Cela n’avait-il pas commencé, de façon quelque peu théâtrale, par Jeanne déclarant : « La fille de Galilée, c’est moi ! »
C’était sans compter sur l’imprévisibilité d’une actrice qui, soir après soir, représentation après représentation, questionne, bouscule une pratique qui n’a ainsi jamais le temps de se fixer, se rigidifier. Si la curiosité de l’actrice avait ainsi été piquée au vif par le projet de Jean-François, si elle voyait là une façon d’en découdre avec le désamour qu’elle portait, jeune fille, à la science, elle s’est également vite aperçue que le spectacle ne pouvait s’en tenir à cela, que sa partition au sein de celui-ci devait aller se nourrir à bien d’autres sources et que faire acte d’autofiction sur un plateau en tentant de se libérer du poids qu’a pu représenter pour elle « la difficulté de comprendre de quoi parlent les scientifiques » 1 n’était pas tout à fait faire acte de jeu. Tout au plus s’agissait-il d’utiliser le théâtre comme « mode d’expression démocratique » des faits, théories et autres expériences scientifiques ; à cet égard, la scène des satellites de Jupiter 2 constitue, pour elle, un idéal, tant elle parvient à rendre ces observations accessibles, par son ludisme et sa poésie.
Il faut probablement que j’avoue, qu’allant trouver Jeanne, je débordais de curiosité mais que son rapport au matériau scientifique n’était pas l’élément qui attisait le plus mon intérêt ; m’intéressait plus sûrement la question de son approche et de son adaptation à un théâtre comme celui de Jean-François Peyret : deux souvenirs me taraudaient plus que d’autres, revenaient sans cesse à mon esprit. D’abord Jeanne, grande fumeuse, n’allumait jamais de cigarettes sur le plateau, je brûlais de lui demander pourquoi, car il était certain que ce n’était en aucun cas pour se plier aux interdictions désormais en vigueur dans les théâtres. Je n’ai pu me défaire de cette question élémentaire et insignifiante jusqu’à mon entrevue avec elle. Le second souvenir qui hantait ma mémoire était celui de la répétition du 9 février 2008, au studio Kablé à Strasbourg ; Jeanne fait son entrée sur le plateau : seules quelques feuilles de papier recouvrent son corps nu, formant ainsi une délicate robe à volants blancs. Elle dit, presque timidement : « Comme Bibi aime manger le papier, je me suis dit que cela pourrait être intéressant si elle le mangeait sur mon corps…».
Aussi anecdotiques que ces souvenirs puissent paraître, ils marquent une discipline de travail et singularisent une nature de comédienne. Je lui laisse la parole :
« J’ai remarqué au cinéma, où il est vraiment possible de fumer, que c’est souvent une facilité : je pense que le jeu se réduit à une chose très simple : une action, unique, à la fois. Je pense que ce n’est pas vrai qu’on peut faire plusieurs choses à la fois. Si on donne au spectateur l’impression qu’on fait plusieurs choses à la fois c’est de l’illusion. C’est quelque chose que j’ai appris au fil des années : tu ne fais qu’une chose à la fois, donc, quand tu fumes, tu fumes. »
« C’est souvent l’environnement, les objets autour, qui permettent de trouver des manières de représenter qui sont plus signifiantes dans ce que je fais moi que juste avec la parole. En regardant autour de moi, parce que ça implique aussi une nouvelle manière de regarder autour de soi, qu’est-ce que j’ai vu ? Que Bibi mangeait les papiers, et que ça serait marrant, une chose à la fois là encore, qu’elle mange des papiers accrochés à mon corps de façon à produire une image scénique violente et dramatisée. Et évidemment, en ayant l’idée, j’ai eu l’idée de toutes les résonances de sens que ça pouvait prendre. Mais c’était aussi bête que ça au départ. »
Faire une chose à la fois tout en s’adaptant à son milieu, c’est-à-dire aux objets et aux êtres qui l’entourent, constitue ainsi un des points de repère essentiels de la pratique de jeu de Jeanne Balibar. Ainsi, à ma question sur l’adaptabilité de sa pratique à un théâtre fabriqué à partir d’improvisations sur des textes non dramatiques, un théâtre faisant fi de toute histoire linéaire ou de la construction psychologique du personnage, Jeanne me renvoyait à tout ce qui fait aussi la dimension concrète de cette pratique : les objets qui habitent le plateau, l’univers sonore et musical qui l’enveloppe et les rapports avec ses partenaires qu’il s’agisse des autres comédiens, des danseuses ou de Bibi. Insidieusement, la question de la technique et de la façon dont l’acteur est capable d’en jouer revenait sans cesse et, par elle, l’apport que constitue l’expérience du jeu cinématographique :
« Je suis venue au théâtre par la littérature, j’avais envie de vivre dans des textes, mais, aujourd’hui, plus ça va, plus je m’aperçois que ma nature d’actrice, elle, est plus du côté du cinéma muet, du burlesque et de ce jeu avec les objets et les choses qu’il y a dans le burlesque. […] ça vient aussi peut-être de la danse chez moi : pendant des années, j’ai cru que le fait d’avoir fait dix ans de danse était une erreur de parcours mais en fait c’est peut-être ma nature profonde de mettre un corps sur scène et de le libérer de la parole. »
L’occasion était trop belle : le parti pris du spectacle, débusquer la volonté de savoir d’un Galilée à travers les yeux de sa fille, clarisse recluse, n’allait-il pas déjà sans une certaine ironie qui justifiait le recours au burlesque comme prisme singulier à travers lequel revoir le spectacle, et tout particulièrement, la partition de Jeanne, à travers celui-ci ? Manip, donc.
*
Si l’hypothèse peut apparaître scientifiquement incongrue, il faut rappeler ici que l’influence d’un réalisateur comme Jacques Tati sur la forme et le mouvement qui animent certains spectacles de Peyret n’est pas négligeable ; enfin, que les multiples âges et définitions du burlesque se prêtent à une multitude de croisements et de confrontations.
Défini sommairement comme une « comédie où le récit est souvent perturbé par des gags visuels, c’est-à-dire des événements incongrus, inattendus, accidentels ou prémédités » 3, reposant sur la gestuelle des acteurs, le burlesque apparaît au XVIIe siècle comme genre littéraire bas et trivial, proche de la parodie et du grotesque. Mais déjà, dès le XIXe siècle, des auteurs tels que Théophile Gautier ou Charles Baudelaire œuvreront à son élévation au rang de genre littéraire à part entière en soulignant notamment l’incroyable liberté formelle qu’autorise le genre : l’ironie dont il joue à merveille permet de garder à distance tout sérieux et toute prétention en introduisant une certaine absurdité ; ainsi dès l’origine, le burlesque semble se négocier sur le mode de la vexation.